II. De l'Epoque médiévale jusqu'au siècle des Lumières
Nous n'avons malheureusement aucune information sur le domaine avant le 14e siècle. Tout ce que nous pouvons affirmer est qu'une petite seigneurie a succédé à l'établissement gallo-romain car il existe quelques vestiges de l'époque mérovingienne: "des vestiges d'époque mérovingienne auraient été découverts au nord de Weidesheim. Le mobilier serait déposé à Strasbourg (Musée archéologique de Strasbourg)".(9)
1.L'origine du nom
Pour l'origine du nom de Weidesheim, il est possible de se référer au Dictionnaire étymologique des noms de lieux du département de la Moselle établi par Henri et Charles Hiegel (10): voici ce qu'ils écrivent sur Weidesheim: "Weidesheim, Waidesheim, Wedingesheim 1332 (Jungk p. 341; Burg, p.178), Wediesheim 1336 (Heemann, t. I, p.149) , Wedengisheym 1346 (RL. P. 1187; Herrmann, t. I., p. 171), Wedingesheim 1350 (Herrmann, t. I., p.662), Wedegesheim 1385 (Chatelain, Histoire du comté de Créhange, dans J.G.L.G.A., 1892 (II), p.76) Wedigesheim1444 (Pöhlmann, Die Herrenvon Bitsch, p. 123), Wedeshem 1475 (Pöhlmann, p.137), Viedirgesheim, XVe s. (Dorvaux, p. 30), Weidesheim 1506 (Bo. P. 282), Wedesheim im Westrich 1606 (Bo.), Weitzheim 1750 (Bo.), Weidesheim 1869 et 1871, du nom d'homme germanique Widuco, Veduco, Widugo, Widigo (Fö. , t. I., col. 1491, 1564 et 1569; Morlet, t. I., p. 222), changé en Wido (Fö., t. I., col. 1564) et germ. Heim."
Nous nous permettons d'avancer
une autre hypothèse concernant le nom de Weidesheim. Dans
le langage populaire francique le lieu est appelé "Wetzum".
Il existe plusieurs familles ayant un nom proche comme les Witztum
d'Egersberg (une famille noble alsacienne d'origine thuringeoise,
citée par Gérard Henner lors d'une conférence
en novembre 2000).
Pöhlmann, (Die Herren von Bitsch p. 123) cite un Hans Hirschhorn,
Viztum von Neustadt a. H. Or l'origine probable de ces patronymes
provient du latin "Vice Dominus" c'est-à-dire
représentants d'un seigneur suzerain sur un domaine. Il
s'agit de vassaux ou de chevaliers administrant une seigneurie
pour un puissant personnage. Par dérive onomastique (11),
il nous semble possible de passer de "Vice Dominus"
à "Wetzum". Néanmoins, l'explication donnée
par Henri et Charles Hiegel est plus vraisemblable.
9. Carte Archéologique
de la Gaule, La Moselle p.532 op cit.
10. Henri Hiegel, Charles Hiegel, Dictionnaire étymologique
des noms de lieux du département de la Moselle, Sarreguemines,
1986, pp.366-367
11. L'onomastique est la science de l'étymologie des noms
propres.
2.L'époque médiévale
Dès 1170, un Bitis Castrum
(château de Bitche) apparaît dans un document où
Frédéric Ier se dénomme lui-même comme
" Dominus de Bites " (Seigneur de Bitche).
Même si nous n'avons aucune preuve écrite, il est
possible que Weidesheim ait été dès cette
époque un fief vassal de la seigneurie de Bitche.
Néanmoins, il est probable que le domaine ait eu des contacts
assez fréquents avec le couvent de Herbitzheim distant
de 6 kilomètres à peine, voire des liens de vassalité
pour certaines terres.
Dans la seconde moitié
du 12e siècle, vers 1150-1170, plusieurs documents font
état de la seigneurie de Bitche et nous permettent de nous
faire une idée de son importance territoriale. Ainsi, vers
1150, le duc de Lorraine Mathieu Ier (1139-1176) envoie une lettre
au comte Volmar de Sarrewerden, sur le point d'entrer en guerre
contre Simon Ier de Sarrebruck et Volmar de Blieskastel. Matthieu
Ier demande au comte de Sarrewerden de respecter les limites ainsi
que les habitants de sa seigneurie. Dans cette lettre écrite
en lettres gothiques, mais en latin, les limites de cette seigneurie
sont établies avec le nom de 16 localités. Les frontière
Est et Sud-Est sont décrites plus sommairement: "depuis
Pirmasens jusqu'à Oermingen". Un village disparu sur
le ban de Lorenzen, sur la rive droite de l'Eichel, Wersingen
en fait partie. (12)
Au 13e siècle, la seigneurie de Bitche était le
seul territoire du duc de Lorraine à se trouver dans le
domaine linguistique allemand et du fait du morcellement des possessions
des comtes de Zweibrücken, elle se trouvait géographiquement
isolée. Le comte Eberhard II de Zweibrücken proposa
alors un accord d'échange au duc de Lorraine. Cette transaction
se fit par deux traités: celui du 13 mai 1297 et celui
du 1er juillet 1302.
12. Carl Pöhlmann Abriss
der geschichte der Herrschaft Bitsch Zweibrücken, 1911
La première mention directe de Weidesheim date de 1346. Une famille noble portant ce nom possède à cette époque un château qui fut détruit en 1380. Le conflit opposait le comte de Bitche et Henri III de Sarrewerden. Le domaine est dès cette époque proche d'une frontière entre deux seigneuries rivales. Cette position a apporté de très nombreux problèmes frontaliers: conflits sur les limites territoriales entre les communautés avec parfois des combats sanglants et des procès qui se sont succédés durant plusieurs siècles. [Thilloy Ruines du comté de Bitche]. Thilloy cite le château sous de nom de "Wedengesheim"
¨Parmi les plus importants
fiefs du comté de Bitche-Zweibrücken, se trouve une
part du château et du village de Weidesheim[…] à
proximité immédiate de la gare de Kalhausen et de
l'embouchure de l'Eichel dans la Sarre.
"Weidesheim était fief avec droits de haute justice
et château de la seigneurie de Bitche, en 1346 dans les
mains d'une famille noble de ce nom, qui s'éteignit en
1406 semble-t-il avec Petermann de Weidesheim. La succession se
fit avec les seigneurs de Créhange et les Schelm de Sarrewerden.
Le château semble avoir été détruit
en 1380 dans les conflits entre les comtes de Sarrewerden et ceux
de Bitche." (13)
"Jusqu'ici les données semblent fiables. Par contre,
concernant les 15e et 16e siècles, des documents manquent
et certains sont faux comme par exemple le fait que les seigneurs
de Fénétrange auraient été copropriétaires
alors qu'en réalité il s'agissait du seigneur de
Huntingen" (Hutting probablement ?) (14). En
effet il faut lire "Huntingen" au lieu de "Finstingen".
Le premier acte concernant le fief seigneurial avec mention du
château date du 8 avril 1444. Frédéric le
Vieux reçoit ce jour-là, du comte Frédéric
de Deux-Ponts-Bitche comme fief authentique, un tiers du château
et du domaine de "Wedisgesheim", près de la Sarre.
A partir de cette date, la famille de Bitche-Gendersberg n'aura
de cesse d'obtenir l'ensemble de la seigneurie soit par achat
ou par héritage.
13. Das Reichsland
Elsass-Lothringen" Tome III page 1187
14. Carl Pöhlmann, Die Herren von Bitsch gennant Gentersberg,
Kaiserslautern 1933, cité dans l'acte N°172 pages 159-160.
Simon de Bitche Gentersberg l'ancien et ses descendants choisirent
le château de Weidesheim comme résidence principale.
Il ne se refusa aucune dépense pour acheter les autres
parts des propriétaires de Weidesheim et ainsi être
le seul détendeur de la maison.
cliquez pour agrandir la charte
En l'an 1481, Simon Wecker, comte de Zweibrücken, seigneur
de Lichtenberg et de Bitche, arbitre sur une requête formulée
par les héritiers Sommer sur une partie de leurs propriétés
de Weidesheim et sur la construction du château par Simon
de Bitche dit de Gentersberg. L'arrangement stipule que la part
des Sommer soit payée par Simon à 100 florins. "A
Thomann von Rode appelé Sommer et ses héritiers
Enders von Ulingen appelés Lützelstein, Hugels Hansen
von Walschbronn et Sybille Sommer, en contre partie, Simon de
Bitche pourra à partir de ce jour disposer du château
de Weidesheim avec ses dépendances et achever les constructions
pour en user lui et ses héritiers".
Simon de Bitche acheta dès le 5 septembre 1481 la moitié
du quart de cette propriété au nobles Von Husen,
(famille qui n'a rien de commun avec les d'Hausen présents
au 18e siècle) mais le document s'est perdu, ou bien n'était-ce
qu'une promesse d'achat?. En tout cas, le 17 avril 1485, un autre
acte d'achat est concrétisé pour la moitié
de la part appartenant à une branche des d'Husen, Wendelin
de Salmbach, Lutzen Peters, fils de Oberbach, sa femme, une fille
de Gerhard von Husen, la propriétaire, et sa belle mère
Anna. L'autre moitié appartenait à une parente,
Agnès von Husen. Les trois quarts de cette part furent
achetés par Simon le 24 mai 1491 pour 55 florins.
Le donjon.
Enders von Ulingen appelé
Lützelstein aurait encore eu, à part la propriété
vendue en 1491 à Simon de Bitche, d'autres parts sur Weidesheim,
que sa fille aurait vendues pour 40 florins à Henri de
Huntingen ce que fit aussi Johann von Rode appelé Sommer.
Sur cet achat par Heinrich de Huntingen, Simon de Bitche demanda
son droit de préemption. Le 27 avril 1506 le Comte Reinhard
de Zweibrücken-Bitche jugea sur cette dispute de propriété
et demanda que les deux protagonistes jouissent ensemble de cette
propriété et que Simon de Bitche paye la moitié
de cet achat à Henri de Huntingen. Mais le 1er juillet
1513 Henri de Huntingen vend cette part avec profit à Simon
de Bitche.
Ce que la famille de Weidesheim possédait devait de nouveau
être partagé. Jean de Bitche racheta à ses
deux beaux-frères leurs parts, mais qui semblent être
inégales. En effet Hans von Sanct. Ingbrecht eut seulement
66 florins17 ½ tr, pour sa part, alors que Werner Gailing
von Altheim reçu 100 florins. Suite à cette dernière
transaction Jean de Bitche-Gendersberg fit dresser un acte de
propriété le 17 novembre 1550.
Hans von Sanct Ingbrecht ne reçut pas la même indemnité
que Werner Gailing von Altheim car il ne vendit pas toute sa part
d'héritage sur Weidesheim. Dix-huit ans plus tard, le 23
septembre 1568, Hans von St. Ingbrecht vendit ses parts des forêts
de Weidesheim à Anstatt de Bitche et à ses frères.
Du château remanié
à partir du milieu du 15e siècle, il reste la tour
qui s'apparente au type allemand du "Turmburg" : un
haut bâtiment, de plan massé, présentant quatre
niveaux d'ouvertures (15). Le château fut transformé
à la fin du 15e siècle par Simon le Vieux, seigneur
de Bitche dit Gentersberg et il fut encore modifié au 16e
siècle par ses successeurs (16).
15. Le pays
de Bitche (Moselle), Metz : Éditions Serpenoise, ("Images
du patrimoine", 80), p. 65.
16. HIEGEL Charles, "Hanviller, château de Gentersberg"
et "Kalhausen, château de Weidesheim", dans J.
CHOUX, Dictionnaire des châteaux de France. Lorraine : Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle, Vosges, Paris : Berger-Levrault, 1978, p. 111
et p. 128.

La tour.
Sur la façade sud-est, une tourelle d'escalier polygonale a été rajoutée sans doute au 16e siècle. Les façades et la tourelle sont percées de fenêtres à linteau trilobé. La tour comporte plusieurs éléments défensifs comme la bretèche au-dessus de l'entrée et plusieurs archères. Les dépendances remaniées en bâtiments agricoles sont dotées de trois canonnières doubles datant également du 16e siècle. Le château a donc été adapté à l'usage des armes à feu.
Trois canonnières doubles, faisant partie du système défensif, sont encore visibles dans les dépendances.
Les canonnières doubles.
Nous ne savons malheureusement rien du destin du château durant la Guerre des Paysans en 1525: le couvent de Herbitzheim, situé en amont sur la Sarre, a été pillé et utilisé comme base par une forte bande de paysans. Nous ne savons pas si Weidesheim a été attaqué à cette occasion.
La tour d'escalier à gauche.
La tour recèle un petit trésor sous la forme de peintures murales découvertes au cours du 20e siècle.
Ilona Hans-Collas, membre correspondant de l'Académie nationale de Metz est la première à avoir étudié ces peintures et à les replacer dans leur contexte historique. Les paragraphes qui suivent, reprennent une partie importante de son article publié en 2007 dans les Mémoires de l'Académie Nationale de Metz.(17)
Ces peintures assez dégradées se rapportent à la famille de Bitche-Gendersberg. Elles sont situées au premier étage, dans la partie haute de la salle rectangulaire. Il s'agit certainement d'une salle d'apparat. Les peintures étaient recouvertes d'un badigeon qui les a protégées; elles sont néanmoins en assez mauvais état. Elles encadrent une fenêtre du côté droit. La peinture à gauche de la fenêtre représente trois blasons avec trois cartouches portant les noms des seigneurs de Weidesheim:
Peintures murales dans la salle "d'apparat".
Peintures murales.
Dans le premier cartouche, il est possible de déchiffrer:
Irmengard
maucheim
eir von zwei
brucken
confirmant la généalogie donnée par Carl
Pöhlmann.
17. Ilona Hans-Collas
"Les décors peints du XVIe siècle dans les
demeures messines et lorraines : reflets de la vie artistique
et des courants humanistes de ce temps", Mémoires
de l'Académie nationale de Metz, CLXXXVIIIe année,
série VII, t. XX, 2007, p. 191-215.
Il s'agit de la première femme de Jean de Bitche-Gendersberg,
d'une fille du comte de Zweibrücken décédée
au plus tard en 1541.
"La dernière ligne se termine par un signe (nœud)
marquant une alliance. Ce cartouche est surmonté d'armoiries:
d'azur à trois fers à cheval 2 et 1 sommé
d'un casque à grille fermée. Notez que les cimiers
reproduisent les armoiries correspondantes.
Le second cartouche comprend le texte suivant:
"Hans von Bitsch
genannt
Gentersperg"
Il est surmonté d'un écu de sable au massacre de
cerf d'or à une molette d'argent (étoile) entre
les deux ramures, sommé d'un casque à grille fermée
avec le cimier du motif de l'écu.
Le personnage central est donc Jean IV de Bitche-Gendesberg, mort
avant le 16 août 1563. Sa première femme appartient
à une famille à laquelle il est déjà
lié:son arrière grand-père Frédéric
l'ancien avait épousé en 1432 Gutta Mauchenheimer
von Zweibrücken; la sœur de Frédéric,
Else, a épousé Cunz Mauchenheimer.
Jean s'est remarié avec
Margarethe Faust von Stromberg. Il apparaît vraisemblable
que la troisième partie a été rajoutée
lors de ce remariage: on remarque que les lettres du cartouche
sont légèrement plus grandes que les précédentes,
et que l'artiste a dû adapter la taille du cartouche à
l'espace qui lui restait à côté de l'ouverture
de la fenêtre.
Donc pour le troisième cartouche, on peut compléter
le texte grâce à l'écu qui le surmonte:
"Marg[areta]
geborne [Faust]
von Strombe[rg]"
Les armoiries qui surmontent ces lignes se lisent ainsi: échiqueté
d'or et de gueules de 4 tires, sommé d'un casque à
visière fermée, cimier à bonnet échiqueté
de 2 tires entre deux pennons adossés, bordés chacun
de deux rangs de 4 billettes en fasce; molette (étoile)
entre les pennons."
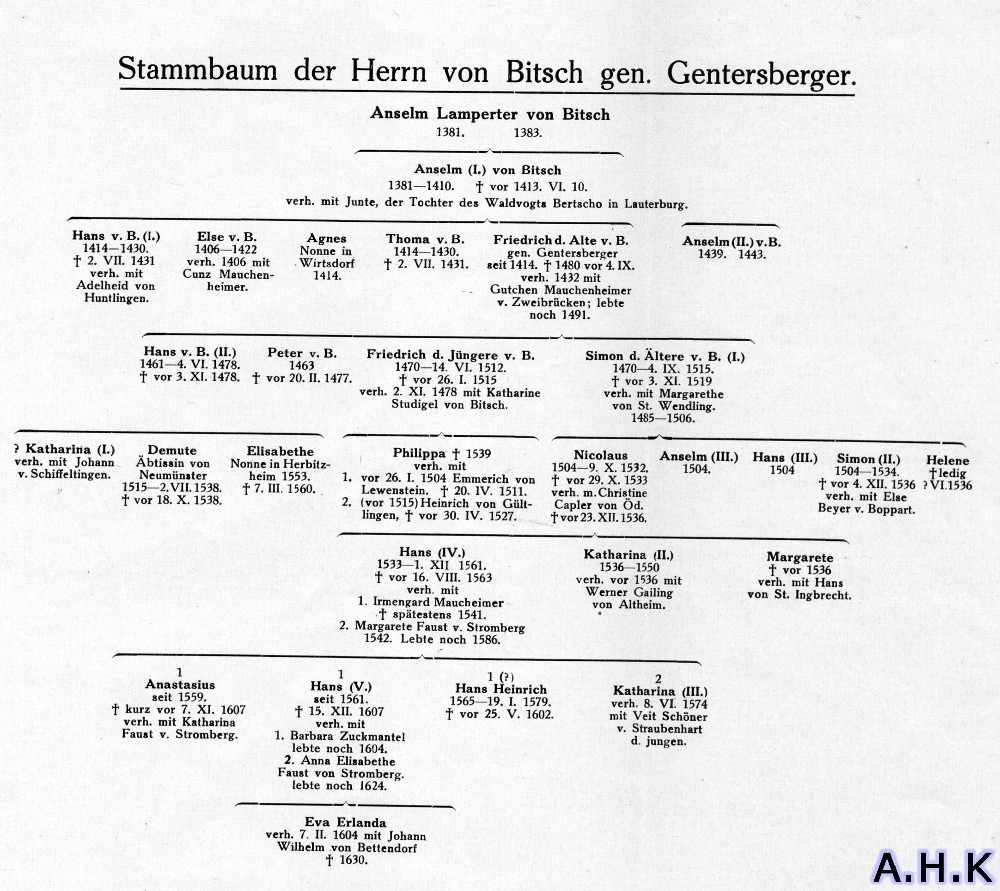
Cliquez pour agrandir le tableau
Généalogie des Bitche Gendersberg.
voir: Carl Pöhlmann: Die Herren von Bitsch gennant Gendersberg
Au moins cinq lignes de texte sont présentes en-dessous des cartouches mais elles n'ont pas encore pu être déchiffrées.
Peintures murales.
D'autres cartouches, à droite de la fenêtre, comportent
des textes en vieil allemand (Frühneuhochdeutsch).
La lecture de ces inscriptions est assez difficile.
Un texte comporte un contenu très moralisateur: il exhorte
à ne pas mépriser son prochain, à ne pas
lui nuire et à porter un regard critique sur soi-même.
Voici la lecture qu'en donne Ilona Hans-Collas:
"Veracht nie mich und
die meinen bescham zuvor dich und die.
Deinen .. an dich und nicht mich thu(e) (ich) unrecht (so) (hiete)
dich be..n.
nicht der genug ist ob du schon gleich was woll (gestellt) bist
(deiner Laune)
nicht wie du mich (siest) wer weiß ob du selber from bist
laß (dich deine)
zung nicht betrugen deiner neig…(entschluß uberlegen
soll) der zung
und in allen laß an gott und deine(n) naechsten …en
laß ich …
eur thue di[ch] (unrechten) so wirt was selber du …(preisen
was)…"
Peintures murales.
"Sur le mur sud, une scène montre une femme devant
un ours qui joue de la cornemuse. Deux cartouches contenant les
textes explicatifs se situent de part et d'autre de la scène.
Grâce à une gravure allemande, extrêmement
proche de la peinture murale, le sens de l'image et le contenu
du texte, plutôt difficile à déchiffrer sur
la peinture, peuvent être reconstitués." Selon
Ilona Hans-Collas:
Le texte à gauche :
"Den Pererm kan ich
machen
dantzen : mit wunder seltzamen
krammantzen : bald ich im den
Ring bring in die Nasen : so fur
ich in mit mir alle Strassen und mach
mit im [me]in Affenspiel er mu[sz]
mir dantzen wie ich wil."
Voici une proposition de traduction
moderne pour ce texte:
"L'ours, je peux le faire danser
lui faire exécuter des tours étonnants
lui mettre un anneau dans le nez
L'emmener sur toutes les routes
lui faire faire des singeries
il doit danser selon ma volonté"
Le texte à droite :
"Ich armer [Ba]er
waß zei[g] ich mich
das ich also laß dr[e]-
beb [mich] ich muß
mein [da]ntz m[i]r
selber [pf]eiffen ma(n)
thut mir offt in die
[w]olle greiffen."
"Pauvre de moi, ours
Comment je me montre
Comme un ours apprivoisé
Je suis obligé
De jouer moi-même
La musique pour ma danse
L'on m'attrape souvent
Par ma fourrure"
"La gravure sur bois qui
a permis l'identification de la scène et des inscriptions
peut être datée de 1543 ." (18)
18. M. GEISBERG, The german single-leaf woodcut : 1500-1550, édition
revue et corrigée par W. L. Strauss, New York : Hacker
Art Books, 1974, t. IV, p. 1543. Cette gravure sur bois (appartenant
à la catégorie appelée en allemand Flugblatt
ou Einblattdruck, en anglais single leaf cut), est conservée
au cabinet des estampes, Schlossmuseum, à Gotha (Inv. Nr.
: 39,38 (ancienne cote : Xyl. II. 175)) ; le graveur est inconnu.
(Note rédigée par I. Hans-Collas)
"Le texte placé à droite de l'image gravée,
en réalité, un dialogue entre les deux protagonistes
de la scène, n'est que partiellement repris sur la peinture
murale. Ce texte rimé, un poème narratif, comprend
trente vers : quinze vers pour la femme intitulée "meneuse
d'ours" (Die Berndreyberin) et quinze vers pour l'ours
(Der Ber spricht)
(19). La planche gravée
est signée en bas du texte du nom de son éditeur,
Anthony Formschneyder (20), alors que le texte peut être
attribué au poète allemand Hans Sachs (né
à Nuremberg en 1494 et mort dans cette même ville
en 1576), dont l'œuvre est considérable (21).
Tous les genres littéraires qu'il aborde dégagent
une morale, simple et pragmatique, sur la coexistence paisible
de l'homme avec ses semblables."
"Ces premiers vers de chacune des figures du poème
de Hans Sachs suffisent pour rendre la scène compréhensible
: la femme dit qu'elle "peut faire danser l'ours, lui mettre
l'anneau dans le nez pour l'emmener sur les routes", tandis
que l'ours se plaint de devoir faire la musique pour sa propre
danse."
Nous pouvons très bien imaginer que lors d'une cérémonie
de mariage, les seigneurs de Weidesheim aient fait appel à
une troupe de gens du voyage qui peuvent avoir amené un
ours dressé. Un tel spectacle a peut-être été
donné au château.
Ilona Hans-Collas cite un exemple d'une troupe de gens du voyage
à Metz en 1504. (22)
Il paraissait véritablement extraordinaire pour le peuple
de cette époque de dresser un animal sauvage pour réaliser
des tours. Ces gens du voyage étaient souvent originaires
de "Honguerie" (Hongrie). Sur l'image, le plantigrade
semble porter une coiffe, le rendant peut-être plus "humain"
ou plus ridicule. Car l'on joue sur deux tableaux: il s'agit à
la fois de présenter un spectacle humoristique avec un
ours, mais aussi, dans le contexte des œuvres de Hans Sachs,
de se moquer des contemporains souvent amenés à
"faire l'ours pour quelqu'un". C'est-à-dire être
au service d'un personnage en se faisant mener par "le bout
du nez" ou comme le veut l'expression employée ici:
"se faire mettre un anneau dans le nez".
L'ours considéré dans la mythologie européenne
ancienne comme le roi des animaux a perdu ce statut au profit
du lion, devenant une figure que l'on peut ridiculiser d'autant
plus facilement que le plantigrade a une silhouette anthropomorphe.
Les seigneurs de Weidesheim connaissaient donc des textes de Hans
Sachs, leur contemporain; ses poèmes les ont inspirés
pour demander à un artiste d'illustrer ce qui était
vraisemblablement une salle d'apparat. Cette salle évoque
à la fois leur famille avec les blasons, leur attachement
aux valeurs chrétiennes avec le texte de morale et offre
un divertissement avec la montreuse d'ours.
19. A. v. KELLER, E. GOETZE,
Hans Sachs, t. 22, Tübingen : Bibliothek des litterarischen
Vereins in Stuttgart, 1894, p. 281-282 (le poème est daté
du 3 mai 1543).
20. Antony Formschneider der Ältere, également connu
sous le nom de Antony Corthois, était né à
Montauban (France) vers 1500 et mort après 1560 à
Heidelberg. En 1535, il arrive à Augsburg où il
prend le nom de sa profession comme nom de famille. Il est éditeur
et imprimeur à Augsbourg, à Francfort sur le Main
et à Heidelberg (H. Gier, J. Janota (ed.), Augsburger Buchdruck
und Verlagswesen von den Anfängen bis zur Gegenwart, Wiesbaden
: Harassowitz Verlag, 1997, p. 1222).
21. Plus de 6000 titres dont environ 4200 "Meistergesänge",
environ 1800 poèmes narratifs ("Spruchgedichte"),
80 Jeux de Carnaval ("Fastnachtsspiele"), 63 tragédies,
65 comédies et 5 dialogues en prose (Bibliotheca Augustana
: http://www.fh-augsburg.de).
22. J. F. HUGUENIN, Les chroniques de la ville de Metz, recueillies,
mises en ordre et publiées, pour la première fois,
Metz : Lamort, 1838, p. 645-647. Le chroniqueur cite également
l'exemple d'un mariage fêté à Metz lors duquel
un tel spectacle fut donné dans une salle. (Notes rédigées
par I. Hans-Collas.)
Peintures murales.
Au milieu du 16ème siècle
de nombreux documents attestent que la famille Bitche Gentersberg
vivait à Weidesheim.
Ainsi, le comte Jean de Nassau-Sarrebruck s'engage le 19 mai 1559
à s'acquitter à Weidesheim des dettes qu'il devait
à Jean de Bitche-Gentersberg.
Catherine de Bitche-Gentersberg célèbre son mariage
à Weidesheim le 8 juin 1574 avec Veit Schöner von
Straubenhard.
Le 22 juin 1582,(23) les Sieurs Anstett Hansen et Jean Henry
de Bitche-Gentersberg firent appel au duc Charles de Lorraine
et de Bar, pour un litige de limite entre les terres de la seigneurie
de Weidesheim et le ban d'Achen. Le duc envoya une commission
pour régler l'affaire en la personne du Sieur Guillaume
Crantz de Geispolsheim, grand Bailli dans la Lorraine Allemande,
ainsi que le sieur Gall Tuschlin, docteur en droit et conseiller
de son altesse sérénissime. La commission définit
les limites en faisant poser des bornes entre la limite des bans
en commençant par le pré au-dessus du moulin d'Achen,
remontant le chemin jusqu'au petit ruisseau dit "Weinbach"
jusqu'au lieu dit "Klinchen ou Brücken" ensuite
en remontant jusqu'au four à chaux pour aller jusqu'à
la fontaine appelé "fontaine noire" et descendre
le petit ruisseau jusqu'au fossé profond qui descend et
qui sépare le ban de Weidesheim de celui de Wittring et
d'Achen.
Et le 21 octobre 1601 l'intendant de la Cour de Justice Impériale
confirme aux frères Anstadt et Jean l'administration civile
des biens du domaine de "Wetzen".(24)
En tout cas les nobles de Bitche-Gentersberg devinrent propriétaires peu à peu des trois quarts de Weidesheim, d'après le registre des censes de Bitche de 1570.
