Mécanisation et motorisation agricoles
Sommaire
Introduction
1. Les progrès agricoles en général
2. Conséquences de la mécanisation et de la motorisation agricoles
3. Les progrès dans des domaines particuliers
3.1. La préparation des sols
- le labour
- l’ameublissement du sol
3.2. Les semailles
3.3. La fenaison
3.4. La moisson
3.5. Autres travaux
- L’entretien des cultures
- Les récoltes d’automne
- Les transports
- Le nourrissage des bêtes
- La traite des vaches
- Le sciage du bois
- Le jardinage
4. Les moteurs inanimés
4.1. Les motoculteurs
4.2. Les tracteurs après 1940
4.3. Les premiers tracteurs de Kalhausen
- La décennie 1950-1960
- La décennie 1960-1970
4.4. Le tracteur au village :-anecdotes
5. L’avenir des machines anciennes
Conclusion

Dans l’Antiquité, le travail de la terre était avant tout manuel : les travaux préculturaux, puis les semailles, la moisson, la fenaison et les récoltes se faisaient à la force des bras et nécessitaient une main d’œuvre importante. Les outils employés étaient rudimentaires.
Souvent toute la famille, enfants, adultes et vieillards, devait se mobiliser dans la mesure du possible, pour effectuer les différentes tâches. Les grands travaux (1), tels les labours, les semis, la fenaison et la moisson, y compris le battage, étaient longs et pénibles.
Le paysan était la seule "machine" utilisée, ses muscles les "organes moteurs" et ses mains des "porte-outils".
L’utilisation de l’animal de trait comme "moteur animé" a permis l’emploi de quelques machines agricoles et a contribué à diminuer la fatigue musculaire de l’homme. Pendant longtemps, les progrès mécaniques ont été insignifiants et ce n’est qu’au 19° siècle, avec l’avènement de la machine à vapeur,
puis des moteurs à explosion et à combustion interne et de l’électricité que des avancées seront possibles.
La mécanisation fera de grands pas après 1918, dans les grandes plaines françaises, mais les petites exploitations de nos régions ne seront vraiment concernées qu’après 45.
Le tracteur agricole s’imposera aussi après guerre, à partir des années 50, au détriment de la traction animale. Les machines agricoles ne cesseront plus de se perfectionner et le tracteur de l’an 2000 n’a plus beaucoup à voir avec son ancêtre de 1920.
Aujourd’hui, suite à la révolution mécanique de l’agriculture, on demande à l’agriculteur de moins en moins d’efforts musculaires, mais de plus en plus d’efforts intellectuels. De nouvelles machines sont de plus en plus utilisées : les ordinateurs, les robots, les satellites, les drones…
C’est l’histoire de la mécanisation, de la motorisation et de la modernisation des exploitations agricoles de nos villages, prises dans leur globalité, mais aussi au niveau de Kalhausen, que cette étudie se propose de décrire.
_________________________
(1). L’agriculture est une suite de travaux en pointe, c’est-à-dire de travaux de longue haleine, souvent pénibles, devant être réalisés au moment opportun et dans un laps de temps réduit pour ne pas gâcher le résultat. Toutes les opérations doivent être exécutées dans les meilleures conditions
et dans des périodes relativement courtes.
1. Les progrès agricoles en général
Dans l’Antiquité et au Moyen-Age, les travaux agricoles se font exclusivement grâce à la force humaine ou animale qui fournit l’énergie nécessaire. (2) L’équipement est rudimentaire et se limite aux outils manuels et à quelques rares machines agricoles comme le charriot, la herse, l’araire. Les travaux agricoles sont avant tout manuels.
 |
 |
Labour et semailles au temps féodal.
L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, publiée entre 1751 et 1772, répertorie les machines agricoles suivantes : la charrue à versoir et avant-train, la herse, le rouleau brise-mottes et deux sortes de semoirs, l’un à traction animale et l’autre à pousser.

Planche extraite de l’Encyclopédie et montrant la charrue ordinaire,
le semoir de l’abbé Soumille, la herse et le rouleau ou brise-mottes.
________________________
(2). Un homme de poids moyen peut fournir à la traction directe un effort moyen soutenu de 15 kg et son effort maximum momentané peut presque atteindre son poids.
L’Encyclopédie énumère également les outils à main utilisés : la bêche, la cognée, la faucille, la faux, le fléau, la fourche, la houe, le pic, la pioche, le plantoir, le râteau, le van, le crible à pieds.
Depuis l’invention de la faucille, premier outil agricole, les progrès mécaniques ont été rares, la productivité n’a pas beaucoup augmenté et la pénibilité du travail n’a guère diminué. Une très longue période de stagnation a empêché l’agriculture de faire sa révolution.
Ainsi la mécanisation est encore peu développée au 18° siècle, bien que l’invention du semoir date de 1701 (Jethro Tull, agronome anglais) et que le principe du battage mécanique ait vu le jour en 1784 (Andrew Meikle, ingénieur écossais). Le tarare est aussi attesté dès le 18° siècle.

Semoir mécanique à trois rangs de Jethro Tull.
(lessignets.com)

La batteuse de Meikle, dont on voit le principe,
était mise en mouvement par la force hydraulique
(en bas) ou par un manège (en haut).
(www.britannica.com)
Les raisons de ces difficultés sont multiples : en premier lieu, le bois a pendant longtemps la prépondérance sur le fer et ne permet pas de mettre en pratique certaines idées, ensuite l’absence de moteur limite l’utilisation de certaines machines, enfin le monde agricole ne dispose pas de grosses propriétés, donc de moyens financiers suffisants pour investir.
Un recensement effectué en 1930 par le Ministère de l’Agriculture nous donne un aperçu de la surface cultivée et de l’importance des exploitations agricoles de Kalhausen.
Pour un total de 180 exploitations dans la commune, 91 sont comprises entre 0 et 2 ha, 76 autres comptent entre 2 et 10 ha, 10 autres sont comprises entre 10 et 20 ha et une seule compte entre 20 et 30 ha. Les 2 fermes de Weidesheim comptabilisent chacune entre 100 et 200 ha de terres cultivées.
 |
La révolution industrielle du 19°
siècle et l’avènement de la machine à vapeur permettent à l’agriculture
de commencer sa propre révolution. Les moteurs thermiques à explosion
et à combustion interne et les moteurs électriques prennent ensuite le
relais de la vapeur. Mais la mécanisation et la motorisation
(3) se
développent tardivement en France, toujours à cause de la surface
restreinte des exploitations et du manque de fonds pour
l’investissement. L’animal demeure donc la source principale d’énergie
jusque vers le milieu du 20° siècle.
_____________________
(3). La mécanisation est le fait d’utiliser la machine pour effectuer des travaux, alors que la motorisation est l’emploi d’un moteur pour faire avancer ou actionner une machine. L’homme peut être considéré comme le premier moteur animé, capable de porter des charges, de tracter une machine, de la pousser ou de la faire fonctionner grâce à une manivelle. L’animal le remplacera ensuite dans la traction directe, dans le transport de charges au moyen de bâts et dans la mise en mouvement de machines grâce au manège. Les moteurs inanimés sont les moteurs hydrauliques, éoliens, électriques et thermiques (à vapeur, à explosion, à combustion interne) capables de faire fonctionner des machines.
Longtemps, l’agriculture reste ainsi tributaire de la traction animale, avec comme conséquences une limitation forcée des efforts demandés aux bêtes et une vitesse d’avancement réduite. La traction animale demeure donc un handicap majeur pour l’augmentation de la productivité. Elle n’est pourtant pas
un frein à la mécanisation, puisque pratiquement toutes les machines agricoles sont actionnées à l’origine par un attelage de chevaux ou de bovins. La mécanisation agricole est un long cheminement, fait d’inventions révolutionnaires et de mises au point.
Elle fait des progrès considérables au cours du 19° siècle, surtout aux Etat-Unis, mais aussi en Europe et de nombreuses machines d’intérieur de ferme sont créées pour faciliter le travail agricole. Parmi ces machines, citons pêle-mêle le hache-paille, le coupe-racines, l’égraineuse, le concasseur de grains, l’écrémeuse, le manège à chevaux.
Toutes ces machines sont actionnées grâce à l’énergie humaine ou animale et représentent déjà un gain important dans le domaine de la rentabilité.
Publicité Lanz pour diverses machines d’intérieur de ferme
actionnées par la force humaine (au moyen d’une manivelle) ou animale (au moyen d’un manège).
Tracteurs Lanz Bulldog de Pierre Bouillé et Bernard Salvat Edition EBS
De nombreux artisans et industriels se lancent au cours du 19° siècle dans la fabrication de telles machines : Lanz, en Allemagne, Deering, Mac Cormick, Case aux Etats-Unis, Braud et Célestin Gérard en France. Plus près de nous, Joseph Kuhn fonde en 1828 la société de machines agricoles Kuhn basée à Saverne et construit des bascules. En 1864, il se lance dans la fabrication de batteuses. (4)
___________________
(4). Les Etablissements Kuhn fabriqueront aussi des presses à paille, des faucheuses, des râteaux-faneurs, des faneuses à fourches, des motofaucheuses et des machines d’intérieur de ferme comme des coupe-racines, des coupe-paille, des broyeurs à pommes, des fouloirs à raisin et des pressoirs à vin.

1939. Almanach Agricole d‘Alsace et de Lorraine
D’autres machines ou outils sont perfectionnés, comme la charrue, améliorée par l’agronome lorrain Christian Mathieu de Dombasle en 1820, puis par le forgeron Jean Baptiste Hamant de Rodalbe en 1865.
Ce dernier invente un système de fixité permettant de ne plus tenir les mancherons de la charrue pendant le labour. Cette charrue était très répandue dans la région.

Charrue brabant simple Hamant.
Parc animalier Sainte Croix de Rhodes.
Le 19° siècle voit aussi l’apparition de la moissonneuse Mac Cormick brevetée en 1834, de la moissonneuse-batteuse brevetée également en 1834, de la javeleuse, en 1858, puis de la moissonneuse-lieuse en 1877. Ce sont exclusivement des machines destinées à la traction animale, des machines traînées, animées par une roue motrice roulant sur le sol.
La batteuse est inventée en 1842 et Célestin Gérard construit la première batteuse mobile de France en 1866 à Vierzon, devenant le premier entrepreneur de travaux agricoles.

Moissonneuse Mac Cormick. Vue plutôt comme une curiosité,
elle eut du mal à s’imposer. Elle présente pourtant déjà les principes
des moissonneuses-lieuses futures : lame à mouvement alternatif,
table de récupération des épis, roue motrice unique, moulinet-rabatteur

Moissonneuse-batteuse Harvester et Haeder et
son attelage de 35 chevaux en action sur un grand domaine américain.
Les égraineuses sont actionnées grâce à la force humaine ou animale et les batteuses uniquement grâce à l’énergie animale. Un manège ou un tapis roulant appelé trépigneuse permet leur mise en fonction. Des installations de manèges sont attestées avant 1939 à Kalhausen, notamment dans la ferme Holtzritter de la rue des jardins (Brùchbrùnnersch), dans la ferme Neu et la ferme Koch de la rue de Schmittviller et chez le charron Kihl pour le sciage du bois. (renseignement fourni par Adolphe Lenhard)
 |
 |
(fr.wikipedia.org)

Annonce de la vente aux enchères du 6 juin 1859
et concernant la seconde ferme de Weidesheim.
La coupure de journal ci-dessus nous donne un aperçu des machines agricoles en usage au milieu du 19° siècle dans une des 2 fermes de Weidesheim, écart de Kalhausen.
La mécanisation se limite à peu de choses : des charrettes, des charrues, des herses et une machine à battre. Quelques "instruments aratoires" sont aussi mentionnés, certainement des houes, des pioches, des faux, des râteaux …ainsi que des vans avec "d’autres objets de battage", sans doute des fléaux. Les vans ne sont sûrement pas des paniers à vanner, mais des tarares.
C’est dire que pratiquement tout le travail reste encore manuel : la fenaison, la moisson, le nettoyage des céréales après le battage. La seule mécanisation concerne les transports et le travail de préparation du sol (charrue), les semailles (herse) et le battage des céréales. Quelle est alors
"cette machine à battre" utilisée ? L’égraineuse actionnée à la force des bras ou grâce à un manège, ou déjà une batteuse ? En tout cas, la mécanisation reste rudimentaire, même pour une grande ferme. Il est vrai que de nombreuses personnes travaillaient à l’année dans les fermes et que des journaliers issus des villages environnants étaient embauchés ponctuellement pour les travaux en pointe.
Pour les grands exploitants du village, les laboureurs, appelés "Pèèrdsbuure", la mécanisation devait être presque la même en ce milieu du 19° siècle (charrette, charrue, herse, mais sans la batteuse). Les plus petits exploitants, les journaliers, appelés "Kìhbuure", ne possédaient sans aucun doute
pas ces machines et devaient se contenter de leurs outils manuels et de l’aide des laboureurs, au service desquels ils se mettaient.
Dans nos régions, ce sont principalement les chevaux des laboureurs et les vaches des journaliers qui permettent la mise en œuvre des rares machines agricoles : la charrue, la herse, la charrette et plus tard le manège qui permettra d’actionner la batteuse.
Les bœufs, utilisés dans d’autres régions de France, sont rares dans nos contrées. Je connais un seul cas, à Herbitzheim, celui de Léon Rondio, qui a utilisé un attelage de bœufs, jusque dans les années 70. Des associations hétéroclites sont aussi parfois le cas, mais elles restent elles aussi rares : à Herbitzheim, Paul Becher utilisait un cheval et un âne baptisé "Loulou".
Un grand pas est ensuite fait dans le machinisme agricole avec la motorisation de ces machines, c’est-à-dire avec le remplacement de la force humaine
ou animale par la force mécanique. L’utilisation du moteur thermique, puis électrique apportera puissance et vitesse.
C’est tout d’abord l’utilisation de la vapeur comme source d’énergie qui se développe. Dans les grandes fermes, après 1870, la locomobile ou chaudière à vapeur déplaçable sert à actionner les batteuses, mais les animaux sont toujours là pour tracter l’ensemble batteuse-locomobile de ferme en ferme.

Chantier de battage avec locomobile.
Batteuse Merlin et table de liage.
(Photo Delcampe.net)
Batteuse Merlin et table de liage.
(Photo Delcampe.net)
Les longues courroies plates sont le plus souvent croisées pour obtenir le bon sens de rotation, mais aussi pour qu’elles bougent moins et aient une meilleure adhérence sur les poulies. L’utilisation occasionnelle de poix (Bèsch) améliore également l’adhérence.
Les locomotives routières, qui sont des machines à vapeurs automotrices, prennent le relais et permettent non seulement d’actionner les batteuses, mais aussi de les déplacer et même de labourer grâce à un système de treuil à câble (système Fowler).
 |
 |
Dans cette configuration, 2 locomotives à treuil,
placées à chaque bout du champ, font avancer une charrue-balance.
(Photos afrplumaugat.over-blog.com)
placées à chaque bout du champ, font avancer une charrue-balance.
(Photos afrplumaugat.over-blog.com)
L’utilisation du système appelé "Fowler" (du nom de la firme anglaise de locomotives) est mis en œuvre dans les grandes plaines sur des chantiers de labourage. Il comprend 2 locomotives-treuils à vapeur de 180 CV et une charrue-balance à 4 socs. Le personnel du chantier se compose de 7 ouvriers
(un chef de chantier, 2 chauffeurs, un cuisinier, 2 hommes de manœuvres dont l’un est sur la charrue et l’autre derrière, et 1 homme à tout faire). Le personnel est généralement logé dans des roulottes.
La surface labourée en une journée de 10 heures de travail peut atteindre 6 ha.
Ces types de machines, lourdes à mettre en œuvre, nécessitant beaucoup de personnel et d’un poids important (parfois plus de 20 t) sont rares en France à cause surtout de la taille des exploitations. Tout au plus la locomobile est-elle utilisée comme moteur fixe pour actionner les batteuses jusqu’après la Première Guerre Mondiale.
 Tracteur-locomotive Case 20 de 1898. |
 Locomotive routière Burrell and Sons de fabrication anglaise. |
( Attelagesbovinsdaujourdhui.unblog.com)

Machine à bêcher derrière une locomotive Fowler. 1900
(Mototracteurs.forumactif.com)
Un recensement fait par le Ministère Belge de l’Agriculture et des Travaux Publics en 1910 classe dans l’ordre décroissant les machines les plus utilisées entre 1895 et 1910 dans les exploitations agricoles :
la herse, le tarare, la charrue, la baratte, le rouleau, l’écrémeuse et enfin la batteuse.
Ce classement peut facilement se transposer en France, où les exploitations sont de taille identique. Il n’est pas encore question de faucheuse, ni de moissonneuse et encore moins de tracteur.
La mécanisation de l’agriculture française est donc à cette époque déjà assez avancée dans la plupart des grandes fermes, mais la motorisation n’est
pas encore beaucoup développée.
 Planche extraite de l’encyclopédie « Meyers Handlexikon » de 1912. Beaucoup de ces machines ne seront utilisées dans nos campagnes qu’entre les deux guerres mondiales. Du haut vers le bas et de gauche à droite : - faneuse à fourches (7) et déterreuse de betteraves (6) - moissonneuse-lieuse (1) et arracheuse de pommes de terre (2) - moissonneuse-javeleuse (4), faucheuse (5) et râteau andaineur (3) - râteau à cheval (8) et arracheuse de betteraves (9) |
Vers la fin du 19° siècle, une mutation importante a lieu avec l’avènement du moteur à explosion qui va concurrencer le moteur à vapeur et le supplanter peu à peu grâce à une consommation moindre et donc un rendement plus élevé.
En 1900, à puissance égale, un moteur à vapeur consomme 10 fois plus de combustible et 40 fois plus d’eau. De plus, là où 2 ou 3 hommes s’occupent d’une machine à vapeur, un seul suffit pour conduire cette nouvelle machine à moteur à explosion, appelée désormais tracteur.
Les premiers tracteurs à essence apparaissent vers 1892, mis au pont par la société Case, aux Etats-Unis. Ils sont importés en France en 1894, lors d’un concours agricole et produits en petite série dès 1906.
Ce sont encore des machines imposantes, utilisant la structure des locomotives routières et qui, pour les mêmes raisons évoquées plus haut, ne s’imposent pas en France.

Le tracteur Sawyer-Massey 20-40 fut construit au Canada de 1910 à 1925.
Le moteur à pétrole, refroidi par eau avec l’aide d’un radiateur
et d’un ventilateur, démarrait à l’essence.
La direction se faisait par chaîne. La mise en route restait fastidieuse.
Un tel engin pesait un peu plus de 5 t.
Après 1918, la remise en état de vastes régions françaises, dont les cultures avaient été abandonnées pendant la durée de la guerre, surtout dans le Nord, exige une motorisation d’urgence. Quelques 1 200 tracteurs sont importés des Etats-Unis pour cette opération sous les marques Mogul, Case, Emerson, Titan (Mac Cormick), Avery, Cleveland… Des constructeurs français fournissent aussi des tracteurs : Tourand-Latil, Renault, Filtz, Agro, Somua, Laffly, Delahaye, Lefebvre, Doizy, Scemia…(5)
___________________
(5). 30 constructeurs de tracteurs sont recensés en 1919 en France.
Ces tracteurs ne sont plus tous de grosses machines, mais des engins de la taille d’une automobile ou d’un camion, plus adaptés aux exploitations européennes.
 Tracteur Titan Mac Cormick 10-20 construit de 1915 à 1922. Notez la roue guide dans le sillon. vieilles-soupapes.grafbb.com |
 Tracteur Mogul 8-16 construit entre 1914 et 1917 par la International Harvester Company et animé par un monocylindre à pétrole lampant. vieilles-soupapes.grafbb.com |
 Le tracteur Lefèbvre, présenté en 1913, est un engin original dérivé du camion et doté de 2 roues avant directrices et 2 roues arrière motrices. Une paire de chaînes qu’on peut abaisser ou soulever à volonté permet une meilleure adhérence. mototracteurs.forumactif.com |
 Publicité pour le tracteur Tourand-Latil de 1918, déjà équipé d’une charrue relevable par câble. moulin.chauffour.free.fr |
Désormais, un véritable engouement pour ce type d’engin a lieu en France. Les premiers salons de la machine agricole font leur apparition à Paris,
des "semaines de motoculture" et des démonstrations de "culture mécanique" sont organisées dans la région parisienne et dans le Nord.
La publicité apparaît dans les revues spécialisées et les almanachs et vante les mérites de la mécanisation et de la motorisation.

 |
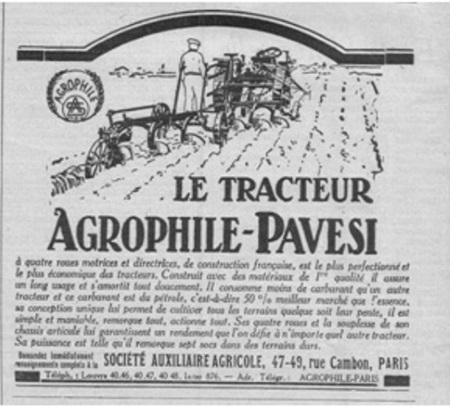 |

Publicité extraite de la revue Vie à la campagne (mars 1922).

Photo d’un rare Orenstein und Koppel SA 751 ou MBA produit à partir de
1938 en Allemagne.
Le moteur est un bicylindre de 30 CV refroidi par eau.
Ce tracteur appartenait à l’oncle d’André Neu, demeurant à Rahling.
Le moteur est un bicylindre de 30 CV refroidi par eau.
Ce tracteur appartenait à l’oncle d’André Neu, demeurant à Rahling.
(Photo André Neu).

Le tracteur International 8 -16 est introduit en France en 1920.
Doté de 3 vitesses AV et d’1 vitesse AR, il a un moteur 4 cylindres à essence ou à pétrole.
Il est refroidi par eau, par thermosiphon. Doté en série d’une poulie de battage,
il affiche 8 CV à la barre et 16 à la poulie.
La prise de force est en option.
(Photo André Neu).
Doté de 3 vitesses AV et d’1 vitesse AR, il a un moteur 4 cylindres à essence ou à pétrole.
Il est refroidi par eau, par thermosiphon. Doté en série d’une poulie de battage,
il affiche 8 CV à la barre et 16 à la poulie.
La prise de force est en option.
(Photo André Neu).
Le tracteur est désormais unanimement doté d’un moteur pour carburant dérivé du pétrole et ressemble par son aspect et sa taille à une voiture automobile ou à un camion. Son usage reste cantonné pourtant dans les grandes exploitations de plaine et son rôle est de remplacer un peu le cheval
et d’actionner la batteuse.
L’apparition de l’électricité après la 1ère guerre mondiale permet également de motoriser, à l’intérieur de la ferme, certaines machines fixes comme le concasseur de céréales, la batteuse ou la déchargeuse à griffe. Cette fonction de source d’énergie fixe, remplie par le moteur électrique, est très souvent aussi dévolue au tracteur ou à des moteurs stationnaires spécifiques sur roues, pour actionner les batteuses et scies à ruban.

Publicité parue dans l’Almanach Agricole d’Alsace et de Lorraine
de 1939 pour les établissements Brenckmann et Jittel de Colmar
qui se font fort d’une expérience de plus de 30 ans et de plus de
14 000 installations de déchargeuses.
Ils proposent aussi des faucheuses, des lieuses, des râteaux andaineurs,
des faneuses, des coupe-paille, des coupe-racines, des charrues,
des batteuses, des machines à traire, des centrifugeuses, des barattes, etc…
Mais le monde paysan reste très conservateur. La motorisation de l’agriculture a du mal à s’imposer en France, contrairement à d’autres pays, comme les Etats-Unis. Et c’est précisément pendant cette période de l’entre-deux guerres que des progrès essentiels sont réalisés, notamment l’apparition et le développement du pneu (1932), l’emploi croissant des prises de forces installées sur les tracteurs et l’utilisation du "mazout" comme carburant.

Publicité Lanz
Tracteurs Lanz Bulldog de Pierre Bouillé et Bernard Salvat Edition EBS
Le parc de tracteurs agricoles ne compte qu’environ 30 000 unités à la veille de la Seconde Guerre Mondiale. Les progrès du tracteur agricole sont évidents, mais le seul moteur valable dans les champs reste la traction animale et plus particulièrement le cheval. Le cheval est nettement préféré
au tracteur pour la plupart des travaux culturaux. (6)
Un recensement effectué en décembre 1924 par l’Office de la Statistique d’Alsace et de Lorraine de Strasbourg recense non moins de 35 chevaux dans le village, répartis entre 15 exploitations, principalement celles des laboureurs. Parmi ces agriculteurs, 6 élèvent 3 chevaux, 7 en ont chacun 2 et 2 n’en possèdent qu’un (il s’agit du boulanger Nicolas Fabing qui utilise un fourgon hippomobile pour sa tournée de pain et du forgeron Jacques Lett qui a un petit train de culture complémentaire à son activité de forgeron).
Il faut ajouter au nombre de chevaux les 47 comptabilisés à Weidesheim et appartenant aux métayers Greff (15) et Muller (26), ainsi qu’à 3 autres résidants (6). Le nombre total de chevaux se monte par conséquent à 82 pour la commune de Kalhausen.
Les autres exploitations agricoles, celles des journaliers, sont au nombre de 82. Ces petits exploitants élèvent des bovins, mais n’ont pas forcément des vaches de trait, car ils peuvent s’associer à un voisin ou à un membre de la famille pour les transports et les travaux réservés à un attelage. Seules, 20 familles n’élèvent pas d’animaux de trait (ni chevaux, ni bovins, mais seulement des caprins et des porcins).
 |
__________________
(6). En 1938, 19 fabricants de tracteurs sont recensés en France, dont Renault, le plus important, Latil et la Société Française de Vierzon qui fabrique des semi-diesels. On compte environ 35 000 tracteurs en utilisation contre 26 800 en 1929.

Recensement de l’agriculture du 1er avril 1930
Les résultats de ce recensement englobent les exploitations du village et les fermes de Weidesheim. Ainsi certaines machines recensées ne peuvent exister dans les exploitations du village, à cause de leur faible superficie. C’est le cas notamment de la charrue polysocs (à 2 socs sans doute et adaptée aux terres sablonneuses du "Bännche"), des rouleaux crosskill, des semoirs mécaniques, des distributeurs d’engrais, des arracheuses de pommes de terre, des râteaux à cheval, des moissonneuses-lieuses.
Beaucoup d’exploitations pourtant sont pourvues d’une pompe et d’une tonne à purin, d’une faucheuse mécanique, d’une batteuse et d’une écrémeuse. Mais le déchargement du foin ainsi que le sciage du bois de chauffage restent manuels, à l’exception d’une exploitation. L’énergie électrique commence à être utilisée avec les concasseurs de grains et les batteuses et il n’y a plus que 2 manèges. Les batteuses sont toutes de petits modèles, d’un faible rendement. Le nombre important d’alambics (7) prouve bien que la distillation était une activité importante…et la consommation d’alcool conséquente.

Outils et machines agricoles.
Planche extraite du Nouveau Larousse Illustré 1931
L’emploi de l’électricité dans les fermes, après 1918, ainsi que les moteurs thermiques permettent la motorisation des travaux d’intérieur. Une réelle transformation se fait ainsi dans l’exploitation et facilite le travail tout en apportant un gain de temps. Le moteur électrique à point fixe, sur charriot ou sur brouette, trouve son usage dans la grange avec la déchargeuse à griffe, la batteuse, le coupe-racines, le coupe-paille et le concasseur de céréales, qu’il actionne au moyen d’une courroie plate.
Les moteurs, électriques ou thermiques, sur charriot ou sur brouette, permettent de remplacer avantageusement la locomobile, le manège à chevaux ou à bœufs et la trépigneuse. Il ne semble pas que de tels moteurs thermiques aient fonctionné dans le village. L’agriculture y est passée directement de la machine à vapeur (pour les entreprises de battage) et du manège (pour le particulier) au moteur électrique.
Les moteurs, électriques ou thermiques, sur charriot ou sur brouette, permettent de remplacer avantageusement la locomobile, le manège à chevaux ou à bœufs et la trépigneuse. Il ne semble pas que de tels moteurs thermiques aient fonctionné dans le village. L’agriculture y est passée directement de la machine à vapeur (pour les entreprises de battage) et du manège (pour le particulier) au moteur électrique. Nos villages ont été dotés dès 1918 de l’énergie électrique, alors que les fermes isolées ou les hameaux éloignés du centre village ont souvent dû attendre la seconde moitié du 20° siècle pour pouvoir profiter de l’électricité. C’est plus dans les régions d’habitat dispersé que l’on rencontre les moteurs thermiques (Vosges, Jura, Charente…). Le courant électrique n’a fait son apparition que vers 1953 à Hutting, écart de Kalhausen. Eugène Dehlinger, appelé "Sébbels Uschénn", disposait déjà avant 1939 d’un petit moteur thermique de marque Japy. Vers la fin de la guerre, le village ne disposait plus du courant électrique et le boulanger Ferdinand Neu emprunta ce petit moteur pour actionner le pétrin mécanique, mais il ne lui donna pas satisfaction et il dut s’en procurer un autre de marque Bernard. (renseignement André Neu)
Petite anecdote : après l’installation électrique dans le village, le ferblantier Alex Grosz s’improvisa électricien et se lança dans la vente de moteurs électriques. Ainsi il en installa un chez Paul Kihl qui exerçait le métier de charron. Malheureusement la machine actionnée par le moteur ne tournait pas dans le bon sens. Le moteur fut alors refusé par le charron et installé dans la ferme Neu. Par le plus grand des hasards, le sens de rotation était le bon et le moteur resta en place.
Un électricien averti aurait tout simplement réalisé un autre câblage et interverti 2 fils.
 Chantier de battage. La batteuse est mue par un moteur thermique sur charriot. Noter que la paille est nouée manuellement. |
 Petit moteur électrique sur brouette. Fête des saveurs et traditions Eschviller 2014 |
Mais la méfiance envers la mécanisation totale règne toujours dans le monde agricole. Quelles sont les raisons de ce manque de confiance dans la motoculture et plus spécialement le tracteur ?
C’est le tracteur en premier qui fait les frais de cette méfiance. Autant on accepte facilement d’utiliser le moteur électrique ou le moteur à essence sur brouette pour les travaux d’intérieur, autant on estime que le tracteur ne doit jouer qu’un rôle d’appoint à la traction animale. Il n’est pas vraiment encore au point et n’a donc pas la totale confiance du monde agricole. (7)
Tout d’abord, le carburant nécessaire, souvent de l’essence, reste très cher, alors que les animaux de trait ne coûtent pratiquement pas plus s’ils travaillent ou sont au repos. Ce carburant doit en outre être acheté en dehors de l’exploitation, alors que le fourrage destiné aux bêtes est produit dans l’exploitation.
Ensuite toutes les machines agricoles (faucheuse, moissonneuse, semoir, charrue…) sont créées pour la traction animale et ne sont pas adaptées à la traction mécanique.
_____________________
(7). Certains techniciens agricoles, s’ils veulent bien faire entrer le tracteur à la ferme et lui attribuer quelques travaux spécifiques nécessitant une grande dépense d’énergie, n’envisagent pas la disparition totale de la traction animale et prévoient la coexistence du moteur animé et du moteur inanimé. « Le temps n’est pas venu et ne viendra probablement jamais où les charretiers et bouviers sortiront tous de la ferme pour n’y plus reparaître. » Tony Ballu in La Traction Mécanique en Agriculture Edition La maison Rustique 1943.
Les revenus des exploitations agricoles ne permettent souvent pas de faire des investissements onéreux et les seules machines que l’on daigne acquérir prioritairement sont la faucheuse mécanique, la déchargeuse à griffe et la batteuse qui rendent la fenaison et la moisson plus faciles. Pour entreposer toutes les machines nouvelles acquises, il faut repenser l’aménagement des bâtiments de la ferme et construire un hangar pouvant les abriter et les protéger des intempéries.
L’acquisition d’une nouvelle machine signifie aussi un bouleversement des habitudes culturales existantes, une mise en cause des pratiques ancestrales : le travail mécanique devient désormais technique et il faut se l’approprier au prix d’efforts forcés. La conduite de la faucheuse mécanique n’est pas évidente au départ, sans apprentissage : il faut manœuvrer à de nombreuses reprises dans un pré, reculer en relevant la barre de coupe, réaligner les chevaux ou les vaches, éviter les obstacles comme les bornes et les arbres fruitiers. Et que dire de l’aiguisage des couteaux de la lame ou de leur remplacement ? Là aussi il faut apprendre.
Enfin le paysan est avant tout un charretier et avec les machines, plus précisément le tracteur, il doit acquérir des notions mécaniques inconnues jusqu’à présent et ce n’est pas donné à tout le monde. L’entretien et les réparations peuvent aussi devenir chers.

Jean Pierre Metzger et son attelage dans la rue des jardins.
Seules, les grandes exploitations de plaine et dans nos régions, quelques agriculteurs avant-gardistes se dotent d’un tracteur avant 1939.
 |
 |
L’agriculteur est fier de ses chevaux.
Emile Hiegel et Joseph Greff

André Neu.

Chrétien Stéphanus en route pour l’abreuvoir.
Dans nos villages donc, dans la première moitié du 20° siècle, la mécanisation agricole se limite à l’acquisition de quelques machines fondamentales rendant les travaux en pointe plus faciles (faucheuse, râteau à cheval, faneuse, batteuse) et à des machines d’intérieur de ferme.
Avec l’introduction de la mécanisation, le travail du forgeron, qui consistait essentiellement dans le ferrage des bêtes de trait et la fabrication d’outils, va subir une mutation et s’appliquer aux nouvelles machines : faucheuses, batteuses, râteaux et faneuses. Le forgeron devient désormais aussi mécanicien et supplée souvent l’agriculteur dans les réparations délicates.
Il dispose de catalogues de pièces détachées et peut commander auprès des fournisseurs toute pièce défectueuse lui permettant de réparer les machines de toutes les marques existant sur le marché.

Catalogues ayant appartenu au forgeron Léon Lett de Kalhausen (1903-1984).
L’usure de certains organes des machines est importante, surtout les chaînes de transmission des moissonneuses-lieuses et les éléments des barres de coupe des faucheuses (doigts, sections, plaques, lames). Le forgeron-mécanicien se doit d’avoir un stock important de ces pièces, mais aussi des boulons, des rondelles, des rivets, des goupilles et des lames montées. A lui de pouvoir réparer sur l’heure toute panne, surtout si elle survient pendant un travail en pointe et que l’exploitant est incapable de le faire.
L’avènement des pneus après 1932 lui donne aussi l’occasion d’équiper, avec de nouveaux essieux, les antiques charrettes à roues en bois. La réparation des crevaisons et les remplacements de pneus sont aussi de sa compétence. Avec l’apparition du tracteur, il modifie les systèmes d’attelage des différentes machines traînées. Il s’équipe encore d’un compresseur et la forge fait office de station de gonflage des pneus.
La plupart des exploitants ne sont pas outillés et n’ont que des marteaux, des pinces et quelques clés fournies avec les machines. Aucun ne dispose de ste à souder, de touret à meuler, de compresseur, d’outils électro-portatifs comme les perceuses et les meuleuses à disque. C’est le forgeron-mécanicien, bien outillé, qui intervient pour l’exploitant agricole.
Léon Schemel, de Herbitzheim, dispose dans sa forge d’un tour à métaux, d’un marteau-pilon, d’une scie à métaux motorisée, d’une perceuse à colonne et d’un compresseur. Ainsi il peut entreprendre toutes sortes de travaux mécaniques. Les agriculteurs restent ses plus fidèles clients et la forge devient souvent le lieu de rencontre des agriculteurs, un endroit où l’on se raconte tous les potins du village, une sorte de"Maischdubb".
Il est le plus couramment sollicité pour des travaux de soudure, de perçage, d’aiguisage des socs de charrue, des réparations de chambres à air ou des gonflages de pneus, mais aussi pour le ferrage des chevaux ou des vaches de trait et les soins apportés à leurs sabots. Il dispose à cet effet, à l’extérieur de sa forge, d’un travail à ferrer (de Nootschdàll), une installation qui lui permet d’immobiliser les animaux récalcitrants.
Il vend également de la quincaillerie (vis, clous, boulons, rondelles, rivets…), des outils à mains qu’il a forgés et bien sûr des machines agricoles et des pièces détachées. C’est aussi le cas du forgeron de Kalhausen, Léon Lett, appelé de Schmèdde Léo, qui a succédé à son père Jacques. Le forgeron Lett
ne dispose pourtant pas de travail à ferrer, car la place lui manque dans la petite cour comprise entre la forge et le bâtiment agricole qui lui fait face.

 Avant l’apparition du tracteur. Léon Lett et ses employés. Cerclage de roues à gauche et soins aux animaux de trait à droite. |
 |
 |
Cette facture du forgeron, comme celle du vétérinaire Zenglein de Sarre-Union est annuelle.
Elle répertorie toutes les interventions de l’année écoulée et s’élève à 11 760 F, soit 238 euros.
Elle répertorie toutes les interventions de l’année écoulée et s’élève à 11 760 F, soit 238 euros.
Le sellier-bourrelier "de Sàddler" n’est pas en reste et doit aussi faire sa mutation, en réparant les toiles élévatrices des moissonneuses-lieuses (liteaux à remplacer, toile à recoudre) et les courroies plates servant à actionner les batteuses et autres machines.
A Kalhausen, le sellier Auguste Simon et son fils Adrien ne chôment pas et ont ainsi même des clients venant de villages voisins (Achen, Etting).
Même le menuisier devient réparateur de machines agricoles en refaisant la partie en bois des bielles servant à actionner les lames cisailleuses des faucheuses "de Kùrwelschdòng" ou les rabatteurs des moissonneuses-lieuses "de Hàschbell ".
Les états de dommages de guerre remplis en 1940, après le retour de l’évacuation, permettent de connaître les outils et machines présents dans les fermes à cette époque :
- il y a d’un côté les traditionnels outils manuels toujours en fonction comme :
le croc à pommes de terre "de Kààrscht"
la houe "de Hàck"
la fourche à foin (à 3 dents, "de Haugàwwel ") et celle à fumier (à 4 dents, "de Mìschtgàwwel ")
la bêche "de Schbààt"
le râteau en bois "de Haurèsche"
la faux à manche "de Sèns ou de Mäh"
la faucille "de Sìschel"
le fléau "de Dréschfléégel"
- il existe d’un autre côté quelques machines :
la déchargeuse à foin "de Hauàblààder"
la batteuse avec tarare "de Dréschmaschinn"
le tarare "de Wònnmihl"
la faucheuse mécanique avec le dispositif pour la moisson "de Mähmaschinn"
la faneuse mécanique "de Hauwènner"
le râteau à cheval "de Pèèrdsrèsche"
la centrifugeuse "de Sènndréfuur"
la meule à aiguiser "de Schliffschdéén"
le hache-paille "de Schtrohhäcksler"
le coupe-racines "de Dickrìeweràtz"
la scie circulaire "de Kreissäh"
la charrue en bois avec un avant-train en fer "de Pluck"
la houe à cheval en bois "de Hàcker"
les herses en fer ou en bois avec des dents de fer "de Ééje"
la charrette agricole "de Wòòn", à 4 roues avec 6 ridelles en bois "de Wòònsdiele", en faits des planches de sapin épaisses de 4 cm et 2 échelles à foin
"de Haulèèdere", à fixer sur le côté, à la place des ridelles.
La motorisation agricole se limite au moteur électrique de 3 CV, employé comme source d’énergie à l’intérieur de la ferme. Toute la traction reste animale.
(Etats consultés : Jean-Pierre Hiegel, Pierre Stéphanus et Charles Demmerlé.) Il est clair que les machines répertoriées ne sont pas forcément présentes dans toutes les exploitations du village.)
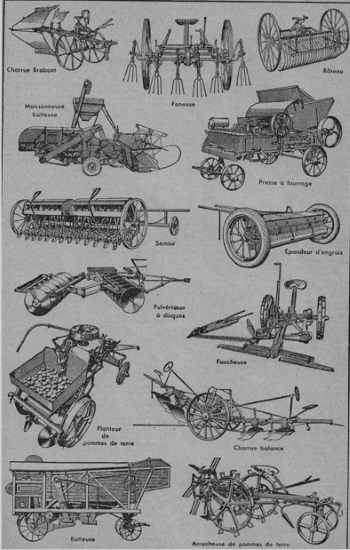 |
Planche extraite du Nouveau Petit Larousse Illustré de 1951.
Les progrès sont visibles, mais les machines sont encore
presque toutes conçues pour la traction animale
et ne sont pas toutes dotées de pneus.
Certaines sont encore inconnues au village à cette époque.
Les progrès sont visibles, mais les machines sont encore
presque toutes conçues pour la traction animale
et ne sont pas toutes dotées de pneus.
Certaines sont encore inconnues au village à cette époque.
Pendant longtemps, le tracteur est censé remplacer le cheval ainsi que le bœuf et il est donc uniquement conçu pour la traction : en témoignent le crochet d’attelage et la barre d’attelage arrière "de Àckerschien" servant à accrocher les chaînes de traction "de Kédde" ou le timon des machines "de Tissell".
Le tracteur n’est qu’un "cheval mécanique" et la marque Fendt construit des modèles dénommés "Dieselross", c’est-à-dire "cheval diesel ".

Publicité pour la marque Fendt.
" Le meilleur cheval de ton écurie ! "
" Le meilleur cheval de ton écurie ! "

Mais peu à peu, le tracteur devient, selon la philosophie de Harry Ferguson, une "centrale mobile d’énergie", autrement dit un porte-outils automoteur, mettant sa puissance au service des appareils attelés, au moyen de la prise de force indépendante ou de la poulie, appelée "poulie de battage" courante dès 1950 : la presse, a moissonneuse-lieuse ou la batteuse, le rotovator sont mis en mouvement par le moteur du tracteur, ce qui n’aurait jamais été possible avec la traction animale.
Cette extension du rôle du tracteur engendre la disparition des moteurs auxiliaires sur certaines machines et la disparition de la traction animale. Le système d’attelage trois-points des outils portés, également inventé par Ferguson, permet bientôt au tracteur de se substituer entièrement au cheval et de devenir véritablement "la machine à tout faire" de la ferme.
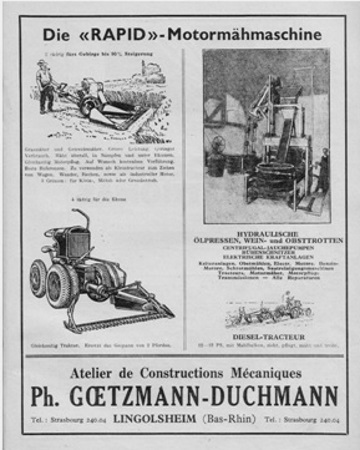
1939. Almanach Agricole d’Alsace et de Lorraine.
La publicité propose encore peu d’offres en ce qui concerne la motoculture :
quelques motofaucheuses et de timides tracteurs de petite puissance (12 à 18 cv).
La publicité propose encore peu d’offres en ce qui concerne la motoculture :
quelques motofaucheuses et de timides tracteurs de petite puissance (12 à 18 cv).
Si le tracteur était avant 39/45 le privilège d’une minorité d’agriculteurs éclairés et évolués, il devient au lendemain de la Libération un instrument de progrès dans la France à reconstruire. La motorisation de l’agriculture connaît alors un essor important, grâce au plan Marshall (8).
Les agriculteurs de nos villages vont peu à peu adopter la traction mécanique dans les années 1950-1960. Les premiers tracteurs apparaissent timidement après 1950 et presque tous les exploitants s’équipent en tracteur dans les 2 décennies suivantes.
La puissance du tracteur l’emporte désormais sur celle des animaux et il s’impose également dans les régions de petites exploitations. Le tracteur
tous usages ouvre ainsi la voie à l’emploi de toute une série importante de machines performantes. Mais la traction animale ne disparaît cependant entièrement en France que dans les années 1960-1970.
_______________________
(8). Ce plan initié aux Etats-Unis par le général Marshall et adopté par le président Truman devait permettre pendant une période de 4 ans (1948-1952) de reconstruire l’Europe après la Seconde Guerre Mondiale. Il consistait pour les Etats-Unis à fournir un crédit à un état européen, crédit servant à payer des importations en provenance des U.S.A.
 1963. Jean Pierre Freyermuth a toujours ses chevaux, mais il les remplacera bientôt par un tracteur. |
En 1950, il y a encore près de 2 millions de chevaux de trait en exercice en France, pour un peu plus de bovins (2,6 millions). En 1970, les chevaux
ne seront plus que 300 000 et les bovins 35 000.
Souvent, par prudence, l’on préfère encore conserver les animaux de trait malgré l’achat d’un tracteur. Les chevaux et les bovins peuvent toujours remplacer la machine en cas de panne et constituent un attelage de secours. De plus ils sont utiles pour certaines petites parcelles difficiles d’accès et pour les travaux dans les cultures de betteraves et de pommes de terre (binage et buttage).

Cohabitation chevaux-tracteurs.
Les Pèèrdsbuure de Kalhausen
Une vingtaine d’exploitations agricoles avaient été recensées en 1924. Au sortir de la Seconde Guerre Mondiale, avant l’apparition du tracteur au village, leur nombre est sensiblement le même.
En voici la liste :
- Place du village : Florian Thinnes (Bàddisse), Florian Gross (Krìschängels), Paul Muller (Grééds), Henri Bour (Scharls)
- Rue de la montagne (de Guggelsbèrsch) : Chrétien Stéphanus (Jokkébels), Jean Pierre Hiegel, Théophile Juving
- Rue des lilas (de Schùùlgàss) : Henri Hoffmann (Hènnrische)
- Rue de la libération (de Lòngenéck) : Auguste et Florian Métzger (Jààkobs), Jean Baptiste Neu, Florian et Adam Stéphanus (Schòòndersch),
Pierre et Nicolas List (Muurhànse), Jean Koch
- Rue des fleurs et rue des roses (de Wélschebèrsch) : Auguste Muller père (Thìewels), Edgard Spielewoy, Jean Pierre Freyermuth
(de Schwärzel), Nicolas Assant
- Rue des jardins : Charles Lauer, Joseph Greff, Jean Pierre Bruch, Charles Demmerlé (de Éddìnger Kàrl), Jean Pierre Freyermuth (Schmìtthònse),
Jean Pierre Lenhard (Kàrmàns)
- Moulin : Joseph Herrmann
- Weidesheim : Louis Greff, Rodolphe Muller
17 de ces exploitants (en grisé ci-dessus) vont se lancer dans la motoculture et investir dans un tracteur. Ceux qui ne le font pas se sentent trop vieux ou n’ont pas de repreneur pour leur exploitation (Théophile Juving 1900-1983, Auguste Métzger 1891-1973). Parfois c’est le fils ou le beau-fils qui reprend l’exploitation et qui acquiert un tracteur (Marcel Thinnes, Nicolas Stéphanus, Joseph Muller, Joseph Stéphanus, Emile Hiegel) ou qui pilote le tracteur (Alphonse Schreiner).
Auguste Muller, fils, né en 1921, n’a jamais voulu se lancer dans l’acquisition d’un tracteur et préféra garder son attelage de chevaux jusque dans les années 1970, quitte à faire réaliser certains travaux par son beau-frère Nicolas Assant qui avait acheté un tracteur dès 1961. Son fils Grégoire achètera le premier tracteur 4 roues motrices du village.

Auguste Muller
(1921-2001)
(1921-2001)
Voici la liste des Kìhbure :
- Place du village : Nicolas Demmerlé, père
- Rue de la montagne : Marie Jeanne Demmerlé, Henri Rimlinger, Jean Pierre Pefferkorn (Fawriggersch), Jean Pierre Lang (Schdoffels),
Philippe Freyermuth, Pierre Wendel (Lééne)
- Rue des lilas : Jean Victor Pefferkorn (Blääse)
- Rue de la libération : Jacques Zins, Nicolas Lenhard (Schààcks), Jean List
- Rue des fleurs et rue des roses : Florian Stéphanus (de Schdèffe), Auguste Simon (Bohnevàddersch), Nicolas Freyermuth (de Bodde Nìggel),
Oscar Muller, Rodolphe Wendel (Rudolfs), Charles Rimlinger, Joseph Philipp (de Chef Sépp), Emile Seiler
- Rue des jardins : Pierre Freyermuth (Digges), Pierre Kremer, Pierre Stéphanus (Jokkébels), Nicolas Freyermuth, les sœurs Freyermuth (Ängels),
les sœurs Pefferkorn (klèèn Schùmmàchersch), André Holtzritter (Brùchbrùnnersch)
- Hutting : Nicolas Kirch
7 de ces petits exploitants achèteront un tracteur(en grisé ci-dessus), ainsi que 5 fils et 1 beau-fils repreneurs de l’exploitation (Nicolas Demmerlé fils, Joseph Stock, Joseph Pefferkorn, Camille Zins, Jacques Stéphanus, Henri Holtzritter, Adrien Simon).

Nicolas Lenhard, Schààcks Nìggel, rentre ses vaches du parc,
un dimanche soir. Derrière lui, Jean Pierre Freyermuth.
L’achat d’un tracteur représente un investissement important, difficilement supportable sans emprunt. Le coût moyen d’un tracteur en 1951 n’est pas loin du million de francs, sauf pour le Pony (ce qui représente à peu près 22 000 euros actuels).
Les tracteurs Diesel sont d’un tiers plus chers à l’achat que ceux qui sont dotés d’un moteur à essence. Les banques comme le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel proposent des aides pour un tel investissement, sous la forme de prêts, mais le monde paysan, plus particulièrement les anciennes générations, n’est pas totalement ouvert au crédit et préfère souvent payer comptant, au risque de devoir attendre quelques années supplémentaires avant de pouvoir investir. Cela explique le retard pris par certains agriculteurs dans l’achat d’un tracteur.
Lorsque Charles Demmerlé achète son second tracteur en 1967, un Renault Super 2 D, il débourse 14 705,25 F pour le tracteur (dont 350 F pour la livraison par voie ferrée et 22,25 F de frais de carte grise). La barre de coupe lui est facturée 1 879,74 F et la cabine Fritzmaier 1 166,20 F. Ce qui lui
fait un total de 17 751,19 F.
De cette facture vient en déduction la reprise du tracteur Vendeuvre AS 500 pour 2 250 F. Il bénéficie aussi d’un escompte de 316,28 F pour paiement comptant. Charles doit donc débourser la somme de 15 501,19 F, qu’il règle par chèque le 22 novembre 1967. (documents fournis par sa petite-fille Martine Thaller)
Prenons aussi le cas de mon père. En 1950, il est âgé de 28 ans et son avenir tout tracé est la reprise du train de culture de son père Joseph. Ce dernier, arrivé à l’âge de 64 ans, continue d’employer ses chevaux. Mon père, au contraire, croit à la motorisation. Il a passé son permis de conduire dès 1939 et achète, parmi les premiers au village, un tracteur. L’investissement se monte à 1 076 460 F pour le tracteur, la barre de coupe et la charrue, soit 24 450 euros, ce qui n’est pas une petite somme pour un jeune qui débute dans la vie active, qui a fondé une famille, qui vient d’avoir son deuxième enfant et qui n’a pas encore pu mettre beaucoup d’argent de côté.
L’acompte versé le 4 mai 1951, à la commande, se monte à 50 000 F (1 135 euros). La banque fédérative du Crédit Mutuel lui avance la somme de 902 805 F (20 502 euros), ce qui représente presque 88 % du coût total. Le jour de la livraison, il verse encore 20 000 F (454 euros), puis encore 25 000 F (567 euros) en août et le reste, 78 855 F (1 790 euros) en septembre. Voilà, le tracteur est payé au prix de gros sacrifices et d’un emprunt qui court sur de nombreuses années. Impossible de faire d’autres investissements pour le moment. Il faut garder les outils adaptés à la traction animale (râteau à cheval, faneuse, charrette).
En avril 1952, une moissonneuse-lieuse est acquise pour la somme de 288 637 F (5 856 euros). Là aussi une somme de 200 000 F (4 058 euros) est versée à la livraison (provenant sans aucun doute d’un second emprunt), et de petites sommes sont versées ensuite (19 630 F le 16 juin, 15 000 F le 22 juin, encore 15 000 F le 16 juillet, puis 10 000 F le 22 octobre et enfin le solde, 2 907 F pour la fin de l’année.
Rien qu’en l’espace d’un an, depuis mai 51 jusqu’à avril 52, l’endettement a grimpé jusqu’à 1 102 805 F (22 375 euros). Inutile de dire que peu d’investissements pourront se faire les années suivantes et l’on continuera à travailler avec les anciennes machines que l’on adaptera à la traction mécanique. L’antique batteuse à point fixe de la grange, qui ne dispose pas de dispositif de nettoyage des grains, ne sera pas remplacée ni modernisée de sitôt. Aucune machine nouvelle ne sera plus acquise pendant longtemps. Plus tard, il n’y aura que des acquisitions de matériel d’occasion, déjà obsolète ou peu fiable (tracteur Lanz Bulldog de 1939, John Deere 500, ramasseuse-presse, faneuse, batteuse, moissonneuse-batteuse JF…)
 |
 |
Joseph Pefferkorn.
Traction animale en1963 et traction mécanisée en 1969.
Par contre, les ouvriers-paysans, surtout les mineurs et les cheminots, qui ont une paie mensuelle garantie, acquièrent du matériel neuf.
Pour éviter un investissement trop lourd, l’un ou l’autre agriculteur acquiert parfois un tracteur fabriqué artisanalement au moyens d’éléments de récupération issus généralement du surplus militaire. Ce n’est certainement pas la panacée, car ces machines bricolées ne sont pas toujours performantes ou alors consomment trop.
La solidarité et l’entraide entre paysans a de tout temps facilité le travail, aussi quelques agriculteurs du village achètent-ils en commun certaines machines. C’est le cas de Jean-Pierre Freyermuth (de Schwärzel), Henri Hoffmann (Hènnrische Haary) et des frères Albert et Florian Gross (Krìschängels). Ils acquièrent ensemble une batteuse mobile Kuhn, un rabot de prairie, un trieur de grains et un pulvérisateur sur roues qu’ils utilisent sans problèmes, à tour de rôle. (renseignement fourni par Adolphe Lenhard)
Dans certains villages, comme à Herbitzheim, par exemple, une CUMA (Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole) est créée dans les années 60, regroupant certains adhérents de la Coopérative Agricole locale. Le matériel mis à disposition des membres se compose au départ d’un cultivateur
(e Grubber), d’un pulvériseur à disques (e Scheiweééj) et plus tard d’un pulvérisateur (e Schbrìtz).
Ces machines sont des engins traînés, montés sur pneus pour le transport sur route et rendent de grands services aux agriculteurs, les dispensant d’acheter individuellement de tels équipements. Plus tard, dans les années 70, le parc des machines s’enrichit d’une rotofraise portée. La moissonneuse-batteuse Fahr acquise par la Cuma dans la même période n’est pas mise directement à disposition des membres, mais conduite par un employé de la coopérative pendant la moisson.

Publicité Kuhn pour une rotofraise.
De mini-entreprises de moissonnage se créent aussi au village avec l’apparition des premières moissonneuses-batteuses. Ainsi Joseph Muller, (de root Sépp), André Neu, qui s’est établi à Siltzheim et son frère Fernand, qui a repris à Kalhausen le train de culture de ses parents, interviennent chaque année, pendant la moisson, pour moissonner à la demande, les parcelles des particuliers.
Avant l’avènement des moissonneuses-batteuses, le battage des céréales se faisait déjà, pour les exploitants ne possédant pas de batteuse à domicile, avec la grande batteuse Lanz mise à disposition par Marcel Thinnes et installée dans un premier temps devant sa maison, puis plus tard dans un hangar bâti sur la gauche de sa ferme.
Les premiers tracteurs de nos villages sont tous des machines de puissance modeste, comprise entre 10 CV et 30 CV, aptes à travailler sur de petites exploitations et facilement accessibles pour les petits revenus.
Les petits exploitants, et particulièrement les ouvriers-paysans, se contentent de leur première acquisition tandis que les exploitants plus importants se lancent assez rapidement dans l’achat d’un tracteur plus puissant et désormais doté du relevage hydraulique. Chez ces derniers, les engins de la première génération sont tout simplement revendus ou repris par les concessionnaires. Certains sont gardés pour exécuter les travaux faciles comme les petits transports, le fanage et le râtelage, pendant la fenaison.
La course à la puissance ne fait que commencer. Dans les années 70, un tracteur de 40 CV était considéré comme puissant, actuellement des engins de 120 CV et plus sont nécessaires pour les travaux culturaux.
L’accroissement de la puissance va de pair avec le développement de machines toujours plus imposantes. Entre 1970 et 1990, le nombre de tracteurs de plus de 54 CV est multiplié par 10, alors que celui des tracteurs de moins de 35 CV est divisé par 4.
 |
Source : senat.fr
2. Conséquences de la mécanisation et de la motorisation agricoles
L’utilisation de machines spécifiques permet dans un premier temps à l’agriculteur de réduire sa fatigue physique et de gagner un temps précieux dans la réalisation des travaux en pointe. Ces machines sont la charrue, le semoir, la faucheuse mécanique, la faneuse, le râteau à cheval, la moissonneuse et la batteuse.
Mais l’achat le plus important et le plus significatif est bien celui du tracteur. Les conséquences de cette acquisition sont d’abord d’ordre technique : le travail est réalisé plus rapidement et surtout plus facilement qu’avec un attelage. Le tracteur réduit ainsi considérablement les périodes des travaux de pointe. De plus, il ne coûte rien au repos, peut travailler en continu, sans se lasser, contrairement à un attelage de bêtes, et même finir tard ou pendant la nuit un travail commencé le matin. Les travaux sont réalisés au moment le plus favorable, avec qualité et économie.
De plus, le tracteur est un merveilleux engin de transport pour les personnes. La caractéristique presque générale des tracteurs commercialisés après 1950 est la présence d’un siège passager fixé sur le garde-boue gauche. On roule rarement seul et l’agriculteur emmène souvent dans les champs un ou deux passagers : ses propres enfants ou son épouse. De plus, le tracteur remplace souvent la voiture pour se rendre à la gare et prendre le train, ou en ville.
L’ancienne calèche, de Kutsch, dont il existe au moins un exemplaire dans chaque village et qui servait au transport de passagers vers la gare et la ville, ainsi qu’aux baptêmes, est de fait mise au rancart, remplacée par la voiture automobile et pour un degré moindre par le tracteur.

Après un baptême.
Marcel Thinnes reconduit un nourrisson
tenu par la sage-femme Anne Simonin.
(Photo Roland Thinnes)
A ce propos, je me rappelle très bien d’un voyage à tracteur. Je devais avoir 6 ou 7 ans. Ma tante avait été nommée institutrice à Soucht et mon père avait organisé un transport en commun à destination de ce village, en vue d’y aller cueillir des myrtilles. Toute la famille, grands et petits, embarqua sur la charrette à plateau, en compagnie de voisins. Ce fut une joyeuse virée à partir de Herbitzheim, en direction des proches Vosges du nord, avec un pique-nique à la clé. Mon père avait même acheté un peigne à myrtilles, mais la récolte ne fut pas à la hauteur des efforts déployés et l’expérience s’arrêta là.
Avec le tracteur, le paysan passe directement à l’âge de la motoculture, c’est-à-dire qu’il doit s’adapter désormais à un monde nouveau dans lequel il
est contraint de réfléchir à des pratiques culturales différentes de celles qu’il connaît : il peut désormais labourer plus profond, il peut choisir le meilleur moment pour intervenir dans les champs et n’aura plus de retard dans son travail, il n’est plus obligé de faucher sous la pluie pour anticiper… Avec le tracteur, l’agriculteur met un doigt dans l’engrenage de la motorisation et il ne pourra plus s’arrêter. La machine appelle la machine et d’autres achats suivent : moissonneuse-lieuse, moissonneuse-batteuse, ramasseuse-presse, etc…
Grâce au tracteur, le paysan peut produire davantage. La totalité de la récolte ne sera plus réservée uniquement à l’exploitation, mais pourra être vendue en partie. L’agriculture cesse d’être autarcique et s’ouvre sur le monde du marché.
Il s’en suit un accroissement possible de la surface à cultiver et une augmentation du cheptel bovin (vaches laitières et races à viande). D’où une augmentation non négligeable des revenus agricoles. L’argent pourra être utilement investi dans l’acquisition de machines nouvelles.
Grâce au tracteur, le travail est plus net, plus propre, plus régulier. La qualité des produits agricoles est optimale, car les interventions, limitées et rapides, peuvent se faire au moment opportun et les récoltes peuvent être rentrées pour les soustraire aux éventuelles dégradations dues aux conditions atmosphériques. La puissance du tracteur permet des travaux dans des conditions météorologiques qui seraient dissuasives pour des chevaux.
Grâce à la puissance de la machine, des zones difficiles peuvent être mises en culture, alors qu’elles seraient laissées en friches autrement.
Actuellement le bénéfice de la motorisation est encore plus visible : l’exploitant est plus disponible pour des tâches intellectuelles de chef d’entreprise (comptabilité, gestion, actions commerciales) et pour des loisirs.
Les raisons d’acheter un tracteur sont aussi d’ordre psychologique : l’agriculteur veut être moderne, imiter le voisin qui a investi dans un tel engin. Le tracteur devient ainsi le symbole visible du progrès et personne ne veut rester à la traîne et rater le train en marche. C’est pour cette raison que presque tous les exploitants d’un village vont s’équiper en tracteur, du plus petit ouvrier-paysan au plus grand agriculteur, sans trop réfléchir à la rentabilité d’un tel investissement.
Le tracteur fait du paysan autrefois archaïque un agriculteur moderne, fier de son tracteur et des machines qu’il peut y atteler. Il est sûr qu’on parle de lui dans le village, qu’on l’observe quand il est au volant de son engin et qu’on l’envie. Le paysan motorisé devient la curiosité de la jeunesse masculine et exerce sans le savoir une influence sur elle : les jeunes garçons sont enthousiastes devant les machines nouvelles et le métier d’agriculteur leur paraît moins pénible, moins contraignant.
Il est curieux de noter que la tranche d’âge comprise entre 40 et 50 ans est celle qui se lance la première dans l’acquisition d’un tracteur : les quadragénaires ne sont pas encore trop âgés pour emboîter le pas au progrès et ils sont souvent influencés par leurs enfants. En deçà de 40 ans, l’argent manque souvent pour envisager l’achat d’un tracteur et d’autres crédits sont encore en cours. Et au-delà de 50 ans, les agriculteurs n’osent plus tellement se lancer dans la traction mécanique et préfèrent garder leur attelage de chevaux.
Si les jeunes ne peuvent pas acquérir de tracteur, faute de moyens financiers, ce sont pourtant eux qui s’en servent les premiers, qui se passionnent pour la mécanique et qui poussent souvent leurs parents à se lancer dans la motoculture. La génération antérieure a plus de difficultés à assimiler les contraintes mécaniques liées au tracteur (conduite sur route ou dans les champs, terrain sec ou détrempé, entretien : vidange, contrôle des niveaux, lubrification, antigel…, emploi des outils). Par contre, et c’est évident, la jeune génération apprend vite et c’est elle qui prend possession en premier du tracteur acheté par le père.
Les griefs que le monde paysan avait tendance à faire à la traction mécanique sont vite oubliés : tassement du sol, investissement important, raréfaction de l’engrais animal, petits travaux mieux faits par l’animal et non rentables, s’ils sont effectués avec un tracteur…
Pour les travaux en pointe, comme la récolte du fourrage et la moisson, on est passé, en quelque décénnies, c’est-à-dire depuis les années 60, du travail manuel collectif, rassemblant la famille entière ou les voisins, à des chaînes totalement mécanisées, où une seule personne, au volant de son tracteur, et à l’aide de machines spécifiques, effectue sans difficulté toutes les opérations culturales.
Le tracteur est devenu un maillon essentiel de la motorisation agricole et les progrès sont désormais constants dans le domaine de la mécanisation et de la motorisation avec l’apparition de machines nouvelles toujours plus performantes, avec la généralisation du système d’attelage trois-points et l’avènement de l’électronique.
Le tracteur moderne, truffé d’électronique et pourvu de plus grand confort, n’a plus rien à voir avec les antiques engins à roues à bêches ou à cornières, qu’il faut démarrer à la manivelle ou à la lampe à souder. L’ordinateur s’occupe déjà de la traite des vaches à la ferme et bientôt le pilotage par satellite permettra à l’agriculteur, pardon au technicien spécialisé assis derrière son écran, de labourer ou de faucher à distance, par robot interposé, sans presque remuer son petit doigt.
Mais la mécanisation et surtout la motorisation agricole ont aussi des conséquences négatives sur les hommes, la nature et l’économie.
La vie de groupe (famille, voisinage, village) est fortement bouleversée par le recours à la motorisation. Autrefois les travaux agricoles se faisaient avec l’ensemble de la famille ou du voisinage, les rendant collectifs avec tout ce que cela entraîne comme liens tissés. Les enfants participaient volontiers à la vie de la ferme et étaient souvent mis à contribution, le soir après la classe ou pendant les jours où l’école vaquait. En aidant leurs parents, ils apprenaient l’effort et la valeur du travail.
La mécanisation rend les travaux de la ferme individuels : une seule personne, appelée désormais "conducteur de machine", s’occupe de toutes les opérations. Tout au plus a-t-il besoin parfois d’un aide, "conducteur de machine", comme lui. La campagne s’est actuellement désertifiée et on n’y voit plus çà et là que quelques engins bruyants, alors qu’elle grouillait autrefois de vie, animée par les attelages et les travailleurs manuels.

 |
 |
 |
 |
Que de bons moments passés ensemble, après l’effort !
La mécanisation instaure la monoculture à outrance dans toutes les régions, détruisant le paysage (arrachage de haies, d’arbres), la faune (oiseaux, gibier), appauvrissant le sol (abandon de la jachère) et forçant l’exploitant à recourir à des amendements de synthèse.
Les lourds engins et leur usage par tous les temps, sans respect des sols, compactent la terre et la rendent imperméable à l’air. Les vers de terre, tués par les produits chimiques, ne creusent plus les galeries qui permettent à l’eau de s’infiltrer. L’eau de pluie ruisselle davantage en surface et provoque rapidement des inondations. La pratique du drainage aggrave encore le problème.
La mécanisation provoque l’écroulement des prix : pour essayer de rentrer dans leurs frais, les agriculteurs produisent toujours plus et ne peuvent plus sortir du cercle vicieux du productivisme.
Elle entraîne aussi une baisse du nombre des exploitations agricoles et des exploitants, un regroupement des fermes, isolant de plus en plus les paysans ou provoquant des déserts ruraux. L’exode rural, commencé en 1850, n’a plus cessé depuis cette date.
Si au début du 20° siècle, pratiquement tout un village comme Kalhausen est rural et vit de l’agriculture, aujourd’hui seulement 5 exploitations agricoles subsistent et le nombre de personnes occupées par l’agriculture ne dépasse pas la douzaine. Quant au nombre de tracteurs strictement réservés à la culture et d’engins spécialisés, il a aussi fortement diminué. L’exploitation agricole comptait autrefois un seul tracteur, rarement deux. Actuellement l’exploitation agricole moderne compte de 3 à 5 tracteurs, souvent de puissance inégale, adaptés chacun pour un usage spécifique, dont un exemplaire est doté d’un chargeur frontal. Les engins à 2 roues motrices sont le plus souvent relégués aux travaux d’intérieur de la ferme.
Quelques personnes ont pourtant acquis un tracteur souvent d’occasion ou conservé le tracteur des parents, uniquement parce qu’elles l’utilisent pour débarder, transporter et scier leur bois de chauffage ou encore pour effectuer de petits transports et entretenir un verger. Ainsi, dans le village, il n’y a pas moins d’une trentaine de ces tracteurs en service pour des besoins non-agricoles. Il va sans dire que ces engins ne sont utilisés qu’occasionnellement et sont de puissance moyenne.
3. Les progrès dans les domaines particuliers
3.1. La préparation des sols.
Le principal but de la culture du sol est bien sûr d’exploiter les réserves alimentaires qu’il contient pour faire pousser diverses cultures. Pour pouvoir utiliser efficacement ces réserves, il faut au préalable ameublir la terre, en utilisant la charrue et d’autres instruments.
Le labour (9)
L’antique araire ne fait que gratter le sol en surface et ne permet pas de le retourner pour l’aérer.
Dès le Moyen-Age, de nombreux perfectionnements permettent un meilleur travail et voient l’avènement de la charrue (de Plùck) munie d’un avant-train à roues permettant à la charrue de garder sa stabilité, du coutre découpant la bande de terre à retourner, du versoir et de mancherons.
_____________________
(9). Le rôle du labour est tout d’abord de retourner la terre pour l’aérer, ensuite d’y incorporer le fumier et les résidus végétaux, enfin de déterrer les mauvaises herbes pour les ramener
en surface où elles se dessécheront au soleil.
 |
 |
Encyclopédie de Diderot (1751-1772)
A gauche, charrue ordinaire. A droite, charrue avec versoir.
Le bâti (l’âge) et le versoir fabriqués en bois sont peu à peu remplacés au 19° siècle par le fer et l’acier. Un dispositif de réglage en profondeur et en largeur (charrue Dombasle 1820), puis un système de blocage des mancherons (charrue Hamant 1865) apportent des améliorations appréciables.

La charrue Dombasle ne comporte pas d’avant-train.
 |
 |
De nombreux exemplaires de charrues brabants simples, à un soc, sont utilisés dans le village, avant l’avènement du tracteur.
La terre argilo-calcaire du village est difficile à travailler, sauf dans les vallées de l’Eichel, à Hutting et de la Sarre, à Weidesheim, où elle est sablonneuse.
Un attelage de 2 chevaux est nécessaire pour le labour, mais il faut de 3 à 4 vaches pour le même travail.
La charrue brabant double n’est pas en usage dans nos régions, ni du temps de la traction animale, ni du temps du début de la motorisation. En effet, dans nos petites parcelles, le labour en planches est d’usage et le brabant simple, moins onéreux à l’achat, suffit largement. (10)

___________________
(10). Pour les petites parcelles, le labour se fait en planches avec des charrues dont les versoirs retournent la terre d’un seul côté, généralement à droite. Le labour s’exécute en partant de la ligne médiane de la planche et en tournant autour de celle-ci (labour de printemps, en adossant, ussenònner fahre) ou en commençant par les rives pour terminer au milieu (labour d’automne, en refendant, zòmme fahre). L’inconvénient majeur est la perte de temps pour les manœuvres en fourrière (schdrécke) et la présence dans le champ des ados et des dérayures (Fùhre) qui peuvent gêner l’emploi d’autres machines.

Le labour à plat, par contre, laisse un terrain plat, sans ados ni dérayures, mais nécessite une charrue brabant double, appelée aussi charrue réversible (e Wèndeplùck), avec un âge comportant des socs superposés versant alternativement à droite et à gauche. Au bout du champ, les corps versants sont alternés mécaniquement ou hydrauliquement et ainsi toutes les raies sont couchées du même côté. Les charrues modernes employées actuellement sont de ce type et le labour des grandes parcelles obtenues après remembrement se fait toujours à plat.

 |
 |
Attelage de 3 ou 2 chevaux selon le terrain argileux ou sablonneux.
Les 2 charrues ont un avant-train en métal.
A gauche Emile Hiegel et Lucie Schlegel posent pour la photo.
De petites charrues à roulette sont parfois utilisées pour les jardins accessibles aux chevaux et non clôturés situés à l’extérieur du village (Gààrdeschdìgger).

(Photo Gilbert Schmitt. Kalhausen)
La charrue-balance ou charrue-bascule est composée de deux charrues reposant sur un essieu commun et se faisant face. Elle est équipée de corps versants fixés en sens opposé qui travaillent alternativement, dans un système de navette mis en action par un treuil. Le tambour du treuil est mis en mouvement par un moteur inanimé (locomotive-treuil, moteur électrique ou thermique). Ce système n’a pas été utilisé dans nos régions, à cause de la petite taille des exploitations.
 |
(a.maurepas.free.fr)
Avec l’avènement du tracteur, la charrue reste traînée. Elle est monosoc pour les petits tracteurs dont la puissance est inférieure à 20 CV et comporte 2 socs dans les autres cas. Des systèmes de relevage manuel, puis le relevage hydraulique qui équipe certains tracteurs dès 1960 permettent d’employer des charrues portées et cela facilite les manœuvres et les évolutions en fourrière.
Les charrues trisocs n’équipent que les tracteurs dont la puissance dépasse 40 CV. Actuellement la plus grosse charrue présente dans le village est une charrue brabant double semi-portée équipée de 7 socs, attelée à un tracteur d’une puissance de 190 CV (Gaec Saint Valentin).
 |
 |

Le tracteur Pony est équipé en option de 2 charrues
monosocs alternatives qui permettent le labour à plat.

Charrue bisoc traînée de type brabant simple.
 |
L’ameublissement des sols
Pour ameublir le sol, on laisse en priorité faire la nature en ayant recours à l’action mécanique des agents atmosphériques : la pluie, le gel et la sècheresse.
Mais il existe cependant quelques outils qui permettent de suppléer ou de parfaire le travail de la nature. Ce sont les scarificateurs, les extirpateurs,
les cultivateurs, les pulvériseurs, les herses, les rouleaux et les houes.
Le scarificateur, l’extirpateur et le cultivateur (de Grubber) qui ne se différencient entre eux que par la forme des dents, comprennent de petits socs montés sur des dents souples ou semi-rigides fixées sur un châssis de herse et permettent de soulever le sol pour l’aérer et extirper les mauvaises herbes. Ils peuvent avantageusement remplacer le travail de la charrue pour désherber un champ ou déchaumer après la moisson. 6 ou 7 de ces engins
à traction animale sont utilisés au village après 1945 (renseignement André Neu).
 |
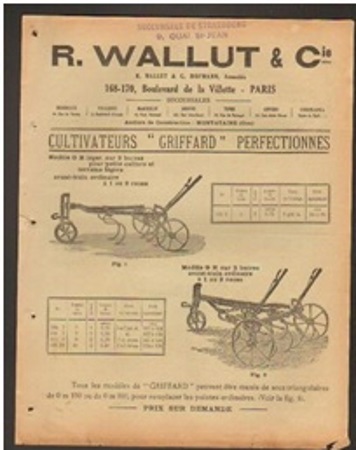 |

Le pulvériseur à disques simples (de Scheiweééj), utilisé pour ameublir le sol avant le semis ou pour déchaumer après la moisson, est à l’origine aussi
à traction animale. Il ne semble pas qu’un tel instrument à traction animale ait existé au village.

Déchaumeuse à disques tirée par un petit Pony Massey Harris modèle 812
(forum.grostracteurspassion.com)
 |
 |
Herses rigides en bois à dents métalliques. Photo de droite SHAG Grosbliederstroff.
La herse (de Ééj) est utilisée dans la préparation du sol pour compléter le travail de l’extirpateur, c’est-à-dire pour arracher et rassembler les mauvaises herbes, et aussi pour émietter le sol avant le semis. Elle sert encore, après le passage du semeur, à enterrer les grains jetés à la volée.
Traînée par la force humaine ou la force animale, la herse n’a pas beaucoup évolué au cours des siècles. Si une vache ou un cheval peut tirer une seule herse rigide, le tracteur moyen d’une vingtaine de CV tire une herse articulée, composée de plusieurs compartiments. La généralisation du relevage hydraulique sur les tracteurs dans les années 60 permet d’utiliser la herse en outil porté pour un meilleur rendement et un emploi plus aisé.

Le rouleau (de Wàlz) est à l’origine un cylindre en bois cerclé de fer, il est remplacé plus tard par un rouleau lisse en fonte, puis par un rouleau brise-mottes, appelé croskill. Son rôle est également de briser les mottes, mais aussi de tasser légèrement la terre pour améliorer le contact de la
graine avec elle. Il est aussi utilisé au printemps pour rouler les jeunes céréales d’hiver et favoriser ainsi le tallage.
 |
 |
Farmall FCD avec rouleau croskill.
(forum.grostracteurspassion.co)
La houe à cheval (de Hàcker) n’est employée que pour sarcler les cultures betteravières et de pommes de terre. Elle se transforme en buttoir (de Hiffler) pour butter les pommes de terre.
 |
 Photo machineagricole47.centerblog.net
|
3.2. Les semailles
Le semoir à cheval n’est utilisé que pour les grandes exploitations. Jusque dans les années 70, les semailles se font à la main, au moyen de l’antique sac de jute noué et porté en bandoulière (de Sääsàck). Une sorte de bassine en acier galvanisé (de Sääbitt) et portée grâce à des bretelles peut aussi servir pour les semailles et pour l’épandage des engrais en granulés comme l’ammonitrate (Kùnschdìnges).
 |
 |
Le geste auguste du semeur…

Semoir mécanique en lignes.
(Photo www.patrimoine-agricole.fr)
A Kalhausen, dans les années 70, Joseph Greff et Emile Hiegel utilisent un de ces semoirs en lignes derrière leur tracteur.
De petits épandeurs à engrais (ammonitrate, Kùnschdìnges et scories potassiques, Thomassmèhl) sont aussi utilisés, par l’un ou l’autre agriculteur comme Joseph Muller. Un tel équipement rarissime est alors parfois prêté par son propriétaire à d’autres exploitants.
Anecdote : l’épandeur en question est acquis plus tard pour la somme de 800 F par la commune de Kalhausen qui l’utilise un moment pour épandre du sel de déneigement (délibération du 25.02.1987).

Epandeur à engrais.
(Traitcharentais.wifeo.com)
 |
3.3. La fenaison
La fenaison, tout comme la moisson, est une opération d’envergure qui monopolise beaucoup de monde.
Au printemps, avant la croissance de l’herbe, il faut passer dans les prés avec le rabot à prairies (de Wiesehowwel) pour niveler les taupinières qui rendent le fauchage difficile et provoquent des bourrages de faucheuses.
A défaut de rabot, on peut utiliser les herses placées dents en l’air ou pour les petites parcelles la houe à manche (de Hàck). De nos jours, la herse de prairie est utilisée dans le but d’aérer le sol, d’araser les taupinières et de régénérer les prairies (émoussage).

(hippotese.free.fr)
Pour le fauchage de l’herbe, la faux à manche, que nous connaissons bien (de Mää), remplace peu à peu la faucille (de Sìschel) à partir du 14° siècle. La faux permet de travailler debout, contrairement à la faucille manipulée en position courbée. Le rendement à la faucille est de 20 à 30 a pour 8 à 10 heures de travail, alors que la faux permet d’effectuer le même travail 3 fois plus vite et avec moins de fatigue.

Faucheurs en ligne en train d’aiguiser leur faux.
La véritable révolution du fauchage est l’apparition aux Etats-Unis, de la faucheuse mécanique vers le milieu du 19° siècle.
L’apparition de la faucheuse mécanique (de Määmaschinn) a lieu aux Etats-Unis en 1847 : elle a une barre de coupe et fonctionne sur le principe d’une barre cisailleuse munie de couteaux triangulaires et animée d’un mouvement alternatif. Cette machine apparaît dans nos villages déjà avant la Première Guerre Mondiale. C’est une des machines acquises en priorité par tous les agriculteurs, car elle les décharge d’un travail long et pénible. Le rendement d’une telle faucheuse est de 20 fois supérieur à celui de la faux à manche.
Tous pourtant ne peuvent pas se l’offrir immédiatement et doivent continuer de faucher manuellement ou ont recours aux services d’un voisin ou d’un parent. (11)
_________________________
(11). La première faucheuse du village, une Deering, aurait été mise en service en 1902 par André Neu (1867-1919) qui l’a acquise auprès des établissements Joder de Rohrbach. (renseignement fourni par son petit-fils également prénommé André).
J’ai répertorié une cinquantaine de marques de faucheuses dont les plus connues sont Deering, Fahr, International Harwester, Mac Cormick, Massey-Harris, Moline et Osborne. La largeur de coupe est de 1m05 pour un cheval et 1m35 pour 2 chevaux. Elles peuvent être munies de roues à pneumatiques et d’un moteur auxiliaire.

Camille Zins, un ouvrier paysan,
et son attelage de vaches pendant la fenaison.
 |
Juin 1931. Le journalier Nicolas Lenhard achète une faucheuse
mécanique et une meule à aiguiser pour la somme totale
de 1860 F, soit environ 1054 euros.
Il paie un acompte de 500 F le 23 juin et le solde le 22 octobre.
mécanique et une meule à aiguiser pour la somme totale
de 1860 F, soit environ 1054 euros.
Il paie un acompte de 500 F le 23 juin et le solde le 22 octobre.

La faux pourtant sert encore longtemps, jusque dans les années 70, pour faucher de petites surfaces et les prés en pente ou compléter le fauchage mécanique, surtout dans un verger (ussbùtze). Finalement la faux sera complètement mise de côté, remplacée pour ces travaux de nettoyage, par la motofaucheuse et la débroussailleuse.
Dans la première moitié du 20° siècle apparaissent sur le marché des motofaucheuses, uniquement destinées à la coupe de l’herbe et non à la traction d’outils. Quelques marques se lancent dans cette production : Kramer, Fendt et Hagedorn en Allemagne, Daloz en France. Mais ces machines ne s’imposent pas, remplacées bientôt par le tracteur plus polyvalent.

Motofaucheuse Fendt de 1929
(Photo www.fendt.de)

Motofaucheuse Kiva des Etablissements Daloz (Jura)
(vieilles-soupapes.grafbb.com)
Les tracteurs sont alors dotés d’une barre de coupe latérale qui remplace avantageusement celle de la faucheuse à traction animale et donne un meilleur rendement (de Määbàlge). Cette faucheuse portée fonctionne toujours selon le principe de la lame cisailleuse. L’antique faucheuse continue pourtant encore à servir pour la moisson.
Le fauchage s’effectue le plus souvent le matin, lorsque la rosée n’est pas encore totalement évaporée, ainsi les fourmilières et autres taupinières risquent moins de provoquer le bourrage de la lame. L’idéal est d’être à deux : un pilote de faucheuse ou de tracteur et un aide pour manier le râteau et dégager l’herbe coupée afin de permettre le passage de la barre de coupe, surtout lorsque le pré n’est pas strictement rectangulaire ou carré
(ewèck rèsche).

1957. Notre tracteur Allgaier et la famille pendant la pause casse-croûte.
Notez la barre de coupe portée, la poulie de battage et le volant d’inertie propre à cet engin.
Avec la faucheuse apparaît également la meule à aiguiser, à manivelle ou à moteur électrique (de Schliffschdèèn).
 Meule à aiguiser en grès, à bain d’eau. |
 Meule synthétique plus moderne, à déplacement vertical |
Si la meule est mise en mouvement au moyen de la manivelle, il faut un aide pour la manœuvrer.
La fenaison effectuée manuellement exige peu d’outils : la faux, la fourche et le râteau. Cela suffit pour les petites surfaces.

Lucie Zins, 1984.

Juin 2014. Joseph et Emilienne Rimlinger fanent le foin
de leur verger comme il y a 50 ans. L’herbe destinée aux lapins
a été fauchée avec le motoculteur et sera mise en botte
par Gilbert Muller au moyen d’une ramasseuse-presse
La mécanisation introduit dans un premier temps non seulement la faucheuse, mais aussi la faneuse à fourches (de Gàwwellwènner) et la râteleuse ou râteau à cheval (de Pèèrdsrèsche) (12). Le système d’attelage de ces machines est transformé après l’achat d’un tracteur pour qu’elles puissent être remorquées désormais par le tracteur.
 (vieilles-soupapes.grafbb.fr) |
 (mrugala.net) |
____________________
(12). Le but du fanage est de soulever, de secouer et de retourner le fourrage laissé en andain par la faucheuse pour que les parties interne et inférieure soient à leur tour exposées à l’air et au soleil et sèchent. La faneuse à fourches comprend 5 ou 6 fourches articulées, décalées les unes par rapport aux autres et fixées sur un vilebrequin entraîné par les roues. Elle n’est pourtant pas très efficace, car elle soulève seulement l’herbe, sans la retourner.
Le râteau à cheval est à décharge intermittente, il rassemble le fourrage sec en petits tas. Il se compose d’une série d’arceaux ou dents dont l’extrémité inférieure râtisse le sol et dont l’extrémité supérieure est articulée sur un arbre commun. Quand les arceaux sont remplis de fourrage, le conducteur appuie sur une pédale et provoque leur relevage, grâce à l’arbre entraîné alors par les roues.
 |
Le râteau faneur-andaineur (de Schwààderèsche) se généralise après guerre, car plus efficace et polyvalent, puisqu’il permet de retourner le foin pour l’aérer ou de le disposer en andains pour le chargement (13). Le râteau andaineur à disques (de Sùnnerèsche) a peu d’amateurs dans le village à cause de son manque de polyvalence. Joseph Pefferkorn en utilise un.

(ferguson-en-perigord.com)
(13). Le râteau-faneur est à décharge latérale continue, il a un tambour long et disposé obliquement par rapport à l’essieu. Ce tambour, entraîné par les roues, est muni de grands peignes à dents flexibles qui râtissent le sol. Un dispositif permet de faire tourner le tambour dans le même sens que les roues, pour éparpiller l’herbe vers le côté dans le cas du fanage, ou dans le sens contraire, pour le râtelage.

1966. Fanage. André Neu pendant la fenaison
sur le Fendt Dieselross F28 avec le râteau-faneur-andaineur.

Plus tard avec le tracteur Allgaier.
Le chargement du foin en vrac perdure jusque dans les années 70.
Il faut au minimum 3 personnes pour charger une charrette de foin et souvent tout l’après-midi y passe, déplacement et déchargement compris : le père de famille charge le foin au moyen de la fourche à 3 dents (gàwwle), la mère, debout sur la charrette, dispose le foin, (lààde), et un enfant râtelle le foin, (nòh rèsche).
Charger tout seul une charrette demande beaucoup plus de temps et d’efforts. Jacques Lett, (de àlde Schmìtt (1877-1957), était souvent obligé, à un
âge avancé déjà, de rentrer tout seul son foin, car il ne pouvait compter sur l’aide de son fils Léon, occupé à la forge. Il partait dans les champs en emmenant… une échelle, qui lui servait à monter sur le chargement de foin, afin de le disposer correctement. (anecdote racontée par André Neu)

Quand le chargement du foin est terminé, il faut "peigner"le foin, c’est-à-dire égaliser le chargement au moyen d’un râteau pour éviter de perdre quelques brins pendant le déplacement (de Wòòn àbrèsche). Ensuite, il faut comprimer le chargement au moyen d’une longue perche de sapin à encoche,
(de Wìesbòòm) : cette perche est bloquée par l’encoche, à sa plus grosse extrémité, dans l’espèce d’échelle de l’avant de la charrette, (de Gàlsche) et ensuite mise sous tension au moyen de cordes et d’un treuil fixé à l’arrière de la charrette (de Wìnn).
 Egalisation du chargement de foin. |
 Mise en place de la perche de sapin. (Photo host2.ambach.de) |

Le treuil démonté (de Wìnn) et les bois
servant à la manœuvre (de Wìnnhélzre)
 Chargement de foin en vrac sur une charrette à échelles (e Lèèderwòòn). On reconnaît à l’avant l’échelle (de Gàlsche) dont les barreaux servaient à bloquer la perche (de Wìesbòòm) destinée à comprimer le chargement pendant le transport |
 De gauche à droite, Jacques Stéphanus, son beau-frère Jacques Steffanus et sa sœur Adèle devant une charrette à plateau munie de pneus. |

Pas moins de 4 personnes (plus le photographe) travaillent
au chargement de la charrette de foin. Les chevaux sont parfois énervés
par les taons et peuvent s’emballer. On les enduit d’un répulsif, Brùmseéél.
Parfois tous les moyens sont bons pour rentrer la récolte de foin. André Freyermuth, entrepreneur en maçonnerie, ne possède pas encore de tracteur, mais il a un camion GMC pour effectuer ses transports de matériaux. Il utilise tout naturellement ce véhicule pour rentrer ses récoltes, avant d’acquérir un tracteur, plus adapté à l’agriculture. (communication d’André Neu)
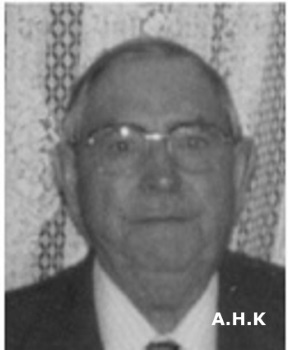
André Freyermuth
(1903-1994)
(1903-1994)
Le chargement mécanisé du foin est réalisé dans les grandes exploitations au moyen du ramasseur-élévateur-chargeur (14). Cette machine permet un chargement mécanisé du foin. Elle est remplacée plus tard par la ramasseuse-presse.

Le ramasseur-élévateur de foin pouvait aussi
se placer entre le tracteur et la remorque.
Les premières presses à être utilisées dans le village sont des presses à basse densité appelées botteleuses (e Haupréss) (15). Mises en mouvement par la prise de force du tracteur (de Zàppwèll), elles ne compriment pas vraiment le foin et se contentent de faire des bottes, de plus elles ne peuvent pas être utilisées pour la récolte du regain, trop court et ne tenant pas dans une botte.
Le garde-forestier privé de Weidesheim, Charles Dehlinger, qui exploite aussi un petit train de culture, possède un petit tracteur Pony et utilise une botteleuse avec moteur auxiliaire Bernard. (renseignement André Neu)
________________
(14). Le chargeur-élévateur se compose d’un châssis sur 4 roues sur lequel est monté un organe-ramasseur appelé pick-up qui prend le fourrage disposé en andain et le passe à un élévateur composé d’un tapis roulant sans fin qui le déverse directement sur la remorque où un ouvrier le dispose correctement.
 Jean Baptiste Neu avec ses fils, André et Fernand à Hutting. Chargement direct sur la remorque de bottes basse densité liées par une botteleuse Heywang |
 Gérard Lenhard sur un tracteur Vendeuvre Super BM 57 attelé d’une botteleuse John Deere Coccinelle. |
Certains cultivateurs préfèrent acquérir une remorque autochargeuse (e Lààdewòòn) qui leur permet de charger le foin en vrac, sans aucune aide. C’est le cas de Joseph Stephanus, Joseph Stock, Jean Demmerlé, Camille Zins, Marcel Thinnes et Alphonse Schreiner entre autres (16). Une telle remorque est toujours utilisée par Antoine Demmerlé pour rentrer une partie de son foin, le reste étant pressé.
_________________
(15). La botteleuse ou pick-up botteleur est équipée d’un organe ramasseur envoyant le fourrage dans la botteleuse qui en fait des bottes à 2 liens (Bììrde). Les bottes, soit tombent à terre et sont chargées ultérieurement, soit sont poussées directement sur la remorque par un canal.
 Autochargeuse toujours utilisée par Antoine Demmerlé et entreposée à l’extérieur, faute de place. |
 Deux autochargeuses au centre-village (Marcel Thinnes et Jacques Stephanus). Celle du premier plan est chargée de petites bottes. Elle ne s’est pas chargée toute seule, contrairement à sa fonction. |
Les presses à haute densité apparaissent ensuite et permettent de réduire le volume du fourrage à engranger car le foin est cette fois bien pressé, mais le poids des bottes s’en ressent.

Notre John Deere 500 attelé d’une ramasseuse-presse Fahr à haute densité
Des équipements complémentaires sont mis en place par l’un ou l’autre agriculteur du village : le lanceur de bottes hydraulique fixé derrière la ramasseuse-presse, qui permet le chargement direct des bottes de foin haute densité sur la remorque et les remorques-cages permettant une meilleure stabilité du chargement dans les dévers (Fernand Neu), ainsi que le groupeur de bottes (Grégoire Muller).
___________________
(16). L’autochargeuse est une remorque-cage, à 2 roues, équipée d’un pick-up qui ramasse le fourrage et d’un tapis roulant qui le transporte vers le fond de la remorque. Pour décharger le fourrage, on ouvre la porte arrière de la remorque et on fait marcher le tapis roulant dans le sens inverse du chargement. Le mécanisme est mis en mouvement par la prise de force du tracteur.

Groupeur de bottes destiné à être attelé derrière la presse.
Le déchargement et l’engrangement de la récolte de foin et de regain se font désormais aussi mécaniquement, au moyen de la déchargeuse à griffe, appelée encore engrangeur (de Hauàblààder ou Greifer) (17).
 |
 |
Déchargeuse et son charriot. A droite le treuil.
________________
(17). L’engrangeur à griffe a un rail fixé le long du faîtage du fenil. Un petit charriot (de Lààfkàtz), portant une griffe suspendue à un câble, circule le long de ce rail. Grâce à des cordes agissant sur un treuil mû par un moteur électrique, on commande la griffe qui descend ouverte, dans la grange ou, selon le cas, le long du pignon, sur la remorque fourragère. En remontant, elle se ferme et se charge, monte et s’enclenche sur le charriot qui la transporte alors le long du rail. Une butée, disposée à l’endroit voulu, provoque l’ouverture de la griffe et le déchargement de son contenu. Un contrepoids, parfois visible en façade, permet le retour du chariot et la descente de la griffe.
La première déchargeuse à griffe est installée au village par l’entreprise Siebert de Hundling avant 1939 chez Charles Demmerlé, dans la rue des jardins (de Éddìnger Kàrl, ìm Hohléck). Communication faite par André Neu
Il existe aussi de petites griffes manipulées par la force des bras, au moyen d’une corde et installées dans les fermes des Kìhbuure.

Déchargeuse à bras. Rhodes. A noter que le nœud
de la corde empêche la montée totale de l’engrangeur
Le déchargement se fait en général à partir de la grange, mais aussi à partir du pignon (Florian Stéphanus, de Schdèffe, rue des fleurs) et même à partir de l’usoir situé devant la ferme (Emile Hiegel, rue de la montagne). L’installation d’une déchargeuse à griffe suppose dans tous les cas une transformation de la charpente au niveau de la travée grange-étable : modification des fermes de la charpente ou construction d’un auvent du côté du pignon ou en façade.
Le déchargement se fait au moins à deux : une personne sur la charrette qui manie la griffe de la déchargeuse et commande le treuil, et une autre au fenil qui égalise le foin. En cas de forte chaleur, l’air est irrespirable au fenil et ceux qui y travaillent sont exposés aux poussières et suent beaucoup.
 Dans la rue de la montagne, la ferme Hiegel possède un auvent en façade. Photo des années 60. |
 La ferme Meyer de la rue des jardins a un auvent du côté du pignon, ce qui est plus courant. |
Peu de souffleurs à foin ou aéro-engrangeurs (e Haublääser) sont mis en service, sinon là où l’installation d’une déchargeuse n’est pas possible par manque de place. C’est justement le cas pour l’exploitation de Jean Pierre Freyermuth : sa ferme, suite à des transformations, est dépourvue de grange et toutes les récoltes de foin et de regain doivent être mises à l’abri au fenil, par l’intermédiaire d’une gerbière. Le déchargement se fait donc à partir de la rue, soit manuellement, soit au moyen d’un souffleur à foin ou aéroengrangeur, installé devant la maison et actionné par un moteur électrique ou le tracteur. (18) D’autres souffleurs à foin fonctionnent chez Joseph Phillip et Joseph Stock.
(18). Le paysan décharge la remorque au moyen d’une fourche et jette le fourrage dans la trémie de la machine où un puissant ventilateur mis en mouvement électriquement "souffle" le fourrage dans une grosse tuyauterie (60 à 80 cm de diamètre) qui monte dans le fenil. Cet engin provoque beaucoup de poussière et n’est pas très apprécié des personnes chargées d’égaliser le foin au fenil.
 |
 |
La terre aux souliers. Paul de Busson et Michel Laurillard. Edition Serpenoise.
Un élévateur à bottes est même installé au village dans les années 80 par un exploitant dans le but de remplacer la déchargeuse à griffe inadaptée pour engranger les bottes de foin ou de regain parfois un peu lourdes.

La grange Lauer de la rue des jardins.
Notez l’auvent permettant à la griffe de la déchargeuse
de monter et descendre, ainsi que l’élévateur à bottes,
installé plus tard et rendant l’utilisation de la déchargeuse désormais impossible.
L'élévateur et l'auvent viennent d'être démontés recemment.
En ce qui concerne le fauchage, dans la seconde moitié du 20° siècle apparaissent des barres de coupe plus performantes, à double lame, pourtant encore sujettes au bourrage, puis des faucheuses rotatives à tambours et à disques, sur le principe des tondeuses à gazon. Ces nouvelles faucheuses, portées à l’arrière du tracteur grâce au système de relevage trois-points, permettent d’éviter le bourrage dû aux taupinières et à l’herbe coupée traînant sur le sol et par là amènent un gain de temps non négligeable. Actuellement les faucheuses-conditionneuses permettent de réduire le temps de séchage du fourrage.

Faucheuse-conditionneuse.
(tracteurs-actuels.fr)
En ce début de 21° siècle, la fenaison a perdu de son importance au profit de l’ensilage et d’autres machines ont vu le jour, telle l’ensileuse, les presses à balles rondes (les rounds ballers) et à grandes bottes, les enrubanneuses, les chargeurs manuscopiques.
Les râteaux faneurs ou andaineurs, ainsi que les remorques sont devenus gigantesques. Le travail s’est mécanisé de telle sorte qu’une seule personne peut désormais s’occuper, sans fatigue, de toutes les différentes phases de la fenaison.

Andaineur à 2 rotors, largeur de travail jusqu’à 6,45 m.
(Gaec Saint Valentin)
3.4. La moisson
Même si dans nos villages les exploitations étaient de taille réduite, la moisson requérait aussi une main d’œuvre importante et le battage des céréales occupait une bonne partie de l’automne, sinon de l’hiver. Les premiers outils utilisés dans l’Histoire, pour la moisson, sont la faucille, puis la faux à manche.
Si l’utilisation de la faucille pour couper les céréales disparaît entièrement au cours du 19° siècle, l’usage de la faux perdure pour les petites parcelles de quelques ares.
La faux devient l’outil-roi de la moisson au 19° siècle. Cette faux exclusivement utilisée pour la moisson et appelée faux armée (de Flètsch) est munie d’un dispositif destiné à rabattre les céréales.
 |
 |
Faux armée pour la moisson (de Flètsch), faucille (de Sìschel) et coffin en corne (de Kùmb),
porté à la ceinture et contenant la pierre à aiguiser (deWètzschdèèn).
Si un faucheur à la faucille pouvait moissonner entre 15 et 20 a à la journée, un bon faucheur à la faux faisait entre 40 et 50 a de blé ou de seigle, et même de 60 à 65 a d’orge ou d’avoine.
La moissonneuse mécanique brevetée par Mac Cormick en 1834 et présentée à l’Exposition Universelle de Londres en 1851 remplace avantageusement la faux armée. Cyrus Mac Cormick se fait fort de faire moissonner 5 ha par jour par 2 personnes.

Le monde agricole accueille avec enthousiasme
la première moissonneuse. On voit les javelles derrière
le passage de la machine.
(Photo Dominique Pascal. Tracteurs de chez nous)
La faucheuse-moissonneuse Osborne est en fait une faucheuse, à laquelle on a adapté un dispositif pour moissonner, c’est-à-dire pour former des javelles. Son emploi est généralisé dans les fermes, avant 1939, et perdure jusque dans les années 1960, surtout chez les petits exploitants.

En haut la faucheuse mécanique et en dessous la même machine appelée faucheuse-moissonneuse et
transformée pour la moisson par l’adjonction d’un second siège et d’un tablier distributeur à l’arrière de la barre de coupe.
L’aide prend place à côté du conducteur et avec un râteau spécial, rabat les tiges sur la scie et forme les javelles.
Il peut relever et rabaisser le distributeur avec son pied. Le distributeur relevé ramasse les tiges coupées.
Si la quantité de tiges coupées est suffisante pour en faire une javelle, on rabaisse le distributeur et la javelle glisse sur le sol.
Une troisième personne pose un lien au sol, une quatrième personne ramasse la javelle avec une faucille
et la pose sur le lien. Enfin une cinquième personne noue le lien.
La gerbe est ainsi confectionnée. Il ne reste plus qu’à dresser les gerbiers.
 Râteau à javelles, de Léggerèsche. |
 Liens pour nouer les gerbes, Schtränckle. Après la guerre, on utilisa du câble téléphonique US récupéré, Hockékààbel. |
 Familles Jean-Pierre Freyermuth et Nicolas Lenhard pendant la moisson. |
 Famille Henri Hoffmann |

Les chevaux en plein effort.
La moissonneuse-javeleuse (de Sèèlbscht àbléijer) a l’avantage de faire des javelles toutes identiques et de dégager le passage des chevaux pour le tour suivant, de sorte que l’on peut moissonner le champ, sans avoir à déplacer les javelles à chaque tour. Il ne semble pas qu’une telle machine ait fonctionné dans le village.
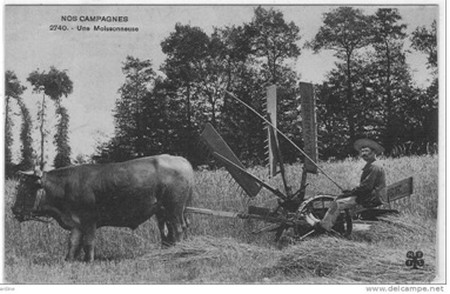
La javeleuse est équipée d’un tablier et d’une série
de râteaux qui rabattent les tiges sur la scie, forment
les javelles et les évacuent sur l’arrière.
 |
Cette machine apparaît dès 1870 dans les fermes et son rendement est de 2 à 3 ha par jour. Elle ne s’imposera jamais car sa qualité de travail est contestée : les javelles sont mal faites et disposées de façon inégale. Une telle machine ne semble pas avoir fonctionné au village.
La moissonneuse-lieuse (de Bìnner) est un progrès considérable car les gerbes sont nouées automatiquement, elles sont bien régulières et le gain de temps est important. Le rendement est de 4 à 6 ha par jour pour une machine tirée pour 3 chevaux remplacés toutes les 4 h (19).

Dans cette publicité pour la moissonneuse-lieuse,
la chronologie n’est pas respectée,
car le passage de la faux à la moissonneuse-lieuse
se fait par des étapes intermédiaires (faucheuse-moissonneuse, javeleuse).
la chronologie n’est pas respectée,
car le passage de la faux à la moissonneuse-lieuse
se fait par des étapes intermédiaires (faucheuse-moissonneuse, javeleuse).
 |
Cette machine est aussi à traction animale et elle apparaît timidement dans nos villages pendant la Seconde Guerre mondiale. Les petits exploitants, ceux qui utilisent des vaches de trait et qui les remplaceront plus tard par un tracteur, continuent de moissonner avec la faucheuse dotée du système Osborne.
_________________
(19). La moissonneuse-lieuse comprend un moulinet-rabatteur (de Hàschbell) qui couche les tiges sur la scie (de Bàlge) derrière laquelle se trouve un tapis roulant transporteur (en fait une toile renforcée de liteaux) suivi de deux toiles élévatrices qui amènent les tiges sur la table de liage où les gerbes sont liées et évacuées sur le côté.
Ce sont les exploitants aisés, les (Pèèrdsbuure) qui se lancent dans l’achat d’une moissonneuse-lieuse. Les premières de ces machines sont acquises par Chrétien Stephanus et Joseph Greff pendant la guerre, ce sont des machines Cormick Deering (communication d’André Neu). L’utilisation ultérieure du tracteur oblige à changer le dispositif d’attelage et les roues de transport sont désormais munies de pneus.
Plus tard de petites moissonneuses-lieuses JF apparaissent aussi au village (Jean Koch et Pierre List). Ces dernières n’ont qu’une seule toile derrière la barre de coupe.

Moissonneuse-lieuse pour tracteur
(machineagricole47.centerblog.net)
La coupe peut se trouver à droite ou à gauche,
elle peut mesurer 1m 50, 1m 80 et même 2m 10,
voire 2m 40 pour la traction mécanique.
La traction animale se fait au moyen de 2 à 4 chevaux.
Un attelage spécial existe pour des bœufs, sans palonnier ni
barre de recul, mais avec un dispositif pour fixer le joug.

Moissonneuse-lieuse JF Heywang au travail.
(lepopulaire.fr)
La faux armée continue pourtant encore à rendre service jusqu’à l’avènement de la moissonneuse-batteuse pour "détourer" un champ, c’est-à-dire pour faucher un passage de la largeur de l’attelage de chevaux ou de la largeur du tracteur dans le but d’éviter de coucher les céréales et de les perdre
(’s Schdìck òònhawwe ou frèi määe).

Les gerbes sont bien alignées, le champ est presque moissonné.
Il ne reste plus qu’à rassembler les gerbes en moyettes, de Käschde schdélle.

Les familles Florian Stephanus–Guy Duché.

La moissonneuse-lieuse est mise en position de transport sur route
 |
Facture de notre moissonneuse-lieuse achetée par l’intermédiaire du forgeron Schemel de Herbitzheim en 1952.
Le battage des céréales, qui s’effectue encore dans la première moitié du 19° siècle au fléau, est un travail long et pénible. Le fléau reste pourtant en usage avant la guerre de 39-45 pour battre le seigle dont la paille sert à fabriquer les liens des gerbes. Le battage au fléau permet de ne pas casser les fibres.

L’apparition des machines servant au dépiquage des céréales est un net progrès. L’égraineuse est actionnée par deux personnes ou au moyen d’un manège et plus tard par un moteur thermique ou électrique. Le nettoyage des grains au tarare (de Wònnmihl) reste l’opération complémentaire du dépiquage.
André Neu se souvient du fonctionnement d’une telle machine vers la fin de la seconde guerre mondiale, lorsque le village était privé d’électricité (automne 44-hiver 45). Une égraineuse passait de grange en grange pour permettre le dépiquage des céréales et remplaçait ainsi les batteuses mises au repos par manque de courant électrique.
Le dépiquage est une opération qui consiste à séparer les grains des épis.
 Lorsque l'égraineuse est mue par la force humaine, l'on ne présente que les épis, les tiges ne passent pas dans la machine. (Eschviller 2014. Fête des saveurs et traditions). |
 Tarare avec un crible entreposé dans la trémie. La manivelle est absente sur la photo. Le grain est nettoyé de ses impuretés (balle, poussières) grâce à un ventilateur et trié au moyen d’un crible. Le tarare remplace le vannage manuel qui se faisait un jour de grand vent avec un panier spécial appelé van. |

Photo www.jeantosti.com
La machine à battre ou batteuse (de Dréschmaschinn) (20) combine les deux opérations : dépiquage et nettoyage. Pour l’actionner, on utilise toujours la force animale fournie grâce à un manège horizontal ou un manège à plan incliné qui est en fait un tapis roulant appelé trépigneuse.
De nombreuses petites batteuses plutôt artisanales sont installées vers la fin du 19° siècle et au début du 20°, à point fixe, sur une plateforme, au fond des granges, et actionnées par des manèges. Elles sont toutes assez rudimentaires et n’ont souvent pas de tarare incorporé pour le nettoyage des grains.
La paille est liée manuellement sur une table de liage. Des tarares sont parfois rajoutés et fonctionnent avec la batteuse, ce qui permet alors un gain de temps. Ainsi Adam Stephanus (Schtrùmpwééwersch Ààdàm) a fabriqué un de ces tarares pour la batteuse installée au fond de la grange. (communication de Nicolas Stephanus)
Ces machines sont raccordées au réseau électrique après 1918 et certaines fonctionnent jusque dans les années 70. Au village, les moteurs sont fournis par le ferblantier Alex Grosz qui tient une quincaillerie rue de la montagne. (renseignement André Neu)
 |
__________________
(20). L’organe principal de la batteuse est le batteur, en fait un cylindre horizontal muni de « battes » (de Trùmmell) qui en tournant froisse les épis contre le contrebatteur et en fait sortir les grains. Les organes secondaires sont les secoueurs (de Schìttlere) qui secouent énergiquement la paille à la sortie du batteur pour faire tomber les grains coincés dans la paille, les dispositifs de nettoyage (le tarare ou Wònnmihl) comprenant une soufflerie (e Blääser) destinée à chasser la balle, les poussières et les menues pailles et à classer les grains par densité, ainsi que des cribles (de Riddere) pour trier les grains par grosseur.

(13 juillet 2014 Eschviller Fête des saveurs et des traditions).
Petite batteuse Nold produite à Salmbach en Alsace.
Cette batteuse en long, à secoueurs disposés en largeur,
(e Brèètschìttler) est destinée à être placée sur une
plate-forme au fond de la grange. Elle est équipée d’un
tarare nettoyeur de grains. La table de liage est visible.
Les trépigneuses demandent moins de place qu’un manège horizontal et permettent aux entrepreneurs de travaux agricoles de déplacer les batteuses de ferme en ferme. Il ne semble pas que ce système ait fonctionné dans la région.
 |
 |
Le mouvement est transmis par courroie entre le plan incliné
et la machine (batteuse ou autre). Dans ce système, la position
du cheval est inconfortable et il ne peut « trépigner » plus de 20 à 30 mn sans pause.
La trépigneuse est remplacée par la machine à vapeur à partir de 1910.
Les machines à vapeur (la locomobile), puis les locomotives routières, les moteurs électriques et les premiers tracteurs prennent le relais pour actionner les batteuses mobiles qui deviennent de plus en plus imposantes et performantes.

(La terre aux souliers. Paul de Busson et Michel Laurillard. Edition Serpenoise).
Battage au moyen du tracteur qui actionne la batteuse et
au moyen d’un moteur électrique-brouette qui actionne
la presse à paille. Normalement un seul moteur peut actionner
les deux machines. A cette époque, on ne pense pas trop au danger présent
à cause des longues courroies et l’on déplore de nombreux accidents.
La paille, à la sortie de la batteuse, glisse sur un plan incliné fait avec des lattes et s’entasse sur une table de liage fabriquée également avec des lattes. Elle est mise en bottes manuellement et nouée de façon artisanale, avant l’introduction de la presse (de Schtrohpréss) mise en mouvement comme la batteuse, au moyen d’une courroie plate.
Le battage des céréales, qui se pratique généralement en morte saison, à la fin de l’automne et au début de l’hiver, exige une main d’œuvre abondante : 1 personne pour poser les gerbes sur une sorte de petite table, 1 personne pour enlever les liens (de Schträängle) ou plus tard, avec l’apparition de la moissonneuse-lieuse, pour couper le lien de ficelle (de Schnùùr), 1 personne pour alimenter la batteuse en gerbes (ìnnlééje), 1 personne pour nouer la paille (Schtroh bìnne), l’entasser et s’occuper des sacs de grains. Le battage se fait le plus souvent au fond de la grange, dans des conditions dures (bruit, semi-obscurité et poussière).
Les agriculteurs qui ne disposent pas de lieu de stockage suffisant pour entreposer les gerbes dans l’attente du battage, battent les céréales pendant la moisson, directement à partir de la charrette.
Les modestes batteuses à poste fixe de grange et les batteuses déplaçables munies de petites roues en fer, dont différents modèles sont fabriqués à Achen par l’entreprise Pétri (de Maschinne Pétri), fonctionnent jusque dans les années 70.
 |
 |
Deux vues d’une petite batteuse mobile Pétri entreposée sous un hangar à Achen.
C’est une batteuse en long, à secoueurs en long, dotée d’un tarare nettoyeur de grains.
C’est une batteuse en long, à secoueurs en long, dotée d’un tarare nettoyeur de grains.
 |
 |
Deux autres vues d’une batteuse à poste fixe Pétri.
Le tarare (photo de droite) est fixé sous la dalle qui supporte la batteuse.
C’est toujours une batteuse en long, avec des secoueurs également en long.
La première grande batteuse moderne du village, une batteuse en travers, est achetée par Joseph Greff pendant la période 1940-1945 et c’est un modèle allemand Ködel Böhm.(Renseignement fourni par André Neu)

(Photo dreschkirtag.at)
 |
(Publicité Kuhn pour batteuse mobile).
Ces batteuses en travers, à secoueurs en long (e Lòngschìttler) sont déplaçables
à l’extérieur de la grange, ou au moins sur le pas de la porte,
car il vaut mieux battre les céréales à l’air libre à cause de la poussière.
Une batteuse est dite « en travers » lorsque les tiges sont introduites parallèlement
à l’axe du batteur. C’est le cas des grandes batteuses. Dans le cas d’une
batteuse « en long », les tiges sont introduites perpendiculairement à l’axe du batteur.
On trouve des batteuses à poste fixe dans les fermes suivantes : Henri Hoffmann (Hènnrische), Chrétien Stéphanus (Jokkébels Krìschònn), Jean-Baptiste Neu, Florian Stéphanus (Schòòndersch), Auguste Muller (Thìewels), Joseph Greff, André Holtzritter, Florian Thinnes, Jean Koch, Pierre List (Muurhònse), Joseph Philipp (de Chef Sépp), Henri Bour (Schaarls), Nicolas Kirch à Hutting…

Batteuse à poste fixe Nold.
Claude Kirch. Hutting
Rodolphe Wendel et Jean Pierre Pefferkorn achètent des modèles Pétri (voir ci-dessus). Jean-Baptiste Neu achète en 1936 une batteuse Joder fabriquée à Rohrbach-lès-Bitche. En général, les batteuses sont installées dans les granges des maisons à 3 travées et plus, celles qui appartiennent à des cultivateurs aisés, les laboureurs ou Pèèrdsbuure. La place manque, pour leur installation, dans les granges des maisons des journaliers, les Kìhbuure, et d’ailleurs l’achat d’une batteuse n’est pas possible pour une petite exploitation.

Dans la grange Pefferkorn.
Batteuse à poste fixe Pétri. La peinture n’est pas défraîchie,
signe que cette machine n’a pas beaucoup travaillé.
Le tarare, qui a été démonté, est entreposé sur la batteuse.
Les agriculteurs qui n’ont ni la place ni les moyens d’un tel achat vont chez leur voisin ou un membre de la famille : ainsi Nicolas Lenhard (Schààcks Nìggel) bat ses céréales chez son voisin Florian Stéphanus (Schòòndersch) et Charles Rimlinger chez Joseph Philipp.
Les agriculteurs de Hutting, qui ne disposent pas encore du courant électrique, ne peuvent battre leurs céréales sur place. Ils sont obligés de les stocker dans leur fenil, puis de les recharger en automne ou en hiver et de les amener chez un agriculteur de Kalhausen. C’est en particulier le cas de Nicolas Kirch.
Une autre solution consiste à utiliser la grande batteuse mobile Lanz, achetée en 1942 par Florian Thinnes (Bàddisse Floriàn) et mise à disposition des agriculteurs du village ne possédant pas de semblable machine.
Une autre solution consiste à utiliser la grande batteuse mobile Lanz, achetée après guerre par Marcel Thinnes et mise à disposition des agriculteurs du village ne possédant pas de semblable machine. Pendant la moisson, la batteuse est installée dans un premier temps devant la maison, au début de la rue de l’abbé Albert. Elle fonctionnera plus tard, à l’abri des intempéries, sous le hangar édifié à gauche de la maison.
Les petits exploitants qui n’ont qu’une ou deux remorques de céréales à battre peuvent utiliser son installation qui fonctionne pendant 2 à 3 semaines, comme une entreprise de battage. Une seule fois, la batteuse est installée en dehors du village, sur le Wélschebèèrsch pour battre les céréales à la demande. (renseignements fournis par Marcel Thinnes)
Dans les années 50-60, certains agriculteurs qui ne veulent pas être tributaires de ce système et acquérir plus d’autonomie, achètent ensemble une grande batteuse moderne que l’un d’eux entrepose sous un hangar : à tour de rôle, ils viennent chercher la machine pour s’en servir. C’était le cas notamment de Jean-Pierre Freyermuth, Henri Hoffmann et les frères Gross qui travaillent ainsi en coopération. Le premier bat ses céréales dans un hangar élevé dans la rue des roses (à l’emplacement de la maison Lerbscher détruite pendant la guerre), les seconds dans le hangar qu’ils se sont fait respectivement construire dans la rue de la gare.

1970. Battage à domicile à Herbitzheim. La paille pressée
s’entasse sur l’usoir en attente de l’engrangement.
La batteuse et la presse à paille ont été installées dans
l’étable de gauche désaffectée. Les gerbes sont déchargées
de la remorque et directement battues.
L’avènement de la moissonneuse-batteuse (de Mähdréscher) sonne le glas des moissonneuses-lieuses et des batteuses qui sont pratiquement toutes vouées à la destruction à cause de leur encombrement. (21)
La moissonneuse-batteuse apparaît vers 1935 dans les grandes plaines françaises : elle est tractée par 2 forts chevaux ou un tracteur et actionnée par un moteur auxiliaire. Avec une barre de coupe de 2,70 m, le rendement d’une telle machine est de 8 ha par jour. Il suffit de 4 personnes pour assurer le service, alors qu’il en faudrait une bonne douzaine si on utilisait la moissonneuse-lieuse et la batteuse traditionnelles.
Seuls quelques "grands" exploitants agricoles de nos régions se lancent dans l’acquisition de ces engins. Dès après la guerre, une moissonneuse-batteuse tractée est utilisée par Lang, métayer d’une des fermes de Weidesheim.
___________________
(21). La moissonneuse-batteuse est une machine automotrice combinée en ce sens qu’elle permet de réaliser deux opérations en une seule passe, la coupe et le battage des céréales. Le grain est recueilli dans des sacs et plus tard, dans une trémie placée sur la machine. La paille est bottelée tout d’abord sur une table de liage fixée à l’arrière. Peu à peu on abandonne le bottelage et la paille est rejetée en ligne derrière la machine pour être pressée plus tard ou roulée.

Moisson sur le ban de Weidesheim.
Utilisation d’une moissonneuse-batteuse tractée.
Le tracteur semble être un Renault 3041, doté d’un
moteur 4 cylindres à essence d’une puissance de 30 cv.
La première moissonneuse-batteuse automotrice du village est acquise par Joseph Muller en 1965, auprès des établissements Wolff frères de Sarre-Union. C’est une Claas Europa d’occasion, mais elle ne lui donne pas entière satisfaction et elle est remplacée par une Claas Columbus neuve, l’année suivante.(renseignement fourni par Christian Muller)

Ces machines modernes sont alors servies par deux personnes : le conducteur et derrière lui, un aide, debout sur une petite plate-forme, qui s’occupe du remplissage des sacs et de leur fermeture. On fait glisser à terre, au moyen d’un petit toboggan, le sac rempli et noué. C’est Raymond Lohmann qui seconde Joseph Muller pendant la moisson. La paille est directement bottelée à la sortie de la moissonneuse-batteuse, ce qui n’est plus le cas actuellement.
Fernand Neu acquiert ensuite une Claas Mercur et moissonne pour les particuliers avec l’aide de Philippe Freyermuth. Son frère André, qui s’est installé à Siltzheim, acquiert, pour sa part, une Claas Matador déjà équipée d’une trémie et travaille pour les particuliers du village jusque vers 1975-1976.

Pour éviter un trop grand investissement, quelques exploitants achètent de petites moissonneuses-batteuses Massey-Ferguson ou Fahr d’occasion (Grégoire Muller, Joseph Stock, Adolphe Lenhard) ou des JF portées (Emile Hiegel, Jacques Stéphanus). Mais ces machines sont rapidement abandonnées et remplacées parce qu’elles ne sont pas assez performantes pour les premières (barre de coupe de 1,80 m seulement, moteur à essence) ou mal conçues pour les secondes (radiateur du tracteur toujours encombré par les débris de paille).
 Adolphe Lenhard. Petite moissonneuse-batteuse Massey-Ferguson 830 à moteur Peugeot. Largeur de coupe 1m80. Année 1990 |
 Moissonneuse-batteuse portée JF Modèle MS 70 Coupe 1m50. |
Le travail reste pénible à cause du bruit de la machine, de la poussière et de la chaleur dégagée par le moteur qui tourne à plein régime.
Certains conducteurs de ces machines supportent difficilement et la chaleur et la poussière et essayent par des moyens de fortune de s’en protéger, soit en dotant le poste de conduite d’un parasol, soit en portant carrément parfois un masque à gaz, comme le fait un jour Joseph Muller. (anecdote rapportée par Adrien Simon (+ mars 2017).
Et quand le champ est moissonné, il faut encore soulever les lourds sacs pour les charger sur la remorque. De retour à la ferme, les sacs doivent être déchargés à dos d’homme et souvent montés à l’étage de l’appentis, voire au grenier. Le travail reste pénible.

La remorque à plateau est bien chargée pour le retour à la ferme
Plus tard des élévateurs à grain remplacent le déchargement manuel et les moissonneuses-batteuses sont dotées d’une cabine climatisée et insonorisée. Les grains sont désormais récupérés dans des trémies fixées sur la machine, puis transbordés dans des remorques-bennes. Comme pour la fenaison, une ou deux personnes s’occupent de nos jours de toutes les phases de la moisson, sans trop de fatigue.
3.5. Autres travaux
L’entretien des cultures
Pour enrayer la croissance des mauvaises herbes, il faut au cours de l’été sarcler les betteraves et les pommes de terre. Le sarclage se fait manuellement grâce à la houe (de Hàck), mais la traction animale permet aussi de réaliser cette opération grâce à la houe à cheval (de Hàcker). Cet engin se transforme en buttoir (de Hiffler) pour butter les pommes de terre.
Le dernier cheval du village est utilisé jusque dans les années 70 par Auguste Muller pour tirer cet engin. Il est même prêté aux autres exploitants pour cette utilisation. Plus tard, le motoculteur effectue ces travaux avec moins de contraintes.

Houe à cheval.
(webmuseo.com)
L’échardonnage des champs de céréales se fait grâce à une petite lame fixée au bout d’un manche, l’échardonnoir (e Dìschelschdèscher).
Le traitement chimique apparaît également dans les années 60-70 pour traiter les mauvaises herbes dans les céréales : les premiers pulvérisateurs sont destinés à la traction animale et montés sur roues.

André Neu. Pulvérisateur porté de fabrication artisanale .
Les récoltes d’automne
Le repiquage de printemps et l’arrachage des betteraves en automne se font toujours à la main, ainsi que leur chargement et encavement.
La plantation et la récolte des pommes de terre s’effectuent au moyen de la simple charrue : le soc enterre ou déterre les tubercules et il faut encore remuer la terre au moyen de la pioche à deux dents (de Kààrscht) pour mettre à jours ceux qui sont restés enterrés.
L’arracheuse de pommes de terre (de Grùmmbèrre Ussmàcher) est la seule machine utilisée en remplacement de la charrue, mais elle ne fait pas le calibrage, ni le ramassage comme les machines actuelles (22). Peu d’exemplaires sont utilisés au village.

Arracheuse de pommes de terre traînée destinée à la traction animale.
Un cerclage de roues permet de rouler sur route.
(fr.topic-topos.com)
___________________
(22). Un soc de forme triangulaire soulève la butte renfermant les tubercules et les fourches montées sur un tambour rotatif, mis en mouvement par les roues, séparent les pommes de terre des fanes et de la terre.

La terre aux souliers. Paul de Busson et Michel Laurillard. Edition Serpenoise.
Les transports
La charrette à 4 roues est le moyen de transport le plus usuel : elle se compose d’un avant-train relié par une poutre (de Lòòngert) à l’arrière-train. Fabriquée par le charron du village, en collaboration avec le forgeron pour les parties en fer (cerclage des roues, essieux, freins à manivelle et à sabots : de Mékanick) elle est presque entièrement en bois (e Holzwòòn).
 |
 |

Charrette à ridelles ajourées
(Photos ala.u-strasbg.fr)
La charrette est une remorque à ridelles pleines (e Dielewòòn) ou à ridelles ajourées appelées des échelles (e Lèèderwòòn). L’on passe très facilement du stade ridelles pleines au stade échelles.
Les transports de fumier, de bois, de betteraves, de sacs de pommes de terre ou d’autres matériaux exigent des remorques à ridelles pleines. Cette configuration est utilisée par conséquent en automne, en hiver et au printemps.

Les bœufs tirent avec un joug.
La terre aux souliers. Paul de Busson et Michel Laurillard. Edition Serpenoise.
Pour la fenaison et la moisson, on utilise les échelles. La remorque plateau (e Prìttschewòòn) remplace peu à peu la remorque à ridelles, car elle a une plus grande surface de base que la remorque à échelles et elle est plus facile à charger.
L’empattement de la charrette pouvait se régler en faisant coulisser l’arrière-train le long de la poutre centrale : pour les charges lourdes, l’idéal était un empattement court, mais pour les charges plus légères, l’on pouvait augmenter l’empattement. C’est ce que mon père faisait, avant la fenaison, lorsqu’il passait du stade-ridelles pleines au stade-plateau. La capacité de transport était ainsi augmentée pour rentrer le foin en vrac.
L’idéal est bien sûr de disposer de 2 charrettes pour ne pas avoir à effectuer les transformations du stade ridelles pleines au stade ridelles ajourées et de pouvoir disposer à tout moment de l’année de la charrette adéquate. Mais cela est très rarement le cas.

Remorque plateau. On distingue l’espèce d’échelle (de Gàlsche)
et posée sur la charrette, la perche de sapin (de Wìesbòòm)
servant à arrimer le chargement en vue du transport.
Les ridelles pleines sont de simples madriers de sapin (Wòònsdiele) d’une épaisseur de 4 cm pour une largeur de 20 cm. Ils se placent sur les côtés et sont soutenus de chaque côté par deux poteaux en bois ou en fer disposés obliquement (e Kébbert). Ils se superposent et leur étagement peut varier
de 1 jusqu’à 3, selon le chargement. Le volume de chargement est fermé à l’avant et à l’arrière par des planches clouées en forme de trapèze isocèle
(e Koppbrètt).
Les ridelles pleines ont tendance à se déformer lors d’un chargement de matériaux (terre, sable, pierres) lorsqu’il n’y a pas de poteau de soutien central. Pour ne pas risquer leur rupture, il faut alors les maintenir, les "bander" au moyen de chaînes passées sous le chargement et tendues par un levier de bois.

Jean Pierre Hiegel, prêt à partir pour les champs, avec sa remorque à ridelles pleines.

Joseph Herrmann et un attelage de 4 chevaux pour transports difficiles.
Dans ce cas, on empruntait souvent un attelage à un voisin.

Attelage bovin à Herbitzheim.
La charrette à plateau est équipée à l’arrière de 2 perches (Héwwle)
servant à maintenir le chargement. Il peut aussi y avoir des perches à l’avant.
Les vaches tirent avec un collier (de Kùmmert).

Déblaiement de neige pendant la guerre 39-45.
On aperçoit bien les sabots du frein.

Jean Baptiste Neu et ses chevaux.
Dans nos régions, les chevaux ne tirent pas avec le collier, mais avec un bandeau de poitrail.
Photo André Neu.

On aperçoit sur la photo, outre la charrue, le fourgon hippomobile
du boulanger Ferdinand Neu et la pompe à purin.
Le tas de fumier est caché derrière un clayonnage de noisetier mis
en place en mai 1936 par les soldats du 26° RI cantonnés au village.
Photo André Neu.

Départ pour les champs avec la charrette à ridelles ajourées
Un cric à manivelle (e Wìnn) ou à levier (e Schméérbùck) permet de soulever la charrette à roues en bois pour démonter les roues et graisser les moyeux avec une graisse spéciale (de Kàrschschméér). Le graissage journalier n’est plus nécessaire avec les roues munies de pneus, puisque les moyeux sont dotés de roulements à billes ou à rouleaux parfaitement étanches et graissés à vie.
 Cric en bois à manivelle. |
 Cric en bois à levier. (Forum-outils-anciens.com) |
Les tombereaux ne sont pas d’usage dans nos régions et on n’apprend à les connaître qu’en Charente, pendant l’évacuation de 1939.
Déjà avant l’apparition du tracteur, la charrette à roues en bois est peu à peu détrônée par la charrette à pneus, (de Gùmmiwòòn), mettant ainsi pratiquement le charron du village au chômage.

Réparation d’un avant-train de charrette par les employés du forgeron Léon Lett.
Il n’est donc pas rare de voir des chevaux ou des vaches tirer une charrette avec des roues à pneus et l’inverse est vrai également, un tracteur remorquant une antique charrette avec des roues en bois. Dans ce dernier cas, la vitesse est obligatoirement limitée pour éviter la casse, les secousses et le bruit.
C’est le forgeron du village qui fait les ajustements nécessaires : adaptation d’un nouveau système d’attelage pour le tracteur, remplacement des anciens essieux par d’autres munis de freins à tambours et de pneus, installation du levier de frein sur le timon pour que le frein puisse être actionné depuis le tracteur (auparavant, le charretier marchait à côté de la charrette ou derrière elle dans les descentes et actionnait le frein à sabots, de Mékanick, en tournant une manivelle).
Le frein à sabots n’agissait que sur les roues en bois arrière, plus tard les freins à tambours agiront sur les roues avant et arrière grâce à 2 manivelles qu’il fallait actionner l’une après l’autre. En général, les freins étaient actionnés au début de la pente et agissaient pendant toute la descente. On ne les ouvrait qu’à la fin de la descente.
La première charrette munie de pneus est acquise auprès du forgeron Schemel de Herbitzheim, pendant la guerre, par Rodolphe Wendel. L’essieu à pneus du fourgon hippomobile qui servait pour la tournée de pain du boulanger Ferdinand Neu est monté dans les années 60 sur la charrette d’André List. (communications d’André Neu).
La charrette à châssis en bois est remplacée ensuite par la charrette en fer, plus moderne et plus solide. L’entreprise Bieber de Drulingen fabrique de telles remorques. Trois de ces remorques Bieber ont été recensées au village.
 |
Châssis en fer embouti de remorque Bieber.
Le levier du frein se trouve sur le timon (de Tissell)
et on peut tirer le frein depuis le tracteur grâce à une corde.
Le levier du frein se trouve sur le timon (de Tissell)
et on peut tirer le frein depuis le tracteur grâce à une corde.
Beaucoup de petits transports sont aussi effectués avec la charrette à bras (e Zìhwäänel), principalement pour rentrer les récoltes des jardins (de Gààrdeschdìgger) et surtout par les personnes ne possédant pas d’attelage. Une plate-forme est même prévue, munie de ridelles, pour charger le foin.

Jacques Lenhard au croisement de la rue des jardins et de la rue de la gare.

Jean Pierre Bruch et son épouse Monique rentrent de leur potager.
La charrette à 2 roues est une carriole à lait, servant à livrer
les bidons de lait à la coopérative laitière (e Mìllìschwäänel).
Dans les années 70-80 apparaissent des remorques spécifiques à 2 roues : les autochargeuses (e Lààdewòòn), les remorques à bois (e Holzwòòn), les bennes (e Kibber), les épandeurs à fumier (e Mìschtschprèèder), les tonnes à lisier. Les remorques à bois et les petites remorques à plateau sont le plus souvent des fabrications artisanales réalisées à partir d’un essieu de voiture ou de camion.

Hubert Stock.
Remorque à bois fabrication maison d’une contenance de 6 stères.
L’évacuation de la litière des vaches hors de l’étable est également mécanisée grâce à un évacuateur-élévateur à chaîne qui évacue le fumier de l’étable et l’entasse directement sur un tas. Joseph Muller disposait d’une telle installation dans la rue de la Libération, et c’était la seule au village.

Les autres agriculteurs utilisaient une brouette pour évacuer le fumier et l’entasser devant leur maison.

Brouette ayant appartenu à Henri Hoffmann (Hènnrische).
Longtemps le chargement du fumier sur la remorque se fait manuellement au moyen de la fourche à 4 dents (de Mìschtgàwwel) et le déchargement au moyen du croc à fumier (de Gròòbe). Ce travail pénible est mécanisé plus tard par l’usage de la grue à fumier (de Mìschtlààder) et de l’épandeur.

La terre aux souliers. Paul de Busson et Michel Laurillard. Edition Serpenoise.
Le chargement du fumier sur la charrette était aussi tout un art : après avoir entassé le fumier à hauteur des ridelles (1 ridelle par côté pour les transports légers, 2 ridelles pour les transports lourds), il fallait charger ensuite le fumier en "bâtière", en prisme. Pour éviter de perdre quelques fourchées de fumier en route, certains "battaient" la partie supérieure du chargement, celle qui dépassait des ridelles, au moyen d’une batte en bois,
(e Mìtschplätsch).
Actuellement presque tous les tas de fumier ont disparu des usoirs et les opérations de chargement du fumier se font rapidement et facilement au
moyen des tracteurs avec chargeur frontal ou des engins manuscopiques.

André Neu et son Fendt F 20.
La remorque est bien chargée, départ pour les champs.

Gaec Saint Valentin. Epandeur à fumier moderne, à vis verticale.
La gamme Dangreville va de 14,5 T de charge utile à 32 t.
Le purin, qui est stocké dans une fosse creusée sous le tas de fumier, doit être répandu de temps en temps : une pompe à bras, fixe ou mobile, et plus tard une pompe électrique (de Mìschsèèschbùmp), permettent le remplissage de la tonne à purin (’s Mìschsèèschfàss) montée sur la charrette.

La pompe à purin est visible dans un coin de l’emplacement à fumier.
(Photo prise à Herbitzheim).
La paille qui doit servir de litière est souvent trop longue, surtout celle de seigle, et on coupe la botte en deux, dans le sens de la largeur, avec un coupe-paille (e Schtrohschnieder).

Photo Shag Grosbliederstroff
Le nourrissage des bêtes
Les machines utilisées sont le coupe-racines (de Dickrìeweràtz) qui sert à couper les betteraves fourragères et le hache-paille (de Schtrohhächsler) qui réduit la paille en petits morceaux pour une meilleure digestion.
 |
 |
Ces machines sont actionnées à la main par une manivelle et plus tard par un moteur électrique.
Il y a encore le concasseur à grains (de Schrootmaschinn) qui écrase les céréales en farine plus ou moins grossière et qui est mis en mouvement électriquement et le cuiseur à feu de bois pour les pommes de terre destinées à l’élevage de porcs. (de Grùmmbèrrekocher)

Grange Dellinger. Rue des roses. Concasseur à grains.
La traite des vaches
La mécanisation de cette opération intervient vers le milieu de la seconde moitié du 20° siècle et ne permet de traire qu’une seule bête à la fois. Certains agriculteurs prennent l’initiative de traire dans les parcs à bestiaux en été, pour ne pas avoir à rentrer et à sortir tous les jours les vaches de l’étable. Ils utilisent une salle de traite mobile et la machine à traire (de Mèlkmaschinn) est actionnée par la prise de force du tracteur (de Zàppwèll). Mais cette configuration présente des inconvénients (bidons de lait à transporter, travail sous les intempéries) et elle est abandonnée au profit d’une salle de traite fixe à la ferme.

(agriculture73.skyrock.com)
Le sciage du bois (renseignements fournis par André Neu)
Bien que ce ne soit pas un travail agricole, le sciage du bois est en étroite relation avec l’agriculture.
Avant guerre, le sciage du bois de chauffage s’effectuait sur l’usoir de la ferme Neu au moyen d’une scie à ruban à poste fixe appartenant à Charles Neu et actionnée par un moteur électrique fixé à la façade de la maison. Les particuliers ramenaient leur bois et le déchargeaient sur l’usoir. Il était ensuite scié et rechargé sur la charrette.
Pendant la guerre et jusqu’en 1960, Jean Neu passait dans le village pour scier le bois au moyen d’une scie à ruban fixée à l’arrière d’un tracteur Kramer
K 12 appartenant à l’entreprise de machines agricoles Petri d’Achen, où il était employé.

(südkurier.de)
Le Tracteur Kramer K12 est doté d’ un moteur Deutz après 1939.
C’est un monocylindre horizontal refroidi par le système de la bouillotte.
Remarquez le volant d’inertie et la poulie de battage.
Après 1962, le sciage reprend à la ferme Neu au moyen d’une scie à ruban sur roues entraînée par l’un des tracteurs Fendt de la famille, au moyen d’une courroie plate.
 |
 |

Deux belles photos de sciage de bois conservées par André Neu et concernant sa famille.
Ci-contre, une moto-scie dont le moteur entraîne la lame et permet également de se déplacer.
(Photos André Neu).

Un véhicule Berliet portant une scie à ruban entraînée par un moteur de 9 CV.
Photo prise en 1935 à Saint-Louis-lès-Bitche.
(Photos André Neu).
Le jardinage
Jusque dans les années 70, les travaux de jardinage se font entièrement à la main, au moyen des outils traditionnels à manche : la bêche (de Schbààt), la houe (de Hàck), la pioche (de Kààrscht), la binette (’s Grääbel).
Ce n’est que dans la décennie suivante que la motoculture s’installe dans les jardins, avec l’apparition du motoculteur d’abord, puis des machines plus spécialisées comme les motobineuses et les motofraises. Ces machines ne sont utilisées que pour la préparation du sol.

Petit motoculteur pour le jardin.
En 1958, mon père rachète un motoculteur de ce modèle
au curé Fuchs de Herbitzheim, muté à Benfeld.
Il l’utilisera uniquement pour sarcler et butter les cultures.
Il n’a jamais pensé à l’utiliser dans le jardin.
(www.framaa.fr)

Le Kubota T 720 (252 cm3) déterre les pommes de terre
4. Les moteurs inanimés
4.1 Les motoculteurs
Dès avant la Première Guerre Mondiale, quelques constructeurs, comme Praga en République Tchèque ou Stock en Allemagne, se lancent dans la fabrication de charrues-automobiles ou motocharrues. Ce sont des engins immenses où les socs de labour pouvant aller jusqu’à 6, sont solidaires de la partie motrice le plus souvent à 2 roues frontales. Ces machines ne s’imposent pas à cause de leur manque de polyvalence et de leur inadaptation aux petites exploitations.


(vieilles-soupapes.grafbb.com)
Moline, aux Etats-Unis, conçoit en 1914, dans le même état d’esprit, un engin porte-outils, appelé "tracteur universel", composé d’un avant-train motorisé auquel peuvent s’atteler des outils aussi divers qu’un cultivateur, une charrue, un pulvériseur, un semoir, une moissonneuse-lieuse. Le conducteur s’installe à l’arrière, sur la machine tractée et pilote l’ensemble comme un gros motoculteur.

Tracteur Moline
(vieilles-soupapes.grafbb.com)

(mototracteurs.com)
Le concept du motoculteur est né et les constructeurs comme Somua, Agro, Simar, Soberfon, plus tard Bouyer, Staub et Energic vont mettre sur le marché toute une gamme d’engins à 1 ou 2 roues motrices, proposés à un prix modique et destinés aux petites exploitations qui veulent commencer à se motoriser. Mais le motoculteur reste cantonné dans la viticulture et le maraîchage et n’apparaît pas, à de rares exceptions, dans nos villages, avant les années 1970.
 |
 |
A gauche, motoculteur Somua 5 cv refroidi par eau.
A droite, motoculteur Agro.
(Photos Tracteurs de chez nous. Dominique Pascal. Editions MDM)
A droite, motoculteur Agro.
(Photos Tracteurs de chez nous. Dominique Pascal. Editions MDM)

(La Traction mécanique en Agriculture Tony Ballu
Edition La Maison Rustique)
A Herbitzheim, 3 gros motoculteurs Soberfon sont livrés dans les années 1960 par le forgeron Léon Schemel à des particuliers. L’investissement pour un tel engin est certes moindre que pour un tracteur, mais la conduite du motoculteur n’est pas aisée et ce sont exclusivement des ouvriers-paysans, propriétaires d’une petite exploitation, qui en font l’acquisition. Ces engins sont utilisés pour tracter la charrue (le conducteur est alors à pied), la faucheuse mécanique et la remorque à quatre roues (le conducteur prend place sur un siège).
 |
 |
Les motoculteurs Soberfon sont fabriqués à Lyon.
Le modèle S125 avoue 12 CV. Il a 5 vitesses AV et 1 AR.
(vieilles-soupapes.grafbb.com)
Le motoculteur moderne, de marque française (Staub, Bouyer) ou étrangère (Honda, Iseki, Kubota…) sert surtout dans les travaux de jardinage pour la préparation du sol (utilisation avec charrue et fraises), mais aussi pour le sarclage, le buttage et l’arrachage des pommes de terre, ainsi que le fauchage et le transport.

Motoculteur Honda F 700 acheté en 1979 par Adolphe Lenhard
pour la somme de 10 000 F, accessoires compris. Le réservoir n’est pas d’origine.
4.2 Les tracteurs après 1940
Après la période d’euphorie qui suit directement la victoire de 1945, on peut croire que l’évolution de la motoculture va rapidement prendre son essor. Ce n’est pourtant pas encore le cas, malgré de nombreux tracteurs importés des USA suite au plan Marshall, comme les Ford Ferguson, les Massey-Harris, les International, les Allis-Chalmers. En 1955, il n’y a encore que 323 000 tracteurs en France, dont la plupart à essence (207 000). Cela représente environ 5% des exploitations agricoles et le cheval de trait est toujours le roi de la traction.
Le véritable coup de pouce est donné à la motoculture par la création administrative, le 1er juin 1956, du "fuel domestique" détaxé. Cette décision du gouvernement permet au moteur diesel de s’imposer dans l’agriculture, au détriment du moteur à essence. Même si le tracteur diesel est plus onéreux à l’achat (de 25 à 35 %), son utilisation est plus économique : en effet le litre de fuel domestique ne vaut que 18 à 19 F en 1958 (soit entre 40 et 43 centimes d’euros actuels), alors que l’essence détaxée vendue aux agriculteurs coûte 53 F le litre (soit 87 centimes d’euros actuellement). (www.leparticulier.fr)
D’autre part, les progrès réalisés par les pneumatiques agricoles (apparus dès 1932) et la généralisation du relevage hydraulique ainsi que l’attelage trois-points et le blocage du différentiel permettent au tracteur de s’imposer face à la traction animale. Les tracteurs à chenilles, qui ne représentent que 7% des ventes en 1959 et dont les premiers exemplaires sont apparus en France après 1918 sur châssis de char Renault, perdent de leur importance au profit du tracteur monté sur pneus.
Enfin le développement des prises de force, dispositif déjà inventé en 1906 par la société française Gougis, fait complètement disparaître les moteurs auxiliaires montés sur certaines faucheuses, ramasseuses-presses ou moissonneuses-batteuses.
La silhouette générale du tracteur se fige, malgré quelques exceptions et innovations furtives. Dans sa conception et sa forme, le tracteur standard dérive de l’automobile : la majorité comporte 4 roues, dont 2 motrices et 2 directionnelles. De nombreuses variantes ont pourtant existé plus ou moins heureusement sans parvenir à s’imposer : 2 roues directrices AV et une roue motrice AR en forme de cylindre, 2 roues directrices AV et des chenilles AR, 2 roues motrices AR et 1 ou 2 roues directrices jumelées AV.
Des modèles originaux apparaissent aussi, mais demeurent éphémères. C’est le cas d’un engin au design étrange, imaginé par deux techniciens agricoles et baptisé par eux "tracteur moderne". Il s’agit d’un tracteur LTB (pour Louis et Tony Ballu), d’une puissance de 17 CV, produit seulement à 200 exemplaires après-guerre à partir de surplus américains (moteur de Jeep Willis et transmission GMC).

Drôle de silhouette pour un tracteur moderne !
(Le machinisme agricole Tony Ballu
Presses Universitaires de France 1951)

(forum.grostracteurspassion.com)
Le tracteur de type tricycle (LTB, Mac Cormick, Allis Chalmers et Deering) utilise la technique des roues jumelées, mais ne s’impose pas. Au début des années 60, Jean Pierre Freyermuth, par l’intermédiaire de Nicolas Lenhard fils, achète en Meuse un tracteur occasion de ce genre, un Allis-Chalmers. Mais cet engin ne lui donne pas satisfaction et il acquiert en 1967 un tracteur "normal", un Vendeuvre Super BM 57 de 1955.

Le modèle WC (C pour cultivating), d’une puissance de 25 cv,
est produit de 1948 à 1953. Il peut fonctionner à l’essence ou au pétrole.
Il ne dispose pas de barre de coupe latérale, mais d’une
faucheuse arrière traînée. Ce tracteur de fabrication américaine
a été importé en France grâce au plan Marshall.
Il a été conçu plutôt comme un engin porte-outils ventral.

Jean Pierre Freyermuth et son épouse Elisabeth
rentrent des champs sur leur Vendeuvre Super BM 57 de 1955.

La carte grise du tracteur
Le dispositif Ferguson (relevage hydraulique et attelage trois-points) se généralise après 1960 sur la plupart des tracteurs commercialisés : désormais le contrôle de l’outil attelé, surtout en profondeur de travail, se règle depuis le poste de conduite. De plus, l’outil est facilement et rapidement relevé pour le transport sur route, ce qui équivaut à un gain de temps, enfin les manœuvres sont facilités avec un outil porté et non tracté. Certes des systèmes de relevage existent déjà auparavant pour les charrues, avec leviers déportés et ressorts de compression, mais ils sont difficiles à mettre en œuvre.
Au fil des décennies, le poste de conduite du tracteur est amélioré : siège suspendu pneumatiquement, réglable en hauteur et confortable, cabine chauffée, insonorisée, puis climatisée remplaçant la simple tôle et le pare-brise du Lanz d’avant-guerre.
Dès 1959, des auvents Buisard en toile imperméable apparaissent, suivis immédiatement par la cabine légère en plastique Fritzmeier. Désormais la cabine est rigide et comporte depuis 1976 un arceau de sécurité incorporé obligatoire.

Publicité pour la cabine Buisard.
(forum.grostracteurspassion. com)

André Meyer sur son Massey-Ferguson équipé d’une cabine Fritzmeier.
La particularité de cette cabine est le pare-brise relevable.

Cabine artisanale sur le Fordson Power appartenant à Adolphe Lenhard
Avec le tracteur apparaît aussi le problème d’achat et de stockage du carburant et de l’huile de lubrification du moteur. Le dépôt de carburants le plus proche se situe à Sarralbe, ce sont les établissements Werner situés au port du canal. Deux ou trois grands fûts métalliques de 200 l sont alors acquis pour stocker le carburant. Les modalités de livraison ne sont pas aussi simples qu’aujourd’hui.
Le camion-citerne possède des compartiments pouvant contenir 1000 ou 2000 l. Comme il n’y a pas de compteur volumétrique sur le camion de livraison, les citernes sont pré-remplies du volume commandé (en général 500 l ou 1 000 l). De plus, le tuyau de livraison n’est pas très long, il n’y a pas de pompe et donc tous les endroits de stockage ne sont pas accessibles. Aussi faut-il souvent rouler les fûts vides au bord de la route, les faire remplir et ensuite de nouveau les remiser dans le hangar ou l’étable, avec tous les risques que cela suppose. (renseignements fournis par André Neu)
 |
Il est spécifié que les clients doivent vérifier le niveau du liquide
dans la citerne avant la livraison et contrôler que les citernes
sont complètement vides après le transvasement. (Collection personnelle).
Les premiers tracteurs agricoles apparaissent sur le ban de la commune en 1941 à Weidesheim et correspondent à une dotation des autorités allemandes en compensation des dommages de guerre subis.
Ce sont des Lanz Bulldog à boule chaude, d’une puissance de 30 cv et qui ont des roues à bêches en fer. (23)
____________________
(23). Il s’agit du nouveau modèle HR7 lancé en 1937 dont la version D 8506 est montée sur pneus à l’origine. Mais la pénurie de caoutchouc avait nécessité un montage sur roues fer, ce qui ne facilitait pas les déplacements. Quand il fallait traverser une route goudronnée, l’on était obligé de poser des madriers pour faciliter le passage.
Louis Greff, métayer de la première ferme gardera ce matériel jusqu’à son départ de Weidesheim en 1956. Rodolphe Muller remplacera le Lanz dès 1945 par un Farmall Diesel FCC. (renseignements fournis par André Neu)

Chacune des deux fermes est ainsi dotée d’un tracteur et d’autres équipements agricoles tels qu’une moissonneuse-lieuse, une charrue traînée Eberhardt à 2 socs, une déchaumeuse à disques, un semoir à cheval et une herse à 3 compartiments (renseignements fournis par André Neu).
Contrairement aux fermiers de Weidesheim, les agriculteurs du village prennent possession de vaches et de chevaux de trait en remplacement de leur bétail perdu lors de l’évacuation de 39. Seules les grandes fermes sont dotées de tracteurs par les autorités allemandes. Aucun tracteur n’est donc disponible à Kalhausen pendant la période de la guerre.
Pourtant un tracteur fait furtivement son apparition au village en automne 1945 : c’est un tracteur à chenilles, peut-être de la marque Hanomag et missionné par les autorités françaises pour remettre en état les parcelles en friches susceptibles de renfermer des munitions non explosées. L’engin blindé est piloté par un prisonnier de guerre allemand et fait partie de l’opération de déminage de la Moselle. (renseignements André Neu)
Il en va tout autrement dans le village voisin alsacien de Herbitzheim. Au retour de l’évacuation en Haute Vienne, les habitants de cette commune sont soumis pour la durée d’une année à un système collectif de mise en culture des terres agricoles de leur ban, laissées en friches depuis l’évacuation de 39. Tous les travaux de culture sont exécutés en commun par des volontaires rémunérés et deux tracteurs sont mis à disposition par les autorités d’occupation : un Lanz Bulldog de 30 CV à roues en fer (modèle HR7 version 8500) et un autre Lanz à chenilles de 55 CV (modèle D 1561). Chaque machine est confiée à 2 chauffeurs qui se relayent au volant.
 |
 |
 |
 |
Différentes vues de ces tracteurs avec leurs conducteurs.
Le semi-diesel à boule chaude connaît un immense succès avant et pendant la guerre de 39-45. Le démarrage du moteur, un monocylindre horizontal, sans soupapes, est particulière : pour que l’allumage et la combustion du mélange air-combustible pulvérisé puisse se faire, il faut préalablement chauffer la partie antérieure de la culasse formant boule chaude. Une lampe à souder à essence est fournie avec le tracteur et un emplacement spécifique est prévu pour son rangement.
Ce tracteur peut aussi démarrer à l’essence, car il possède une bougie d’allumage spéciale alimentée par un accumulateur. Ce mode de démarrage est instantané, et ne nécessite pas de préchauffage.
La mise en route du moteur se fait à la main, sur le côté gauche du tracteur, au moyen de la colonne de direction qui peut se désolidariser de sa base et en balançant le moteur dans un sens puis dans l’autre.
Il peut arriver que le moteur parte à l’envers et il faut alors couper l’injection pendant quelques secondes au moyen du levier de la pompe manuelle et le faire repartir dans le bon sens. Si le moteur tourne trop longtemps à l’envers, le graissage par pompe du vilebrequin ne se fait plus et cela peut détériorer le moteur.
Malgré sa rusticité, se fiabilité, ses frais d’entretien réduits et sa capacité à brûler des carburants aussi variés que l’huile de vidange par exemple, le semi-diesel a rapidement montré ses limites : raideur des commandes, consommation élevée en fuel et huile de graissage, vibrations fortes et bruit engendrant fatigue et inconfort.
Le moteur semi-diesel est peu à peu délaissé après 1945 au profit du moteur à essence, puis du moteur diesel.
De nombreuses marques commercialisent le semi-diesel, les plus connues étant la firme allemande Lanz de Mannheim (absorbée par John Deere) et la Société Française de Vierzon (absorbée par Case). Notons encore Bolinder (Suède), Landini (Italie), le Robuste (Hongrie) et le Percheron (fabriqué par la SNCAC de Colombes).
 |
 |
Les semi-diesels qui exploitent tous le système Lanz ont des airs de ressemblance.
A gauche un Robuste et à droite un Percheron.
Tout juste après guerre, le surplus de l’armée américaine sert dans l’agriculture et la Jeep militaire devient à usage agricole. Mon père acquiert un de ces engins provenant des surplus américains et il l’utilise dans l’exploitation agricole, pour tracter la faucheuse mécanique, la charrue bisocs, la herse et la charrette. La Jeep est utilisée en complément des chevaux qui sont employés, par le grand-père, pour d’autres travaux comme la traction de la faneuse à fourches ou du râteau. (24)
_________________
(24). Les jeunes générations (mon père n’a pas encore 30 ans à l’époque) sont portées vers le progrès et la mécanisation et il a déjà goûté à la motorisation agricole en 1941, puisqu’il était l’un des conducteurs du chenillard Lanz dont il est question plus haut. Mon grand-père par contre a dépassé la soixantaine et il reste fidèle à ses chevaux.
Dès aôut 1954 et jusque dans les années 60, la société Hotchkiss commence en France l’assemblage sous licence de la " Jeep Willys" destinée principalement à l’armée, mais aussi de la "Jeep Universal" destinée, comme son nom l’indique, à un usage plus général (agriculture, travaux forestiers, services d’incendie, véhicule de transport…) La "Jeep agricole"est dotée d’une prise de force et d’un relevage arrière et on peut de ce fait monter une barre de coupe latérale et une charrue portée arrière.
Ce genre de véhicule comble momentanément un manque de production de tracteurs dans les années qui suivent immédiatement la fin de la guerre, mais il ne s’impose pas, malgré sa polyvalence, à cause de son manque de puissance (13 CV) et de sa trop grande consommation en essence.
 |
 |
Le premier tracteur agricole apparaît déjà avant 1939 à Herbitzheim et son propriétaire, Jules Schmitt, appelé "Òndoons Schull" ou encore "de Maschinne Schull", l’utilise pour son entreprise de travaux agricoles. Dès après 1918, il acquiert un ensemble de battage (locomobile et batteuse) et se met au service des agriculteurs du village qui ne disposent pas de batteuse à domicile. Après la moisson, il installe ses machines en un lieu public et les agriculteurs viennent avec leur chargement de gerbes utiliser son installation.
Avec l’apparition du tracteur, il remplace la machine à vapeur par un tracteur Lanz. Il peut alors étoffer ses prestations et proposer dans le village le concassage des grains (schroode) ainsi que le sciage du bois de chauffage (Holz sääe). Il se déplace également dans l’une ou l’autre ferme isolée, comme le "Schtrohhoft", pour le battage. Je suppose que son tracteur est équipé de bandages ou de pneus, sinon les déplacements dans le village et à l’extérieur ne seraient pas aisés. La batteuse est mise en mouvement au moyen d’une grosse courroie plate, comme sur tous les chantiers de battage, ainsi que toutes les autres machines.
Un des premiers tracteurs de Herbitzheim est aussi celui acquis pendant la guerre par Auguste Weingaertner, menuisier, mais qui exploite aussi un train de culture. L’engin est un Zettelmeyer Z1 de 22 CV, avec moteur Deutz F2M414 refroidi par eau, et il lui sert entre autres à transporter des grumes jusqu’à la scierie de Keskastel. Dans ce but, il est muni d’un treuil arrière pour lui permettre de charger les grumes sur la remorque.

Zettelmeyer Z1
L’utilisation de la Jeep militaire n’est qu’une solution de dépannage pour mon père et il décide d’acheter un tracteur. La Jeep lui permet de se rendre à la Foire Internationale de Strasbourg à l’automne 1950 et c’est là qu’il visite le stand tenu par les ateliers Philippe Goetzmann de Lingolsheim, dans la banlieue de Strasbourg. Les établissements Goetzmann importent pour la France les tracteurs Allgaier fabriqués en Allemagne. Le choix de mon père se porte sur le modèle A 22 qui est mis à disposition à partir du 23 mai 1951, pour la somme totale de 1 076 640 F (25), barre de coupe et charrue comprises.
Pour l’anecdote, mon père se rend à Lingolsheim en train, le 11 juillet et revient par la route, au volant du tracteur. Le tracteur est muni d’une barre de coupe latérale de 1m50, de marque "Rasspe", et d’une charrue brabant double bisoc portée de marque "Eberhardt". Cette charrue double n’est pas d’usage dans nos régions et ne s’impose pas, vu la faible surface des parcelles, contrairement à la plaine d’Alsace. Là aurait pu être réalisée une économie substantielle.
____________________
(25). Soit la somme de 24 450 euros, ce qui représente le prix d’achat d’un véhicule automobile de gamme moyenne actuellement. Taux de conversion retenu 0,02271 d’après leparticulier.fr
 |
Facture avec l’échéancier de paiement.
(Collection personnelle).
(Collection personnelle).
De plus, la charrue portée est d’un poids non négligeable et peut provoquer le cabrage du tracteur. L’accouplement au tracteur est peu pratique car il faut démonter chaque fois la barre d’attelage (de Àckerschien) et le relevage trois points n’existe pas encore. Mon père n’utilise par conséquent pas beaucoup cette charrue, il revend plus tard la partie inférieure et achète une charrue traînée. La partie supérieure échoue dans un coin du hangar jusqu’à tout récemment où un ferrailleur l’a récupérée.
L’intention première de mon père était d’acquérir un tracteur Société Française "Vierzon", un 302, mais les délais d’attente étaient trop longs et son choix se porta donc sur le rustique Allgaier qui lui donnera quand-même satisfaction.
Le petit Allgaier à bouillotte, avec son rayon de braquage court, avec ses 4 vitesses AV et 1 AR est parfait pour les petits travaux de la fenaison, de la moisson et les transports. Il possède même un petit gonfleur à pneus qu’on peut faire marcher quand le moteur tourne. Mais son manque de puissance se fait vite ressentir lors des labours et des semailles, pour tirer la charrue et la herse, ainsi qu’en forêt, pour débarder le bois de chauffage. De plus, les vitesses ne sont pas assez nombreuses et bien étagées, ni synchronisées.
Sur la route, rétrograder est un exercice périlleux, car la vitesse inférieure se rentre sans embrayer et il ne faut pas rater le moment propice, sinon c’est l’arrêt et un démarrage en côte difficile avec une remorque chargée.
 (Semi-diesel 302 Vierzon Sfv.chez.com) |
 |
Dès janvier 1955, mon père achète des chaînes Adérosol (26) auprès d’une société basée dans l’Oise, pour la somme de 45 150 F. Ce dispositif composé de 2 demi-chaînes par roue arrière se monte sur place, dans les champs ou en forêt, et permet une meilleure adhérence des roues. Il est lourd à mettre en œuvre et n’est utilisé principalement que lors d’un automne humide pour rentrer les betteraves et semer le blé d’hiver ou en forêt.
Personne d’autre au village ne consent une telle acquisition. Un seul tracteur, un Cormick FCC, possède des roues à palettes rabattables pour pouvoir rouler sur la route. Ce système n’a pas besoin d’être démonté, mais cause du bruit quand on roule, à cause du jeu des pièces.
_____________________
(26). De nombreuses solutions sont inventées après-guerre pour pallier l’insuffisance d’adhérence des pneus agricoles. Ces systèmes plus ou moins efficaces et lourds à mettre en œuvre ont maintenant disparu, remplacés par des masses alourdissantes, des jumelages de roues et le gonflage à l’eau.
 |

Notre Allgaier équipé de chaînes et paré à débarder du bois en forêt
Peu de temps après, mon père fait l’acquisition, auprès d’un atelier de Brebach, en Sarre, d’un tracteur d’occasion, un Lanz Bulldog modèle D 7506, d’une puissance de 25 CV. Cet engin doit palier le manque de puissance de l’Allgaier et il n’est utilisé que pour les travaux difficiles, où il remplit parfaitement son rôle. Il dispose, suprême luxe pour l’époque, d’un auvent avec pare-brise et nous en sommes fiers, car c’est le seul tracteur du village à en posséder un.
 |
 |
Notre Lanz au labour, avec la charrue traînée.
Il faut dire que les tracteurs de l’époque ne sont pas aussi perfectionnés que ceux d’aujourd’hui : l’Allgaier démarre à la manivelle. Quand le moteur est froid, on utilise une mèche d’allumage et le lancement du moteur au moyen de la manivelle demande pas mal d’efforts.

Boîte de "cigarettes" d’allumage.
Le système de refroidissement du moteur n’est pas assuré par un radiateur et un ventilateur, mais par le principe de la bouillotte : un grand volume d’eau (53 l) entoure la culasse et cette eau se met à bouillir lors du fonctionnement du moteur. Il faut donc être attentif au niveau de l’eau de refroidissement et compléter chaque jour, voire pendant la journée. L’inattention de mon père cause ainsi l’éclatement de la culasse dès 1952 et une facture de 32 052 F (650 euros). De plus, l’utilisation d’antigel n’est pas possible, puisque l’eau de refroidissement se vaporise et pendant l’hiver il faut après chaque utilisation journalière laisser couler l’eau de refroidissement pour éviter qu’elle ne gèle.
La conduite du Lanz n’est pas plus aisée à cause du démarrage à la lampe à souder, après un préchauffage d’une quinzaine de minutes. Pendant certaines utilisations, comme le chargement de fumier sur la remorque, il est plus sage de laisser tourner le moteur au ralenti que de l’éteindre et ensuite perdre du temps pour le redémarrer au moyen de la lampe à souder. Le système de démarrage au moyen de la bougie n’est jamais utilisé, l’accu n’étant pas disponible sur le tracteur. Je me rappelle qu’un jour, au bout d’une longue descente pendant laquelle le frein moteur est utilisé pour freiner l’attelage, la boule chaude refroidit et le moteur s’éteint. Il faut de suite réchauffer un peu la boule pour continuer le trajet.
Mon père n’ose jamais rentrer dans la grange avec le Bulldog, car la grande cheminée d’échappement n’est pas pourvue de grille anti étincelles et le danger d’un début d’incendie est réellement présent.
Les progrès mécaniques sont rapides et nos deux tracteurs sont vite dépassés. Tous les autres agriculteurs du village profitent du progrès et acquièrent des tracteurs avec un démarreur électrique et le relevage hydraulique. Heureusement que le Lanz tombe en panne dans les années 68 (coulage de bielle à cause de la défection de la pompe de graissage) et mon père doit le remplacer par un engin plus moderne, certes d’occasion, mais qui possède le relevage hydraulique et l’attelage trois-points, acquis auprès des établissements Ackermann de Marthille, près de Morhange, pour la somme de 75 000 F (8 475 euros).
Nous sommes désormais assez fiers de notre nouveau John Deere 500, de sa puissance de 40 CV et de sa cabine. A l’époque, peu de tracteurs sont équipés d’une telle cabine. Le petit Allgaier continue par la suite de rendre de grands services parallèlement au John Deere.

Le John Deere 500 avec sa charrue bisoc portée.
Entre temps, de nombreux petits tracteurs apparaissent dans le village : des Lanz Diesel, des Hanomag R12, R19 et R24 livrés par le forgeron Schemel, des Farmall Cub livrés par les établissements Wolf de Sarre-Union, des Renault D22, un Allgaier-Porsche, un Labourier, un Babiole, un Map.
 |
 |
Lanz Diesel D 2416 et Hanomag R12
 |
 |
Cormick Farmall Cub et Renault D22

Allgaier-Porsche A113
Photos tirées des sites suivants :vieilles-soupapes.free.fr, royalenfieldlesite.com,
farmallcubforever.com, forum.norev.com et wordcarslist.com
Si en 1970, un tracteur de 40 CV peut être classé dans les engins puissants, ce n’est plus le cas quelques années plus tard avec l’apparition de tracteurs toujours plus puissants et dotés désormais de 4 roues motrices.
Le premier outil nouveau monté sur les tracteurs 2 roues motrices de moyenne puissance est sans conteste, à partir des années 50, la fourche à fumier
ou chargeur frontal (Fròntlààder) dans le but de faciliter la pénible manipulation du fumier. Cet accessoire est tout d’abord doté d’un seul bras et rend passablement service. L’arrivée du 4 roues motrices doté d’un chargeur-crocodile facilite les manœuvres.
Mais les contraintes nées des balles rondes, lourdes et encombrantes, qu’il faut stocker sur une grande hauteur et souvent sur un terrain inégal font en sorte que le tracteur équipé d’un chargeur est remplacé vers 2000 par un engin automoteur à bras télescopique plus sûr.

Chargeur frontal « maison » sur un petit Farmall Cub.
L’on doute fort de l’efficacité d’un tel dispositif sur ce tracteur.
(vieilles-soupapes.grafbb.com)
4.3. Les premiers tracteurs de Kalhausen
La décennie 1950-1960
Le premier tracteur de Kalhausen est acquis en 1952 par Joseph Greff, et c’est un Pony 812. Après la création du fuel agricole en 1956, les tracteurs à essence n’ont plus la cote et le Pony 812 est rapidement remplacé par un tracteur diesel, de marque Energic, plus puissant, acheté à Herbitzheim, chez
le forgeron Schemel. Mais cet engin est souvent en panne et dans les années 80, un Cormick le remplacera.

Joseph Greff (1902-1990)

(Photo lecompa.fr)
Le Massey-Harris Pony 812, construit de 1952 à 1957
à Marquette-lès-Lille, a un moteur Simca Aronde et
affiche 16 CV. Fiable, robuste, fonctionnel et bon marché,
il est qualifié de "plus puissant petit tracteur du monde".

Vue aérienne du tracteur Energic et de son propriétaire.
Le petit Pony sera à l’honneur lors du premier corso fleuri organisé par le syndicat des arboriculteurs, le 21 septembre 1952, journée de l’inauguration de l’atelier de distillation. Trois chars sont prévus ce jour-là pour défiler dans le village : 2 sont encore tirés par 4 chevaux chacun et l’un d’eux est remorqué par le premier tracteur du village, le Pony. Pourtant Joseph Greff n’a pas encore abandonné ses chevaux et il en met 2 à disposition des organisateurs, tout comme Jean Pierre Freyermuth, Henri Hoffmann et Marcel Thinnes.
Le second tracteur du village est un Champion Comet, il est acquis en 1955 par Edgard Spielewoy et sera utilisé par son frère Bruno, après le décès accidentel d’Edgard en 1970. C’est déjà un tracteur puissant pour l’époque (30 CV) et il impressionne les esprits par son aspect massif, face au petit Pony.

Edgard Spielewoy (1925-1970)

(Photo vieilles-soupapes.grafbb.com)
Le Champion est produit de 1952 à 1960 à Bar-sur-Aube
par la Société des Moteurs Cérès. Le modèle Comet affiche 24 CV.
Il a un moteur diesel bicylindre, 5 vitesses AV et 1AR.
Le troisième tracteur est acheté en février 1956 par Pierre Kremer : c’est aussi un Pony 812, mais ce tracteur, trop gourmand en essence, est remplacé 2 ans plus tard par le modèle 820 diesel. (renseignement fourni par Bernard Kremer)
 |

Pierre Kremer (1912-2003)

(Photo collection-agricole.fr)
Le Pony 820 diesel a un moteur 2 cylindres Hanomag et affiche 18 CV.
Il a maintenant 5 vitesses au lieu de 3 pour le 812 et le relevage hydraulique est en option.
Ensuite c’est Jean-Baptiste Neu qui se dote en mars 1956 d’un Fendt F20, suivi en 1960 d’un autre Fendt plus puissant, un F28, acheté pour la somme
de 700 000 F (renseignement André Neu).

Jean-Baptiste Neu (1902-1982)

(Photo fahrzeugseiten.de)
Construit de 1951 à 1956, le Fendt F20 a un moteur MWM
monocylindre vertical refroidi par eau. Il n’a pas de relevage.

Le Fendt F28, construit de 1952 à 1959, a un moteur MWM bicylindre
également refroidi par eau. Il a 5 vitesses AV et 1 AR.
(Photo flickriwer.com)

(1963)
Les 2 Fendt Dieselross devant la ferme Neu.
André est au volant du F 28.
Les 2 Fendt Dieselross devant la ferme Neu.
André est au volant du F 28.
Marcel Thinnes acquiert en 1957 un engin artisanal construit par son oncle Alphonse Freyermuth qui exerce le métier de forgeron à Sarralbe et a installé avant guerre pratiquement toutes les déchargeuses à griffe du village.
Ce tracteur artisanal est bâti sur un châssis de voiture, une Citroën C4 dont il reprend le radiateur et le capot du moteur. La motorisation est un CLM diesel (27) et la transmission provient d’un véhicule militaire. Le tracteur ne donne pas entière satisfaction et Marcel le remplace peu après, en 1961, par un tracteur diesel, un Allgaier A22, acheté d’occasion en Alsace pour la somme de 530 000 F. (renseignements fournis par Roland Thinnes et André Neu)

Marcel Thinnes (1927-)
 |
 |
1958. Un aperçu furtif du tracteur artisanal.
Aucun de ces engins ne dispose alors du relevage hydraulique et tous les outils sont traînés. En tout une quinzaine de tracteurs apparaissent au village pendant cette période.
__________________
(27). La CLM (Compagnie Lilloise de Moteurs) fabrique après 1932 des moteurs sous licence Peugeot-Junckers, destinés à la motorisation d’autorails, de camions, de bateaux et servant aussi de moteurs fixes dans les fermes ou les ouvrages de la Ligne Maginot. Ce sont des moteurs verticaux diesel, à 2 temps et comprenant 2 pistons travaillant en opposé dans une même chemise-cylindre. Le tracteur Labourier, fabriqué à Mouchard, dans le Jura, est aussi doté d’un tel moteur.

Ci-dessous exemples de tracteurs artisanaux.
(vieilles-soupapes.grafbb.com et le bon coin)

 |
 |
La décennie 1960-1970
C’est la période faste pour les concessionnaires de machines agricoles et pas moins d’une trentaine de tracteurs apparaissent au village.
Pratiquement tous les exploitants agricoles se dotent d’un tracteur, que ce soit ceux qui vivent exclusivement du travail de la terre ou les ouvriers-paysans. Personne ne veut être en reste et même les petits exploitants se mettent au goût du jour, sans trop se poser la question de la rentabilité. Ces derniers ne peuvent pas investir de grosses sommes et achètent souvent à tort de petites machines qui sont d’occasion, parfois inadaptées et qui ne les satisferont pas.
Ces petits tracteurs se montrent souvent peu performants ou trop gourmands en essence et se voient alors rapidement remplacés par des machines diesel plus puissantes et plus modernes, car dotées désormais d’un relevage hydraulique.
Les tracteurs de cette décennie les plus représentés au village sont le Fendt F 12, le Mac Cormick Farmall 135D et le Kramer KB 22.

(Photo motorstown.com)
Le petit Fendt Dieselross F12, produit de 1952 à 1958, a un moteur
monocylindre vertical MWM et affiche 12 CV. Il possède 6 vitesses AV et 2 AR.

Le Mac Cormick International F 135D est produit à Saint-Dizier de 1958 à 1960.
Il a un moteur diesel bicylindre et affiche 17 CV. Il a 6 vitesses AV et 1 AR.
Ici le 137D, produit de 1960 à 1964, piloté par Joseph Rimlinger.
Les caractéristiques sont les mêmes que pour le 135D. Le relevage hydraulique a été rajouté.

Le Kramer KB22 est construit de 1951 à 1957. Il a un moteur Güldner
bi-cylindre refroidi par eau. Il a 5 vitesses AV et 1 AR. Il affiche 22 CV.
Ci-contre le KB 22 de Jean Pierre Lenhard, conservé par son fils Ewald.
Le KL 22 a un moteur Deutz refroidi par air.
Quelques rares exploitants agricoles pourtant ne se lancent pas dans la motorisation pour diverses raisons : pas de repreneur du train de culture (Jean-Pierre Metzger), âge trop avancé (André Holtzritter, Nicolas Lenhard), maladie ou décès prématuré (Jean-Pierre Pefferkorn).
Certains hésitent aussi à se lancer dans la motoculture et attendent quelques années pour des raisons financières (manque de liquidités ou difficultés pour avoir un prêt) ou des raisons sentimentales (maintien de la traction animale).
Le premier tracteur 4 roues motrices du village est un Same Atlanta de 45 cv acheté en 1967 par Grégoire Muller, alors âgé à peine de 17 ans. Son père Auguste continue parallèlement encore pendant quelques années à utiliser ses chevaux et ne se convertira jamais à l’utilisation d’un tracteur.

Grégoire Muller (1950-)

(Photo landwirt.com)
Le Same Atlanta possède un moteur à 4 cylindres en V refroidi par air.

1979. Transbordement de bois au Grosswàld.
Deux Vendeuvre BM 57 de 28 cv côte à côte.
Celui de droite n’a pas de relevage hydraulique

1980. Grosswàld.
Un Fordson Power de 54 cv attelé d’une remorque
à bois faite "maison" d’une contenance de 6 stères.

Déjà 4 roues motrices en forêt !
L’arrivée d’un tracteur dans le village est très certainement un évènement de taille et fait, pendant un bon moment, la une de tous les potins du village. L’achat d’un tel équipement n’est alors pas à la portée de toutes les bourses et de nombreux paysans doivent encore attendre quelques années avant d’emboîter le pas au premier acquéreur d’un tracteur. On peut aisément imaginer la curiosité de la population, surtout masculine, devant un tel "joujou" et ses avantages vantés par l’heureux propriétaire et constatés de visu par l’ensemble de la population.
Les premiers essais dans les champs (au labour, au fauchage, à la traction), les passages dans les rues avec l’attelage d’une remorque ne manquent certainement pas de spectateurs intéressés et envieux.
Chaque fois que l’information de l’arrivée au village d’un nouveau tracteur circule, les enfants, surtout les garçons, n’oublient pas d’aller voir sur place et la marque et le modèle. Ils jaugent le nouvel engin, le comparent aux modèles déjà au village et n’hésitent pas à "mettre la main au tracteur", pour essayer de le soulever partiellement et ainsi mesurer leurs forces. Le petit Holder B10 de Florian Stéphanus, qui est stationné devant sa maison, sert ainsi, hors de la vue de son propriétaire, souvent "de souffre-douleur" à la bande composée de Joseph Rimlinger, Grégoire Muller, Lionnel Chardon et Yves Duché. (renseignement fourni par Joseph Rimlinger.)
L’achat d’un tracteur ne se fait pas à la légère, à cause de l’investissement à consentir. La publicité pour les tracteurs est encore rudimentaire autour des années 60 et apparaît timidement dans les almanachs agricoles. La meilleure publicité reste le bouche à oreille et le choix se porte tout simplement sur la même marque ou le même modèle que le voisin, ou sur la marque proposée par le forgeron-garagiste local.
Le matériel allemand a déjà la préférence des premiers motorisés, parce qu’il jouit d’une bonne réputation et que les prix sont plus compétitifs que ceux des autres matériels. (28)
 |
 |
__________________
(28). Le plan Marshall a livré en France des tracteurs avec une motorisation essence ou pétrole (en réalité du kérosène), ce qui posait un problème aux exploitants français, puisque l’essence était trop coûteuse et le pétrole ne permettait pas un démarrage à froid.
En Allemagne, la diésélisation avait été précoce et le matériel qui avait déjà fait ses preuves avant la guerre était meilleur marché. Dès 1947, le gouvernement avait décidé de ne plus fabriquer que des Diesel. Les principaux constructeurs sont Lanz, Fendt, Allgaier, Kramer, Güldner, Deutz, Fahr, Bautz, Eicher...
En France, les principaux constructeurs sont en 1950 Renault, Société Française, Latil, Map, Lalo-Mignonnac, et plus tard aussi Labourier, Sift, Reymond, Gardette, Babiole, Cima International, Sabatier, Arnoux, Bison, Arnoux, Mecavia, Bugaud, Le Percheron…
Avec l’apparition des premiers véhicules automobiles, voitures et tracteurs, un nouveau métier apparaît au village, celui de mécanicien, auquel le forgeron-maréchal-ferrant cède sa clientèle. Dans la rue de la libération, Camille Schaeffer ouvre un petit atelier de réparations et Camille Behr, le
gendre du forgeron Léon Lett, ouvre un garage dans les anciens locaux agricoles de la rue de la gare appartenant à son beau-père.
Camille Behr devient agent local de la marque allemande Fendt, dont le concessionnaire est le garage Wagner de Metz Borny. Ceci explique la prédominance de cette marque dans le village.
L’autre marque prédominante est la marque américaine Mac Cormick représentée dans la proche région par les Etablissements Wollf frères de Sarre-Union.
 |
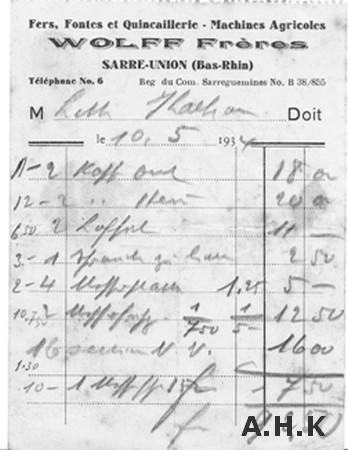 |
Une multitude d’autres marques, parmi lesquelles des marques peu connues et éphémères, sont aussi présentes : Motostandart, Renault, Staub, Holder, Champion, Ferguson, Same, Patissier (Energic), Vendeuvre, Someca, Heywang.
Les achats de tracteurs se font aussi auprès des forgerons recyclés en garagistes des villages voisins : Schemel Léon de Herbitzheim (tracteurs Hanomag et Energic), Rohr de Rahling (Ford), Siebert de Hundling, Wehrung de Durstel (Holder), Bundus de Neunkirch (Kramer), Pétri d’Achen (Same, Renault). Le dépôt de Sarreguemines de l’Union Agricole de l’Est commercialise aussi les tracteurs Renault dans la région.

Les tracteurs Heywang sont fabriqués en Alsace, à Bourgheim,
de 1956 à 1963. Le modèle HD25 a une motorisation Deutz
(bicylindre diesel 4 temps refroidi par air). Il compte 5 vitesses AV et 1 AR.

Le Kramer KL 22 et sa cabine Fritzmeier, appartenant à Joseph Stéphanus

Le tracteur Holder B10 D est construit de 1951 à 1959.
Il a un moteur diesel 2 temps refroidi par eau.
Son poids est de 700 kg. Il a 4 vitesses AV et 1 AR.

Le Holder de Pierre Freyermuth.
Remarquez le siège passager généralisé à l’époque
sur le garde-boue gauche et le panneau D (Danger) replié

Le tracteur Staub AMD 10 a un moteur à essence monocylindre 4 temps.
Il a 5 vitesses AV et 2 AR. Son poids est de 670 kg.
Il fait partie des tracteurs vignerons à voie étroite.

Le tracteur Motostandart Farmax 15D est fabriqué par
la firme allemande Gutbrod basée à Bübingen, en Sarre.
Il a le même moteur MWM que le Fendt F15 (monocylindre vertical diesel 4 temps).
Il a 4 vitesses AV et 1 AR. Sa barre de coupe Rasspe équipe aussi l’ Allgaier R22.
la firme allemande Gutbrod basée à Bübingen, en Sarre.
Il a le même moteur MWM que le Fendt F15 (monocylindre vertical diesel 4 temps).
Il a 4 vitesses AV et 1 AR. Sa barre de coupe Rasspe équipe aussi l’ Allgaier R22.

Les tracteurs Energic sont construits par les établissements
Patissier de Villefranche-sur-Saône. Le modèle 525 affiche 27 Cv.
Il a un moteur diesel Cérès bicylindre refroidi par eau et compte 5 vitesses AV et 1 AR.
(Photos mototracteurs.forumactif.com
vieilles.soupapes.free.fr)
vieilles.soupapes.free.fr)

Le Vendeuvre AS 500 de 1959 acquis par Charles Demmerlé
est un monocylindre refroidi par air affichant une puissance de 18 CV.
(sfv202.pages.perso-orange.fr)

Le Hanomag R19 de 1956 acquis d’occasion par Pierre Lang.
C’est un bicylindre diesel refroidi par eau. Il a 5 vitesses AV et 1 AR.
Remarquez la poulie de battage.

Jacques Stephanus sur son Vendeuvre BL 30.
C’est un bicylindre diesel refroidi par air. Il a 8 vitesses AV et 4 AR.

Le Champion Junior acquis par Florian Freyermuth (Ängels Bojo)
est le petit frère du Champion Comet. (Photo passion-usinages.forumgratuit.org)
Le Cormick D 439 de 1965 acquis en 1990 par Edouard Klein.
Il a un moteur diesel à 4 cylindres d’une puissance de 39 CV.
Il a un moteur diesel à 4 cylindres d’une puissance de 39 CV.
Lien vers la liste des tracteurs du village
4.4. Le tracteur au village-anecdotes
La conduite d’un tracteur exige un apprentissage sérieux et ne peut plus se comparer au maniement d’un attelage. Les chevaux ou encore les vaches de trait sont des animaux paisibles et attachants et un lien affectif fort, fait de complicité, de dialogue et de respect s’instaure souvent entre le paysan et ses bêtes.
Les bêtes ont chacune leur nom propre et leur caractère bien marqué et chacune réagit à sa manière à l’appel de son nom. De plus, un attelage est intelligent, adroit, sait éviter les obstacles ou s’arrêter devant eux, et trouver tout seul le chemin des champs ou de la maison.
Désormais l’attelage est remplacé par une machine impersonnelle, bruyante, rapide et déjà génératrice de stress, une machine qu’il faut dompter, qui n’obéit plus à la voix, qui n’a pas d’âme, qui n’est intelligente et adroite qu’en fonction de son chauffeur. Il n’y a plus de lien affectif. Le tracteur est remisé le soir dans la grange ou le hangar et on ne s’en occupe plus jusqu’au lendemain. Parfois le recyclage de charretier en tractoriste est difficile, surtout pour la vieille génération qui a du mal à tout assimiler rapidement et les nouvelles habitudes ne se mettent pas facilement en place.
Lorsque Charles Demmerlé achète son premier tracteur, un Vendeuvre AS 500, il a dépassé la soixantaine et ne se risque plus à la conduite mécanique. Toute sa vie, il a mené des attelages de chevaux, même pendant la première guerre mondiale qu’il a vécue comme conducteur dans un régiment d’artillerie. La conduite du tracteur est laissée à son gendre Alphonse Schreiner.

Charles Demmerlé (1897-1985)
De même, le Renault Super 3 D acquis en 1967 par Jacques Klein sera conduit, après son décès prématuré, par son fils Gaston, mais aussi par son beau-frère Pierre List, (Muurhònse Pééder), qui malgré sa difficulté à se déplacer (il s’aidait d’une canne) et son âge (il était né en 1899) se débrouillera fort bien. Il faut aussi dire que le Renault disposait d’une grille placée à la base du levier de vitesses et qui facilitait certainement le choix et le passage des vitesses.
 |
 |
Jacques Klein (1914-1969)
Pierre List (1899-1985)

Le levier de vitesses du Renault et sa grille.
Au second plan se trouve la manette du relevage hydraulique.
Quelques incidents ou accidents, la plupart heureusement sans conséquences graves, surviennent pendant la conduite des tracteurs. Les rues du village sont pratiquement toutes en pente et les conducteurs des petits tracteurs des années 60 ne peuvent les emprunter sans devoir rétrograder, surtout s’ils tractent une remorque chargée. Les vitesses à l’époque ne sont pas synchronisées et leur changement est souvent une opération risquée pour les conducteurs novices.
Le jeune Roger Lauer monte un jour la rue de la montagne avec le Fendt F24 paternel et se voit obligé de rétrograder au niveau de la maison André Borner. Il ne peut malheureusement enclencher la vitesse désirée ni tirer le frein et le tracteur s’arrête sans dommage contre le pignon de Jean Pierre Pefferkorn (Fawriggersch). Renseignement fourni par André Neu.

Roger Lauer (1948-2016)
Dans un autre registre, un soir, Florian Gross (Krìschängels) rentre son Fendt Farmer dans la grange et se met à crier "Ooha", pour arrêter son engin, comme il avait l’habitude de le faire avec l’attelage de chevaux. La machine s’arrête heureusement contre le mur du fond de la grange.

Florian Gross (1901-1983)
Des versements de tracteur se produisent aussi parfois, dus à la déclivité du terrain ou à l’inexpérience du conducteur.
En 1978, Pierre Stephanus, alors âgé de près de 80 ans, remonte la rue de la Libération et rate lui aussi son changement de vitesse. Le tracteur
recule contre la bordure du trottoir et se couche sur le côté . Personne n’est blessé et les dégâts sont insignifiants.

Pierre Stephanus (1900-1982)
Bruno Spielewoy, secrétaire de mairie à Kalhausen, prête parfois à la commune le tracteur Champion ayant appartenu à son frère Edgard et dont il se sert couramment depuis le décès de ce dernier, ainsi que la remorque. Un jour, l’ouvrier communal, Camille Klein, pilote l’engin et se déplace à Hutting pour y effectuer un transport de matériaux. Camille n’a pas l’expérience de la conduite d’un tracteur et le renverse. Il est coincé sous l’engin. Un conducteur de train signale l’accident à son arrivée en gare de Kalhausen. Les pompiers dégagent l’infortuné conducteur qui n’est heureusement pas blessé. La commune indemnisera le propriétaire du tracteur pour les dégâts occasionnés.

Camille Klein (1927-2007)
André List circule un jour à tracteur dans un champ en pente au lieu-dit "Hàbrètt" et renverse la remorque portant la tonne à purin à l’issue d’un virage trop serré, pris probablement à trop grande vitesse. (renseignement André Neu)

André List (1908-1986)
Dans les années 80, Adolphe Lenhard arrête le Vendeuvre BM 57 au lieu-dit "Chaussée" et descend du tracteur sans serrer le frein à main. L’engin dévale la pente en direction du "Klàrer Brùnne", vers Etting et fait un tonneau. Les dégâts sont heureusement minimes et se résument à quelques bosses sur le capot.

Adolphe Lenhard (1927-2012)
Les tracteurs tricycles ont un rayon de braquage très court et André Freyermuth en fait un jour l’expérience. Au volant de l’Allis Chalmers paternel, il remonte la rue de la Libération à assez grande vitesse et fait demi-tour sur la route au risque de renverser l’engin. Son père Jean Pierre, témoin de la scène, s’énerve et lui lance : "Du kùmmsch mìr nimméh drùff !" (Tu ne monteras plus sur le tracteur !)

André Freyermuth (1933-2000)
Les caractéristiques techniques du moteur sont souvent de grandes inconnues pour les nouveaux motorisés, les voyants lumineux sont ignorés et les rapports mal utilisés.
Jacques Zins, qui travaillait à la SNCF et avait l’expérience de la vapeur, utilise un jour des propos imagés pour raconter sa conduite du Fendt F12.
"Gìschert bìnn isch ìn de Rohrbrùch gewènn, hònn bìssel Dòmp gìnn ùnn der ìsch àb wie nìx. Héit hònn ìsch voller Dòmp gìnn ùnn der ìsch nìtt gelààft. Isch verschdéh nìx méh. »
(Hier j’étais au lieu-dit Rohrbrùch, j’ai donné un peu de vapeur et le tracteur est parti comme un rien. Aujourd’hui j’ai mis pleine vapeur et le tracteur n’avançait pas. Je n’y comprends plus rien.)
L’explication est toute simple : un jour, Jacques avait enclenché une petite vitesse et la fois suivante une grande. (anecdote rapportée par André Neu)
Le même ignore un jour l’allumage d’un voyant rouge au tableau de bord et continue de rouler jusqu’à couler une bielle.

Jacques Zins (1899-1965)
Il arrive aussi que l’on oublie de vidanger le circuit de refroidissement du moteur en hiver ou d’y ajouter de l’antigel : c’est ce qui arrive à André List avec son Fendt F12 qui a remplacé le Staub. André List n’achètera désormais plus de tracteur.
Le gonflage des pneus arrière pose aussi parfois problème : un pneu surgonflé ne s’adapte pas au terrain et l’adhérence est alors nulle surtout dans les terres détrempées ou en forêt. C’est la mésaventure arrivée à un agriculteur de Zetting. Lors de son premier débardage de bois en forêt, les roues de son nouveau tracteur manquent d’adhérence et par dépit, il rentre à la maison et attelle ses bons vieux chevaux qu’il avait eu la sage précaution de garder.
L’attelage expérimenté lui donne entière satisfaction, contrairement au tracteur. Quand il raconte sa mésaventure à un voisin également nouveau motorisé, ce dernier lui conseille de dégonfler un peu ses pneus pour résoudre le problème. Ce qui est fait à sa plus grande satisfaction.
(communication d’André Meyer)
Une petite mésaventure est aussi arrivée un jour à Joseph Pefferkorn de la "Schùùlgàss". Ce dernier acquiert, auprès d’un revendeur de matériel agricole, un scarificateur porté. L’outil lui est livré par camion, devant son domicile de la rue des lilas. Quand Joseph décide de l’utiliser, il l’attelle à son second tracteur, un Deutz D 5506 et s’apprête à quitter la rue des lilas pour le centre-village. Malheureusement la largeur du scarificateur l’empêche de passer entre la maison Lucie Freyermuth et le pignon de la grange Florian Gross. L’histoire ne dit pas comment Joseph s’est débrouillé pour aller aux champs, en dételant l’outil et en le ripant ou en passant par le "Rèbbèèrsch".

Joseph Pefferkorn (1931-2012)
Les accidents avec blessés sont heureusement rarissimes : un seul survient en 1979 avec des conséquences assez graves. Un jour de printemps, Jean Pierre Freyermuth, âgé de 72 ans, se tient debout -ce qui est une pratique courante pour bon nombre de personnes- sur la barre d’attelage du tracteur conduit par son petit-fils. Une remorque à quatre roues chargée de terre est attelée au tracteur. Dans un pré en pente, les roues arrière du tracteur perdent de leur adhérence à cause de la poussée de la remorque qui n’est pas freinée. Il aurait fallu arrêter le tracteur au début de la pente, descendre et tourner la manivelle pour serrer les freins de l’essieu arrière (de Mékanick).
L’ensemble se met alors en porte-feuilles et le malheureux Jean Pierre a la jambe droite coincée entre le tracteur et le timon de la charrette. La fracture ouverte est soignée à l’hôpital, mais la gangrène s’installe et la jambe doit être amputée au bout de 14 mois d’hospitalisation. Jean Pierre ne remontera plus jamais sur un tracteur.

Pierre Freyermuth (1907-1989)
Une autre mésaventure est aussi arrivée un jour à Jean Pierre, alors qu’il avait son Allis-Chalmers, et elle aurait pu avoir des conséquences graves. Cet engin avait une barre de coupe fixée à l’arrière et entraînée par la prise de force. A l’époque, la prise de force n’était pas protégée par un carter et Jean Pierre eut la jambe du pantalon happée par la prise de force en mouvement. Heureusement que le tissu céda et seul le pantalon fit les frais de cet accident vestimentaire et non corporel. Jean Pierre en fut quitte pour une grosse frayeur et un retour au village…en caleçon, au détriment de sa pudeur.
L’avenir des machines anciennes
Le manque de place dans les hangars et garages n’a souvent pas permis de conserver les machines agricoles mises au rebut par l’apparition de nouveaux engins. La plupart du temps, le ferrailleur a récupéré les machines trop encombrantes qui gênaient. Ainsi on ne trouve presque plus dans le village de faucheuse mécanique, de moissonneuse-lieuse, de batteuse… Tout au plus reste-t-il parfois, dans un coin de hangar, quelques petites machines comme une charrue, un coupe-racines, une charrette à bras.
 |
 |
 |
 |
Bric-à-brac dans un vieux hangar Remorque à plateau et charrue dans le même hangar
D’autres machines sont encore abandonnées tristement à leur sort dans un parc et rouillent en attendant le passage du ferrailleur ou bien pourrissent. Pourtant elles mériteraient un meilleur sort, conservées, exposées et mises en valeur dans un musée. Voici quelques instantanés pris sur le ban de la commune.

Triste vue d’un MF 165 abandonné…
 |
 Coupe-racines à gauche et …charrue Hamant à droite. |
 |
 |
Remorque et arracheuse de pommes de terre.
 |
 |
Distributeur d’engrais Vicon et moissonneuse-batteuse Claas.
 |
 |
Moissonneuse-batteuse Fahr et semoir mécanique.
 |
 |
Scie à ruban et remorque.
Quelques machines sont heureusement restaurées et servent de décoration devant une maison.
 |
 |
A gauche, houe à cheval devant la maison Thaller de Kalhausen et à droite hache-paille devant une maison de Philipsbourg.

Petite meule à main joliment fleurie.
Maison Prando, rue des roses.
Quant aux tracteurs anciens, ceux de la période glorieuse de la motorisation, la plupart ont été repris par le revendeur de machines agricoles lors de l’achat d’un tracteur plus moderne ou plus puissant. Certains pourtant sont conservés jalousement dans la famille par un fils ou un petit-fils, en souvenir du temps passé et une très rare minorité est encore occasionnellement en service aujourd’hui. J’ai ainsi dénombré 13 tracteurs anciens au village, dont
6 sont encore plus ou moins utilisés pour de menus travaux.

Ferguson "Petit gris" de 1959, appartenant à
Jean Claude Bach, et pris en photo en août 2014.
 Ci-dessus , Mac Cormick FD 137 de 1961 toujours au nom de Nicolas Assant et utilisé épisodiquement par son gendre Gilbert Schmitt. A droite, Ferguson MF 35 racheté par Jean Paul Hiegel pour planter les pommes de terre. |
 |

Le Kramer KB 22 de 1958 ayant appartenu à
Jean Pierre Lenhard et conservé par son fils Ewald.

Encore vaillant, le Mac Cormick FD 135 de 1961
acquis par Rodolphe Wendel et conservé par sa fille
acquis par Rodolphe Wendel et conservé par sa fille

Le Renault D 22 ayant appartenu à
Henri Hoffmann et entreposé dans une grange.

Le Cormick FD 135 de 1961 ayant appartenu à
Claude Kirch et récemment vendu après son décès.

Le Fordson Dexta de Jean Demmerlé, datant de 1963,
est tous les ans en service pendant la fenaison.

Le Renault Super 3 D acheté en 1967 par
Jacques Klein est toujours en service.
Son fils Gaston l’utilise presque journellement
pour de menus travaux. La couleur des jantes n’est pas d’origine.

Le Renault Super 2 D acquis également en 1967 par
Charles Demmerlé n’est pas encore trop fatigué.
Les différences qui existent entre le Super 2 D et le 3 D sont minimes : le premier possède un moteur 4 cylindres Indénor refroidi par eau et affiche 25 CV, alors que le second a un moteur MWM bicylindre refroidi par air et a une puissance de 30 CV.

Le Massey Ferguson MF 35 de
Lucien Bour utilisé par son fils Daniel.
Le tracteur le plus ancien présent au village est bien l’Allgaier A 22 de Marcel Thinnes. Cet engin, mis en circulation en 1951 (immatriculation 823 AB 67) a été acquis d’occasion en 1961 (immatriculation 59 JN 57) et affiche un âge respectable de 66 ans. Il ne circule plus qu’occasionnellement et démarre toujours au quart de tour…de manivelle.
 |
 Eté 2015. Roland Thinnes au volant du vaillant Allgaier. |

Balade nostalgique…
Certaines personnes passionnées, issues du milieu agricole et férues de mécanique, entreprennent de restaurer du matériel agricole ancien et plus particulièrement des tracteurs. C’est le cas d’André Neu, originaire de Kalhausen et habitant Siltzheim ou des frères Zins de Kalhausen.
 1972. Camille Zins et son Soméca 400 de 1969. |
 Le même Soméca restauré par les frères Zins. |
 |
 |
Deux belles vues d’un Allgaier A 22 de 1951 restauré par André Neu.

Deutz F1M414 de 1940 appartenant aussi à André Neu.
Ce tracteur, produit de 1936 à 1951 est un monocylindre refroidi par eau.
Il affiche une puissance de 11 CV et dispose de 3 vitesses Av et d’1 vitesse AR.
C’est le premier tracteur allemand produit en série et le plus vendu avant 1939.
Il est livré monté sur pneus, avec une poulie de battage, une prise de force et une barre de coupe.
D’un prix abordable, il est le tracteur préféré des agriculteurs et donne un élan
décisif à la mécanisation des petites et moyennes exploitations. Il est appelé "Bauernschlepper", le tracteur des paysans.
Ce tracteur, produit de 1936 à 1951 est un monocylindre refroidi par eau.
Il affiche une puissance de 11 CV et dispose de 3 vitesses Av et d’1 vitesse AR.
C’est le premier tracteur allemand produit en série et le plus vendu avant 1939.
Il est livré monté sur pneus, avec une poulie de battage, une prise de force et une barre de coupe.
D’un prix abordable, il est le tracteur préféré des agriculteurs et donne un élan
décisif à la mécanisation des petites et moyennes exploitations. Il est appelé "Bauernschlepper", le tracteur des paysans.

Le tracteur Kramer K 18 a été produit de 1936 à 1941.
Il est doté, comme le modèle K 12, d’un moteur diesel,
refroidi par eau, selon le principe de la bouillotte.
C’est un monocylindre horizontal Güldner d’une puissance de 18 à 20 CV.
Il a 4 vitesses AV et 1 vitesse AR.
Il est doté, comme le modèle K 12, d’un moteur diesel,
refroidi par eau, selon le principe de la bouillotte.
C’est un monocylindre horizontal Güldner d’une puissance de 18 à 20 CV.
Il a 4 vitesses AV et 1 vitesse AR.
 |
 |
Deux vues d’un petit Energic 518, à moteur Peugeot,
en train d’être restauré par un particulier.
André Neu possède aussi de nombreux moteurs thermiques anciens dont certains sont magnifiquement restaurés

Moteur à essence Cérès type M 1Q de 1910.
Il a une puissance de 3 CV et ne tourne qu’à 400 tours/minute.
Il a une puissance de 3 CV et ne tourne qu’à 400 tours/minute.
 Moteur CLM |
 Moteur Cérès |
 Moteur Bernard |
 Moteur Millet |
 Moteur Japy |
des Arts et traditions de Rouhling en ce qui concerne le petit matériel.
Des musées de matériel agricole et de tracteurs existent aussi, mais pas dans la région.
De nombreuses manifestations se déroulent encore chaque année au cours de l’été : expositions de machines agricoles, défilés de tracteurs pour le plaisir des yeux, mais aussi pour rappeler de bons souvenirs aux plus anciens. Notons le défilé de tracteurs à Blies-Ebersing, la fête des saveurs et du battage à Eschviller Maxstadt, la fête de l’Agriculture à Lorentzen), la fête des tracteurs et véhicules anciens à Mittersheim, le concours de labour, l’exposition et le défilé de tracteurs anciens à Rimling et à Bliesbruck...

Des communes mettent encore en valeur le patrimoine agricole dans le but de décorer l’espace vital, mais aussi de transmettre "l’Histoire" aux jeunes générations et aux touristes de passage. C’est le cas de Volmunster qui évoque l’Evacuation de septembre 1939.

Et puis, il y a Internet où, pour peu que l’on sollicite un moteur de recherche, l’on peut trouver d’innombrables photos de machines agricoles anciennes et récentes ainsi que des vidéos d’époque ou de reconstitution de scènes issues de la vie agricole. Un vrai trésor !
Conclusion
Comme dans l’industrie, la mécanisation et la motorisation se sont imposées en agriculture, malgré des débuts difficiles et de nombreux tâtonnements.
En agriculture désormais, quelle que soit la machine utilisée, le moteur joue un rôle primordial, il est à la base de tout travail. Et le premier des moteurs sollicités est celui du tracteur ou, si on veut, le tracteur est pris comme moteur, comme source d’énergie. La mécanisation et la motorisation ont fait d’énormes progrès en un peu moins de 200 ans et ces progrès ont été plus nettement visibles pour notre génération qui a connu la fin de la traction animale et l’avènement du tracteur.
Malgré le coût souvent exorbitant des machines agricoles qui oblige l’exploitant à s’endetter et cultiver toujours plus pour essayer de rembourser ses emprunts, la motorisation est irréversible. L’évolution du machinisme n’est certainement pas terminée.
Devant la raréfaction de la main d’œuvre agricole, nous continuons actuellement à assister au développement continu de la mécanisation et de la motorisation agricoles. L’agriculteur d’aujourd’hui, semblable à celui de hier et à celui de demain, continue d’exiger plus de confort et plus de sécurité et bien sûr moins de fatigue et moins d’efforts physiques. Il cherchera toujours à pouvoir faire son travail sans devoir lui consacrer de longues heures monotones et d’interminables journées.
En réaction contre la motoculture à outrance, quelques paysans, par idéologie ou folklore, font partiellement marche arrière et se remettent au cheval pour des travaux bien particuliers en viticulture (binage), en horticulture ou en exploitation forestière (débardage). Le cheval, aussi utile et respectueux de la nature qu’il puisse être, ne peut plus remplacer entièrement la machine, il s’agit de l’utiliser en complémentarité avec la machine, pour le plus grand bien de la nature et de l’homme.
Si jadis la majorité des exploitations ne possédaient qu’un seul tracteur, voire 2 au grand maximum, actuellement la plupart des exploitations utilisent toute une gamme de tracteurs de puissances diverses et adaptés chacun à un travail bien spécifique, sans compter les machines automotrices.
La course à la puissance, qui semblait chez certains agriculteurs ne pas avoir de limites, est bien l’image de cette théorie platement humaine et appliquée dans bien des domaines : le maximum de travail avec le minimum de temps, le moins d’efforts et de risques de tous genres. Il faudrait
encore ajouter : au moindre coût pour un maximum de bénéfice.
Pour essayer d’atteindre ces buts, la motoculture a encore de beaux jours devant elle. Mais l’homme qui pilote ou programme la machine devrait se poser la question fondamentale du devenir de l’agriculture : peut-on continuer à aller de l’avant, dans cette course effrénée à la puissance et au gigantisme, en ne respectant pas la nature, en contaminant les sols et les nappes phréatiques, en détruisant les écosystèmes, bref en polluant à outrance ?
D’accord pour cultiver plus, plus vite, plus facilement, mais aussi mieux, pour le bien-être du producteur et du consommateur. L’agriculteur, tout comme l’industriel et le consommateur, tient l’avenir de la terre entre ses mains et malheureusement, il n’en a pas souvent conscience.
Dans l’agriculture comme dans l’industrie, se pose encore et toujours l’éternelle question philosophique de l’asservissement de l’homme à la machine : est-ce que la machine a libéré l’homme ou bien en a-t-elle fait son esclave ? Le cultivateur d’aujourd’hui, a-t-il plus de temps libre grâce à la machine ou bien doit-il toujours faire plus à cause de la machine ? Chacun est placé devant un choix de vie, de qualité de vie. Il faudrait que la raison l’emporte…
Depuis peu, la prise de conscience de l’impact négatif de l’agriculture chimique sur la nature a pour conséquence la naissance d'une tendance n’est plus forcément au gigantisme, mais plutôt à la précision : la délivrance du bon dosage d’engrais, de pesticides, de fongicides ou d’eau, directement sur la plante. Il s’agit en premier lieu de préserver la nature, qui est l’outil de travail premier des agriculteurs. Le 52° Salon International de l’Agriculture, qui s’est tenu à Paris du 21 février au 1er mars 2015, n’a-t-il pas judicieusement été placé pour cette raison, sous le signe de " l’innovation pour des pratiques écologiques responsables face au défi climatique" ?
La mécanisation et surtout la robotisation continuent de se développer et finalement l’exploitant agricole dirigera, dans un avenir proche, son entreprise depuis son bureau et son ordinateur et ne mettra pratiquement plus les pieds dans les champs. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? L’avenir nous le dira.
Gérard Kuffler
Avril 2017
Mes remerciements à André Neu pour son apport photographique ainsi que ses connaissances techniques et historiques.

Ouvrages consultés
Le machinisme Agricole. Tony Ballu. Presses Universitaires de France. 1951
La traction Mécanique en Agriculture. Tony Ballu. La Maison Rustique. 1943
Un Siècle de Tracteurs Agricoles. Jean Renaud. Editions France Agricole. 1998
Attelages et attelées : un siècle d’utilisation du cheval de trait. Marcel Mavré Editions France Agricole
Le progrès mécanique en Agriculture de 1938 à 1958. R. Carillon
La motorisation agricole. Jean Marc de Montis
Les conséquences de la motorisation. Bulletin de la Société Française d’Economie Rurale Volume 3 n°1 1951
L’industrie du tracteur agricole en France. Jean Bienfait. Revue de géographie de Lyon. 1959
Données historiques sur le développement du machinisme agricole en France. Pierre Dellenbach et Jean Paul Legros
Taux de conversion des francs en euros (www.lepratique.fr)
1951 : 0,02271, 1952 : 0,02029, 1955 : 0,02036, 1968 : 1.13

