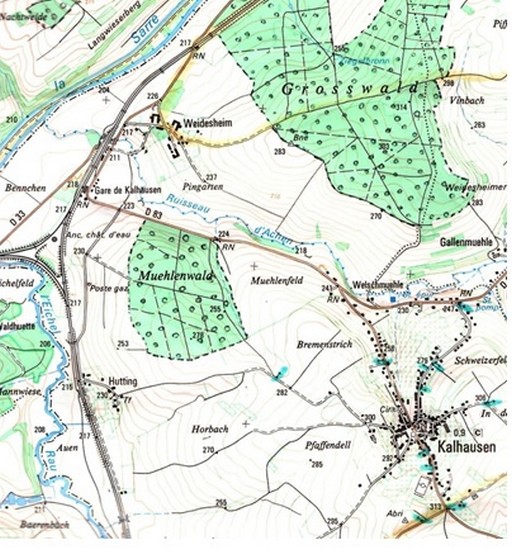René Geisler
(Biographie)

Il a signé une petite biographie digne d’intérêt, principalement à l’intention de ses petits-enfants. Ayant été en contact avec lui avant son décès, par l’intermédiaire de sa nièce par alliance, Nathalie Bellott, j’ai voulu ici retranscrire ce texte, en le laissant le plus possible dans sa version originelle. Si la forme a parfois été amendée pour une meilleure compréhension, le fonds n’a nullement été modifié et j’ai scrupuleusement respecté les idées de l’auteur.
J’ai voulu compléter le récit par des renvois en bas de page lorsque je le jugeais nécessaire, ainsi que par quelques photographies.
Cette biographie nous intéresse principalement car elle dépeint les joies et les peines d’un jeune garçon brusquement arraché à la vie citadine et qui découvre un petit village dialectophone. La guerre de 39-45 va le frapper de plein fouet et il sera blessé à la libération. Mais il se battra et entrera dans l’enseignement par la petite porte, en tant qu’instituteur remplaçant envoyé aux quatre coins de Moselle-est. Il finira sa carrière comme directeur d’école à Sarralbe.
Il nous donne ici une belle leçon de courage et d’optimisme, prouvant que malgré les difficultés de la vie, tout est possible à celui qui croit en l’avenir et ne baisse pas les bras.
Mes remerciements vont à Nathalie Bellott et Chantal Husslein, née Geisler, pour l’aide apportée et la mise à disposition du texte d’origine.
Gérard Kuffler
Notes biographiques
Charles Léon Geisler, né à Goetzenbruck en 1898, s’était installé dès 1922 à Bruxelles, comme représentant des verreries Walter, Berger et Cie qui fabriquaient essentiellement des verres d’optique.
Il avait pris pour épouse Anne Adèle Lucie Beck, née en 1903 à Siersthal et fille de l’instituteur Joseph Beck, alors en poste dans ce village. Le mariage fut célébré en 1927 à Kalhausen, pour la bonne raison que Joseph Beck y avait été muté entre temps.
Le jeune couple retourna en Belgique où il tint pendant plusieurs années un magasin d’optique, toujours pour le compte des verreries de Goetzenbruck, à Capellen, dans la banlieue d’Anvers, en collaboration avec Louis Geisler, frère de Charles.
Il ouvrit plus tard un autre magasin à Willebroeck, au sud d’Anvers.
Deux enfants virent le jour, alors que le couple résidait à Capellen, René Gilbert Charles, né le jeudi 6 décembre 1928 à Anvers et Armand, un an plus tard. Yvette naquit en 1934 à Willebroeck.

Photo prise en Belgique. Le couple avec ses deux premiers enfants.
Mais en 1934, un triste coup du sort, le décès prématuré du père, mit fin à la collaboration avec les verreries et obligea la jeune veuve à regagner la France avec ses enfants en bas âge.

Photo prise en Belgique. Lucie Beck
René fut recueilli dans un premier temps par sa tante Gabrielle qui résidait avec son mari Emile à Sarreguemines. Puis il rejoignit le foyer de ses grands-parents maternels à Kalhausen.
Donnons-lui maintenant la parole et laissons-le raconter ses souvenirs de jeunesse. René s’adresse à ses petits-enfants.
Heurs et malheurs de papy.
Pourquoi cette petite biographie ? A entendre souvent vos lamentations, je me disais : « Ils ne savent pas apprécier leur bonheur. Ils ont tellement de cadeaux, tellement de facilités pour leurs études, une vie sans soucis, peu de travail physique à fournir dans leur famille ! Ils se croient malheureux ! » Et pourtant, votre vie est facile ! Pourvu que cela dure !
Je ne suis pas jaloux de votre « dolce vita », mais je crains que vous ne soyiez pas prêts à affronter la vie à deux et à consentir des sacrifices pour que vos futurs enfants connaissent eux aussi une belle jeunesse.
Je reconnais que les temps actuels sont difficiles et vous ne voyez plus très bien le but de vos études et de vos efforts. En effet, les diplômes délivrés de nos jours n’ont plus la valeur de ceux du temps de ma jeunesse. Il faut aller loin dans les études pour espérer décrocher un emploi et surtout choisir la bonne orientation pour avoir un boulot…qui ne sera pas toujours payé selon vos espérances !
La vie sociale change tellement que beaucoup sont et seront éliminés. Mais un métier manuel n’est absolument pas déshonorant, loin de là. Les artisans ont souvent de l’or au bout des doigts.
Puissiez-vous méditer mon parcours de vie et comparer ma jeunesse à la vôtre ! Puissiez-vous avoir toujours le moral pour persévérer dans vos efforts, car « tout arbre produisant peu ou pas de fruits sera abattu ». A votre naissance, Dieu vous a donné des talents. A vous désormais de les faire fructifier, même si cela est parfois difficile et contraignant. Ces dons, mettez-les au service des autres et ne les gardez pas jalousement pour vous seuls, ce serait une grave faute d’égoïsme.
.../…
Kalhausen
Après le décès de mon père, j’atterris chez mes grands-parents maternels à Kalhausen, où mon grand-père avait en charge la classe des grands garçons. Moi, je fus affecté à l’école des petits où garçons et filles étaient ensemble.

Photo prise en 1921 dans la cour des garçons, côté rue de la gare,
avec l’instituteur Joseph Beck, né en 1872 à Voelfling-lès-Bouzonville.
Il était marié avec Lucie Jungbloudt née en 1879 à Bouzonville.

La grande école comprenait deux classes, celle des filles à l’avant et celle des garçons à l’arrière.
Le logement de l’instituteur se trouvait à gauche de l’école, ainsi que la mairie.

Vue arrière de l’école. La seconde porte est celle du logement scolaire.

La petite école comprenait une salle de classe et à gauche le logement de l’institutrice.
Après sa désaffection, elle servit de foyer des jeunes, puis le logement fut arraché.
C’est désormais le dépôt mortuaire de la commune.
Photo prise en 1970 (les fenêtres en façade sont déjà murées.)
Dans cette petite école, nouveau malheur ! On y apprenait l’allemand. Je me demandais si j’étais destiné à devenir cosmopolite. Là aussi, la punition ne tarda point. C’était la dernière heure de classe de la journée. Mes camarades devaient lire, à tour de rôle, une partie d’un conte allemand. Soudain je fus appelé par la maîtresse pour continuer. Mais diable, où en étions-nous? Surtout que je ne comprenais rien à cette langue !
«A genoux, avec le livre en mains !», s’écria-t-elle.
Et me voilà agenouillé sur le plancher qu’on avait enduit d’huile pour éviter la poussière. Combien de temps ? Je n’en sais rien. Mais quand seize heures sonnèrent au clocher de l’église, je fus libéré de cette situation peu honorable.
A mon entrée dans la cuisine, grand-père était en train de se raser.
- « Bizarre », me dis-je.
Il me demanda si tout s’était bien passé.
- « Oui » !
- « Tu en es sûr ? »
Je ne répondis rien, car j’avais l’impression qu’il devait déjà être au courant et que l’orage allait éclater. Il partit. Grand-mère, silencieuse, me prépara le goûter et, au retour de grand-père, je récoltai la punition : d’abord les devoirs sévèrement contrôlés et à refaire si le soin laissait à désirer, ensuite, au lit, sans souper, sans rien à lire ! J’étais ennuyé et je pensais que la vie était compliquée en France.
Au bout d’un certain temps, je m’endormis quand même.
Tous les matins, il fallait se lever tôt pour assister à la messe. Un jour, le sacristain vint vers moi en parlant en dialecte. Je ne comprenais rien à son baragouin, alors, de guerre lasse, il enleva d’office le béret de ma tête.
Et c’est un jour très ordinaire que je fis ma première communion, le matin, à une messe base, sans solennité, sans menu extraordinaire, ni participation d’un seul membre de ma famille.

L’église saint Florian construite en 1847.
Pendant les grandes vacances, j’eus la permission (exceptionnelle) d’accompagner le paysan d’en face dans les champs, pour lui donner un coup de main (1). Un jour, avec un autre garçon, je fus envoyé chercher de l’eau à une fontaine. Le garçon connaissait le chemin. En descendant la côte, je vis des ouvriers s’affairer sur la charpente d’une maison. Nous observâmes un moment ces travaux. J’étais loin de soupçonner, qu’un jour, suite au remariage de ma mère, je viendrai habiter cette maison.
_______________________
1). Il s’agit de la famille Jean Victor Pefferkorn - Marie Gross, qui habitait dans la rue des lilas, de Schùùlgàss, à côté de la petite école. On les appelait les "Blääse ". Ils avaient des enfants pratiquement de l’âge de René.

La famille Pefferkorn possédait des champs du côté de Hutting. Pendant les travaux de la fenaison ou de la moisson, on avait l’habitude d’emmener un bidon à lait rempli d’eau pour se désaltérer. C’était parfois du café ou de l’eau-de-vie dilués avec de l’eau (Kàfféwàsser, Schnàpswàsser). Lorsque le bidon était vide, on envoyait les enfants le remplir à une source de la forêt ou à une fontaine publique. Une telle fontaine existait à Hutting, dans la cour de la maison Juving et les paysans de Hutting l’utilisaient aussi pour abreuver leur bétail.

La fontaine de Hutting.
C’est ainsi, en fréquentant les habitants du village, que je commençais à apprendre le dialecte. Très souvent, le paysan d’en face me donnait une bonne part de "Flòmmkùùche". J’aimais bien cette tarte aux oignons, aux lardons et à la crème.
Cependant, la catastrophe arriva ! Un jour, grand-père me surprit à me délecter de cette délicieuse tarte flambée. Je fus vertement "engueulé" pour avoir enfreint le commandement de l’Eglise qui interdisait la consommation de viande le vendredi, jour d’abstinence ! Je ne savais pas que c’était un péché et je dus aller me confesser pour cette faute.
Que savais-je de la religion ? Très peu de choses, à part l’obligation d’assister à la messe tous les jours, aux vêpres le dimanche et les jours de fête religieuse, au chapelet pendant les mois de mai et d’octobre, ainsi qu’à d’autres occasions.
Mais le curé allait se charger de mon instruction religieuse. Lors de mon premier jour de classe chez mon grand-père, il vint à onze heures pour faire le catéchisme. Il me fit venir près du pupitre et me demanda en allemand »:
-« Bist-du ein Christ ?» (Es-tu chrétien ?)
Je comprenais vaguement et répondis :
-« Oui.»
Aussitôt fusa la question maîtresse :
-« Warum bist-du ein Christ ? » (Pourquoi es-tu chrétien ?)
Alors là, je ne sus pas trop quoi répondre. Il me traduisit alors le mot "Warum" (Pourquoi) et je lui répondis que c’était parce que j’étais baptisé, encore que je n’en étais pas tellement sûr, vu que je ne connaissais ni parrain, ni marraine et qu’on ne m’en avait jamais parlé.

Le curé Michel Albert.
Né à Vahl – Ebersing le 6 septembre 1862.
Ordonné à Metz le 17 juillet 1887.
Vicaire de Saint Vincent à Metz de 1887 à 1890.
Curé de Kalhausen de 1890 à 1945.
Expulsé à Nancy le 28 juillet 1941.
Revenu à Kalhausen le 25 mai 1945.
Décédé le 14 juin 1945
Il vint auprès de grand-père et tous deux discutèrent assez longtemps en allemand, devant moi, penaud, qui ne comprenait rien. Quel allait être, pour moi, le résultat de cette discussion ? Et bien, je ne fus ni grondé, ni puni.
Le lendemain, un jeudi, jour de congé pour l’époque, grand-père se rendit, comme souvent le jeudi, à la Sous-Préfecture de Sarreguemines, car il exerçait la fonction de secrétaire de mairie, comme presque tous les instituteurs de village.
Après son retour à pied de la gare de Kalhausen, il me remit un petit livre : c’était le catéchisme ! Avec questions et réponses ! Le tout, ô comble de malheur, en langue allemande ! Et il fallait apprendre tout cela par cœur ! Malheur aux récalcitrants, les coups pleuvaient drus de la part du curé ! Je n’avais pas encore fini de baver avec cette langue et grand-père veillait au grain, pire qu’un ange gardien, pour que je sache, sur le bout des doigts et
mot à mot, les réponses aux questions qu’il me posait. Mais comprenais-je au moins ce que je récitais ? J’en doute fort.
Un jour, à la récréation de 15 heures, comme j’allais chercher mon goûter chez grand-mère qui occupait le logement de fonction attenant à l’école, je retrouvai tante Gabrielle, que je n’avais plus revue depuis mon départ de Sarreguemines. Ces deux bonnes âmes, grand-mère et elle, me persuadèrent que je pouvais m’absenter la dernière heure de classe. Comme j’étais content ! Mais à seize heures, au retour de grand-père, nous encaissâmes de sa part, tous trois, un sermon effroyable sur les conséquences d’une absence injustifiée et non autorisée par lui, l’INSTITUTEUR. Il était très strict avec le règlement et peut-être avait-il inscrit mon absence dans le registre d’appel pour motif "non valable" ?
Grand-père savait jouer du violon et de l’orgue. Ses talents musicaux s’exerçaient par conséquent aussi à l’église, les dimanches et jours de fêtes religieuses sur l’harmonium. Il m’emmenait parfois à Sarreguemines et j’étais heureux de ces petits voyages en train. Il m’apprit à comprendre ces grandes affiches jaunes où figuraient les différents trajets ferroviaires de la région, avec les heures de départ et d’arrivée des trains, les gares desservies, les différentes sortes de trains, les express, les rapides, les omnibus, les jours de circulation, bref, tous les renseignements utiles aux voyageurs. Il me montra aussi comment acheter un billet ou un ticket, comment se comporter lors d’un contrôle et me fit découvrir le fourgon où l’on pouvait déposer une bicyclette, etc…etc…
Un jour, dans la salle d’attente de la gare, j’entendis une conversation entre voyageurs qui parlaient d’ "Àlwe" (Sarralbe). Comme nous avions eu en classe une leçon de géographie sur les Alpes, je pensais naïvement, en suivant le regard de ces voyageurs, apercevoir au loin ces montagnes aux cimes enneigées. Discrètement, je demandai à grand-père pourquoi je ne pouvais pas voir ces montagnes pourtant si élevées. Alors il se mit à rire et m’expliqua que "Àlwe" était une petite ville pas trop loin d’ici et que j’avais mal entendu. J’étais en colère contre moi-même et ma trop grande imagination.
Au sous-sol de l’école, il y avait une grande porte qui donnait sur la cour, du côté de la route. Derrière cette porte se trouvait une pièce mal entretenue, avec un lit, plutôt une paillasse qui ne sentait pas bon. Grand-père m’expliqua que c’était une cellule d’arrêt pour tous ceux qui s’étaient bagarrés, qui avaient volé, etc…en attendant que les gendarmes viennent les prendre en charge. Ces personnes ne recevaient que de l’eau et du pain.

La porte en question se trouve dans le prolongement de l’escalier d’entrée de la cour.
J’allais aussi parfois faire des commissions pour grand-mère, surtout pour la charcuterie. Or, un jour, je me permis d’acheter de la saucisse de viande en plus des autres produits. J’aimais cette saucisse, mais mal m’en prit. Là aussi, j’eus droit à une sévère admonestation de la part de grand-père. A l’épicerie, je recevais parfois deux, trois bonbons, ce que grand-père n’appréciait pas du tout.

L’épicerie Jean Pierre Pefferkorn, située rue de la montagne et appelée Maiébs.
Bouzonville
En 1937, grand-père prit sa retraite pour s’installer à Bouzonville. Bien sûr, j’étais du déplacement et me retrouvais dans une nouvelle école, au cours élémentaire 2, je suppose.
J’aimais bien mon nouveau maître, mais la discipline était stricte. Le fils du directeur de l’école était mon meilleur camarade. C’est lui qui m’apprit à rouler à bicyclette dans la cour de l’école, autour d’un gros arbre. Bien sûr, cela se faisait en dehors des heures de classe et avec la permission de grand-père. Il me fit asseoir sur la selle, vérifia la bonne position des pieds sur les pédales, et nous voilà partis pour des tours autour de l’arbre.
Il m’avait promis de bien tenir le vélo par la selle et j’étais confiant, je n’avais pas peur. Mais, étonné tout à coup du silence derrière moi, je constatai la disparition de mon camarade. Je freinai et le cherchai autour de moi. Où était-il ? Tout simplement caché derrière le gros tronc de l’arbre. Il riait à gorge déployée et avoua avoir lâché le vélo depuis deux à trois tours : il était allé se cacher derrière l’arbre pendant que je pédalais. Je savais donc rouler ! Mais ce n’est pas pour cette raison que l’on m’acheta un vélo.
La dictée, qui à cette époque était une matière très importante, fut à nouveau prétexte à une punition, pourtant imméritée. En classe, j’étais assis à gauche, contre le mur et mon voisin empiétait de toute la longueur de son bras sur ma partie de table. Or, il était strictement interdit de parler et de tourner la tête vers son voisin. Je protestai auprès de celui-ci, car il prenait trop ses aises à mes dépens. Bien sûr, l’œil vigilant du maître me repéra et malgré mes explications polies, je fus puni de retenue après la classe. Grand-père était toujours à l’affût sur le trottoir, aux heures de sortie des classes.
Monsieur Roland m’avait laissé seul en classe, avec un exercice à faire. Tout à coup, je le vis en pleine conversation avec grand-père dans la cour. Celui-ci partit et le maître revint dans la salle, vérifia mon exercice et me permit de rentrer à la maison. Je savais ce qui m’attendait : après les devoirs sévèrement contrôlés du point de vue présentation et exactitude, je fus envoyé au lit sans souper. J’étais écœuré par cette punition non méritée.
Une autre affaire m’arriva quelque temps après. C’était un jeudi après-midi. Le maître et une autre personne déambulaient en bavardant sur le trottoir, de l’autre côté de la rue. Vite, j’enlevai mon béret et je les saluai à voix forte. Mais pas de réponse ! Le lendemain, monsieur Roland me reprocha de ne pas l’avoir salué. Je n’en croyais pas mes oreilles et répondis vivement que si ! Mais il persista dans son affirmation et j’eus droit à une nouvelle retenue et à une punition écrite. Comme d’habitude, une seconde punition m’attendait chez grand-père, car il n’admettait pas que l’on puisse contester un instituteur !
A Bouzonville, j’appris aussi le "métier" d’enfant de chœur (servant de messe). A l’époque, tout se disait en latin. Je me rappelle encore aujourd’hui du début : "Introibo ad altare Dei " disait le curé et les servants de messe répondaient : "Ad Deum qui laetificat juventutem meam". (2)
Il fallait aussi mémoriser les "mouvements" à faire : génuflexions à certains moments, transfert du volumineux missel d’un côté de l’autel à l’autre, verser le vin et l’eau au moment voulu, actionner la clochette, etc… J’aimais bien faire tout cela, et comme tout nouveau servant de messe, je devais "exercer" ce métier le matin à six heures avec un autre déjà aguerri à tout cela. Servir la messe à une heure aussi matinale ne me gênait nullement, car je devais aller au lit à huit heures, été comme hiver.
Mais voilà qu’un matin mon acolyte était absent ! Je n’étais pas très rassuré. Tout se passa cependant bien jusqu’à la fin de la messe, quand il fallut porter le missel sur l’autre côté de l’autel. En descendant les marches de l’autel, je laissai tomber le saint livre à terre et mon regard craintif se porta vers l’abbé officiant qui ne me fit heureusement aucune remarque. Je ramassai avec mille précautions le livre et son support et portai le tout à sa place.
Aucun reproche ne me fut adressé, ni par le vicaire, ni par grand-père.
_____________
2) Traduction : Je m’approcherai de l’autel de Dieu, de Dieu qui est la joie de ma jeunesse.
Je fis aussi partie des "Cœurs Vaillants", un groupement catholique de garçons, du genre scouts. Les filles étaient des "Âmes Vaillantes". Nous pratiquions surtout des jeux collectifs. Un jour, notre chef ne parut point. Après un long moment d’attente, les plus âgés décidèrent d’aller faire un tour au cimetière israélite qui se trouvait sur la route d’Alzing-Brettnach et que je ne connaissais absolument pas. J’étais surpris par la simplicité des tombes sur lesquelles reposaient quelques cailloux. Chaque fois qu’un israélite se rendait sur une tombe, il y déposait un caillou. Aujourd’hui encore, je ne connais pas la signification de ce geste. (3)
______________
3) Le fait de déposer une pierre sur la tombe doit certainement remonter à l’antiquité, époque où les défunts juifs étaient enterrés à l’extérieur des villes, dans le désert. Pour protéger les tombes des charognards nocturnes, les familles posaient de grosses pierres sur la tombe. L’habitude de poser des pierres serait alors restée.
Après cela, on joua dans les prés des alentours avec une telle ardeur que l’heure de rentrer fut oubliée. Quand j’entendis les cloches sonner l’angélus de midi, je pris mes jambes à mon cou pour rentrer. Trop tard, grand-père m’attendait et je fus privé de sortie pour plusieurs jours. J’étais bon pour rester à la maison et m’ennuyer, car les distractions étaient rares. A l’époque, la télé n’existait pas et la radio servait seulement à écouter les informations.
Mais j’avais le droit de lire le journal auquel grand-père était abonné et quelques rares revues religieuses. J’avais aussi déniché dans un placard un dictionnaire et j’avais le droit de le feuilleter, mais uniquement en présence de grand-père. Je devais le remettre à sa place quand j’avais fini.
Pendant la belle saison, j’accompagnais souvent grand-mère au cimetière pour arroser les bégonias qu’elle soignait avec amour sur les tombes de son fils et de mon oncle René, et pour visiter les autres tombes de la famille.
La maison que mes grands-parents habitaient était une vieille bâtisse à la forme curieuse, ce qui m’intrigua fortement. Grand-mère m’expliqua que c’était un ancien relais de diligences. Mes arrière-grands-parents habitaient aussi Bouzonville. Mon arrière-grand-père avait été conducteur de diligence avant de se sédentariser comme responsable de relais de diligences. Ils avaient été très riches et leur fortune avait été placée à Sarrelouis, en Allemagne.
Malheureusement, quand Hitler prit le pouvoir, ils perdirent presque tout leur argent. L’arrière-grand-père était bien gentil avec moi, mais le pauvre homme était reclus dans un coin dont il n’avait guère le droit de bouger, car son épouse était une femme acariâtre et autoritaire. Moi aussi, j’étais intimidée par elle et je la craignais un peu. Sa fille, grand-mère Lucie, était tout le contraire, d’une extrême gentillesse. Elle me consolait toujours quand j’étais puni.
Pendant les grandes vacances, je retournais à Kalhausen où ma mère s’était installée avec Armand et Yvette. Elle y tenait une petite épicerie-mercerie et vendait aussi du vin en vrac et de la bière, ce qui lui permettait de survivre et d’élever mon frère et ma sœur (4).
Armand s’était cassé le bras lors d’une chute avec la trottinette ramenée de Belgique. A cette époque, la Sécurité Sociale n’existait pas encore et les villageois n’allaient guère consulter un médecin. Ils avaient recours à des naturopathes qui leur vendaient force tisanes et onguents dont ils étaient les seuls à connaître la composition. On avait aussi recours aux rebouteurs qui réduisaient les fractures simples et soignaient les luxations. En tout cas les deux trottinettes, la mienne et celle de mon frère, disparurent et il n’y eut plus d’accident.
_______________
4) Ce petit commerce se trouvait au numéro 14 de la rue des fleurs, "ùff em Wélschebèersch".
Lien vers le dossier de l'A.H.K "Rebouteurs et rebouteuses"
Les jeux n’étaient pas toujours sans danger, surtout la pratique de la luge en hiver. Nous nous couchions sur la luge, sur le ventre, et nous nous aidions des pieds, que nous laissions traîner par terre, pour la diriger : le pied gauche pour aller à gauche et le pied droit pour aller à droite. Nous étions tous équipés de sabots de bois ou de galoches, les souliers ne servant que pour aller à la messe, en ville ou encore au village.
Nous avions un parcours de luge éprouvé et combien exaltant, en raison des bosses du terrain qui le jalonnaient et qu’on passait en vol plané ! Ce parcours était dangereux, car après la dernière bosse, il fallait passer par une ouverture étroite dans une haie et éviter un arbre qui se trouvait juste en face. J’ai constaté à mes dépens la dangerosité du parcours, en heurtant violemment l’arbre. La luge me donna un tel coup dans le ventre que j’en eus le souffle coupé pendant plusieurs minutes.
Avec mes camarades, nous formions parfois un train de luges : le premier accrochait, avec ses pieds, la luge du second et ainsi de suite. Pour diriger le train, celui qui se trouvait en tête guidait avec ses pieds la partie avant de la seconde luge et les autres suivaient automatiquement. Le dernier devait se méfier de l’amplitude du mouvement s’il ne voulait pas finir dans le décor.
Pendant les vacances à Kalhausen, j’aimais donner un coup de main au magasin de ma mère. J’apprenais le dialecte (5), bien différent de celui de Bouzonville et j’allais souvent accompagner les copains, fils de paysans. Pendant les pauses, on se régalait de bons casse-croûte au jambon fumé
dont je raffolais.
J’étais heureux de retrouver ma famille. Avec Armand, je jouais à la guerre, mais de façon toute pacifique, avec des soldats de plomb étrennés pour Noël. Souventes fois, mon futur beau-père Eugène, qui fréquentait ma mère en vue de se marier avec elle, s’amusait avec nous le soir (6).
______________
5) En Moselle-est, c’est le francique rhénan qui est parlé, contrairement au francique mosellan de la région de Bouzonville.
 |
6) Il s’agit d’Eugène Dehlinger, appelé "Sébbels Uschénn", né en 1896. Il habite Hutting, il occupe un poste aux chemins de fer et a encore un petit train de culture. Le mariage est célébré en 1938. Eugène décède en 1971.

Phalsbourg
C’est alors que j’appris la décision de me faire inscrire à la rentrée au collège Saint Antoine de Phalsbourg, tenu par les pères Franciscains (7). Qui a pris cette décision ? Je l’ignore encore aujourd’hui. Peut-être grand-père, car ma mère n’aurait pas pu financer la scolarité et la pension dans une école privée.
Mais pour y être admis, il fallait subir un petit examen d’entrée en septième. Le père franciscain me fit faire, entre autres, une dictée. Lorsqu’il la lut, il fut très étonné et il dut la relire, il porta un doux regard sur moi, puis sur ma mère et avoua n’avoir jamais vu cela : 0 fautes ! Moi, je n’étais pas surpris, j’avais l’habitude. Mais à la dictée de Pivot, ce ne serait certainement pas pareil. Bref, je fus admis sans difficulté.

Photo des années 1960.
A l’arrière du collège se trouvent la chapelle, puis l’imprimerie.
L’aile gauche du bâtiment ne fut construite qu’en 1947-1948.
_____________
7) Le collège Saint Antoine est administré par les Franciscains. C’est un collège séraphique, car il accueille des jeunes qui "présentent les indices d’une vraie vocation sacerdotale et franciscaine".
La première rentrée scolaire a lieu le 3 octobre 1933. Les élèves vivent en internat. Le Collège est leur milieu de vie. Ils ne quittent le Collège que pour les vacances de Noël, de Pâques et d’été. Leur nombre varie peu : de 80 à 100.
Toute la vie d’internat, ainsi que la formation scolaire, culturelle, religieuse (messe quotidienne, retraite annuelle, scoutisme) sont assurées dans un cadre presque exclusivement franciscain. Cependant, dès 1934, on fait appel à quelques professeurs laïcs. Les élèves prennent contact avec la forêt par des promenades hebdomadaires. Ils sont initiés au chant choral, à la musique instrumentale, au théâtre, mais aussi à l’entretien de la maison, à l’épluchage des pommes de terre.
Après la déclaration de la guerre, le Collège devient un hôpital militaire français (1939-1940), puis une caserne de la Wehrmacht, un hôpital militaire allemand (juin 1940-novembre 1944), enfin un hôpital militaire américain (évacué le 13 mai 1945).
Il rouvre ses portes à de nouveaux élèves le 18 septembre 1945 et dès l’été suivant, les Frères franciscains reprennent leurs activités d’avant-guerre. Le Collège-Lycée Saint Antoine actuel est bien différent de celui des débuts : accroissement du nombre des élèves (705 en 2003), directeur et professeurs laïcs, mixité, externat, bâtiments rénovés et agrandis. Les résultats scolaires restent chaque année excellents et font toujours la renommée de l’établissement.
Sources : Brochure Antonianum 2006
A la fin du mois de septembre 1938, je partis seul pour Phalsbourg. Je connaissais le trajet pour l’avoir effectué avec ma mère pour l’admission : départ de la gare de Kalhausen en direction de Strasbourg, descente à Diemeringen et changement de train pour Drulingen, puis de nouveau changement pour un tortillard qui flânait dans la campagne. Quand il montait une pente, il s’essoufflait pour tirer ses deux ou trois wagons. On aurait pu le suivre à pied ! A Phalsbourg, il me restait un bout de chemin à faire à pied pour rejoindre le collège situé à la sortie de la bourgade, sur la route de Strasbourg (8).
8) La voie ferrée où circulait le tortillard fut mise en service le 1er septembre 1883 et reliait Drulingen à Lutzelbourg, en passant par Phalsbourg. C’était une voie métrique (les rails ont un écartement de 1 m), comme c’était le cas de toutes les voies secondaires. Elle a été installée principalement pour acheminer les blocs de grès des carrières de Vilsberg, Berling et Hangwiller jusqu’au Canal de la Marne au Rhin où ils embarquaient sur des péniches. Un service voyageurs existait également. Au départ, le train ne reliait que Lutzelbourg à Vilsberg, en passant pas Phalsbourg. En 1903, la ligne fut prolongée vers Berling, Graufthal, Bust, Siewiller et Drulingen.
De nombreuses marchandises vont transiter par ce train : pierres de construction, bois, ferraille, machines agricoles, combustibles. Les fermières vont aussi l’utiliser pour aller vendre les produits de la ferme au marché de Phalsbourg et les écoliers pour se rendre dans les établissements secondaires du chef-lieu de canton (collège et lycée).
Le service voyageurs fut arrêté en 1948 et la ligne totalement fermée le 1er septembre 1953. Les derniers rails furent démontés en 1964, entre Phalsbourg et Lutzelbourg, pour l’élargissement de la route. La voie ferrée a bien mérité son surnom de "Eselbahn", la voie de l’âne, car le train ne roulait pas plus vite qu’un âne chargé et mettait par exemple 22 minutes pour le trajet Lutzelbourg-Phalsbourg, il est vrai en pente.
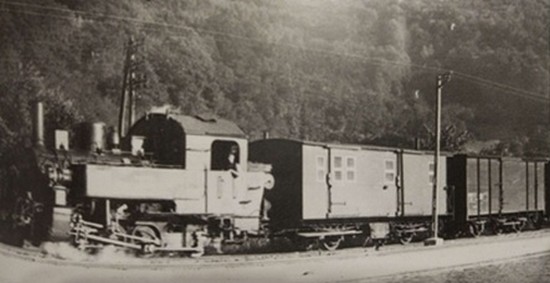
Sources : www.lutzelbourg.fr
Un père s’occupait de l’installation des nouveaux élèves et avec lui, je découvris l’immense dortoir avec ses nombreuses rangées de lits métalliques, la grande salle d’eau et ses lavabos individuels qui se faisaient face sur trois rangées, les placards pour les habits et le linge, les salles de classe, le réfectoire…et la chapelle.
J’étais le plus jeune élève de l’établissement. Les Franciscains portaient tous une robe de bure brune serrée à la ceinture par un cordon blanc. Au sommet du crâne, la tonsure (petit cercle rasé) indiquait leur appartenance à la cléricature. Ceux qui ne la portaient pas n’étaient pas prêtres, mais frères et s’occupaient de tâches matérielles, comme le jardinage, la cuisine, l’imprimerie ou encore l’infirmerie.
Tous portaient des sandales et marchaient pieds nus, sauf en hiver. Un grand chapelet pendait sur un côté, à partir de la taille. Les plus grands élèves préparaient les deux baccalauréats, le premier après la classe de première et le second, après la classe de philosophie (9).

La communauté franciscaine devant l’entrée du collège. 1947-1948
________________
9) Les Franciscains font partie de l’ordre des frères mineurs fondé en 1210 par saint François d’Assise. A l’image du Christ, ils tentent de vivre une vie de grande pauvreté et de simplicité évangélique. Ils ont choisi de s’appeler " frères ". Dans les faits, ceux qui sont ordonnés prêtres se font appeler "pères". Ceux qui ne sont pas ordonnés sont alors des "frères".mais tous ont professé des vœux. René fait une erreur : aucun signe extérieur, et encore moins la tonsure, ne les différencie. Ils ne portent pas tous la tonsure et ne marchent pas non plus tous, pieds nus dans des sandales. Le cordon blanc porté à la ceinture porte trois nœuds symbolisant les vœux professés : obéissance, pauvreté et chasteté.
Je faisais très bonne impression sur mes professeurs et fus souvent cité comme modèle pour les autres. J’y appris une forme d’écriture spéciale, le gothique, tracée avec une plume spéciale. Mais, j’ai tout oublié !
Après les cours, les élèves, qui étaient tous des internes, se retrouvaient dans la salle d’études pour faire leurs devoirs et apprendre les leçons pour le lendemain. Un père surveillait tout ce monde studieux auquel le bavardage était strictement interdit. Chacun disposait d’un pupitre dont le couvercle pouvait se soulever. A l’intérieur, on rangeait les affaires scolaires, mais certains élèves y rangeaient aussi des choses peu règlementaires, comme des bandes dessinées (Bibi Fricotin, Les Pieds Nickelés). Mais gare aux punitions, car " l’importation " de livres était absolument interdite et les livres découverts étaient purement et simplement confisqués.

Salle d’études des petits (7°, 6° et 5°).
Avant et après l’étude du matin et celle du soir, on priait en latin le Notre Père (Pater Noster) et le Je vous salue Marie (Ave Maria). Au début, c’était difficile pour moi, je ne possédais pas le texte écrit, mais j’appris vite.
Les repas étaient pris au réfectoire et surveillés par un père installé sur une estrade et qui mangeait en même temps que les élèves. Le silence était de rigueur au début du repas, pendant ce temps il fallait écouter une lecture religieuse qui devait nous inciter à méditer sur le sens religieux du message.
Puis nous avions le droit de parler, mais avec modération dans le ton. Le repas se terminait également dans le silence.
Nous regagnions ensuite la cour où les plus jeunes s’adonnaient aux jeux, alors que les grands se contentaient de déambuler en discutant. Pendant le Carême, les jeux étaient interdits et nous devions méditer le sens religieux de textes extraits d’un petit livre prêté pour l’occasion. Pas de bavardage
non plus dans la cour !

La toilette du matin se faisait torse nu dans la grande salle d’eau. Un père surveillait l’opération et contrôlait parfois la propreté des oreilles, des mains et des ongles. C’est ce même père, le responsable de la section des petits, des moyens ou des grands, qui accompagnait la vie des internes, depuis le lever jusqu’au coucher et les surveillait en dehors des heures de classe. Il dormait avec eux, dans un petit réduit placé dans un coin du dortoir, ce qui empêchait les chahuts.
Le samedi après-midi, vers 5 heures, c’était la douche individuelle dans de petites cabines installées au sous-sol. C’était la première fois de ma vie que j’eus accès à une chose moderne. Mais auparavant, les plus grands, c’est-à-dire les élèves à partir de la sixième, devaient faire le ménage dans le collège : ils étaient répartis par équipes qui avaient chacune un domaine particulier à nettoyer : le dortoir, les salles de classe, le réfectoire, la salle d’eau, le sous-sol. Il s’agissait surtout de balayer, de prendre la poussière avec un chiffon et de laver les carrelages avec des serpillières. La réalisation du travail était bien sûr surveillée et le résultat devait être satisfaisant.
Nous, les plus petits, nous étions pendant le temps imparti au nettoyage, "de corvée de pluches". Une grande bassine contenant de l’eau attendait l’arrivée des pommes de terre. Pendant l’épluchage, en l’absence de toute surveillance, quelques-uns de mes camarades s’amusèrent un jour à lancer des tubercules dans l’eau, pour éclabousser les autres et le sol. Ils riaient fort, tandis que moi, je me tenais tranquille, car par expérience, je savais que la punition n’allait pas tarder. Subitement la porte s’ouvrit et un père nous infligea une punition collective. Nous dûmes réciter le chapelet entier en latin et à haute voix, tout en continuant d’éplucher les pommes de terre. Il resta là, à nous surveiller, et ne quitta les lieux qu’à la fin du chapelet. Et le cirque recommença ! "Un chapelet supplémentaire", décréta le père, qui brusquement avait de nouveau fait irruption. Plus jamais nous ne recommençâmes ce jeu stupide, surtout qu’il nous fallut encore nettoyer la pièce où nous étions installés !
Le samedi après-midi était aussi le moment de rédiger par écrit nos commandes pour les articles dont nous avions besoin : cirage, lacets de chaussures, savon, dentifrice…Je me rappelle, entre autres, avoir commandé un jour un tube de vaseline pour soigner mes mains qui étaient gercées par le froid et saignaient un peu. Toutes ces commandes nous étaient facturées avec la pension trimestrielle.
Un jour, un père (ou un frère) me pria de le suivre. « Que ce passe-t-il encore ? » me demandais-je.
Je fus introduit dans l’imprimerie du collège. Avec une longue baguette, je dus montrer un pays sur une carte du monde (en Asie, si mes souvenirs sont bons) et je fus pris en photo. L’image fut reproduite dans la revue missionnaire éditée par les Franciscains et vendue par correspondance dans certaines localités. On me montra un exemplaire et j’étais fier du résultat. Mais jamais je ne revis la brochure que j’aurais bien aimer posséder.

Nos vacances de Noël débutaient après la fête et se terminaient avant l’Epiphanie. J’étais heureux de retrouver ma famille qui n’habitait plus Kalhausen, mais l’écart de Hutting, dans la maison que j’avais aperçue lorsque j’étais allé chercher de l’eau à la fontaine, avec un jeune qui connaissait l’endroit. C’était la maison dont on avait refait la toiture, la maison de mon beau-père Eugène. Un joli cadeau m’y attendait : un autorail qu’on remontait avec une clé et qui me procurait beaucoup de plaisir quand il parcourait allègrement plusieurs tours sur les rails. J’étais heureux !

La maison, actuellement propriété de Robert Neu.

Mais les vacances finies, il fallut retourner au collège. Très vite, je fus remis dans le bain. Le jour de l’Epiphanie me fit oublier les vacances car tous les élèves eurent droit à une part de la galette des rois. C’était la première fois de ma vie que je vécus cet évènement. J’ignorais que trois fèves étaient cachées dans la galette. Je fus le premier à en découvrir une et le père qui nous surveillait au réfectoire me fit monter sur l’estrade en compagnie des deux autres chanceux. Et, ô comble de ma joie, comme j’étais le plus jeune, j’eus droit à une part supplémentaire de galette après la pose des couronnes des rois sur nos têtes.
Un peu plus tard, la grippe se mit à faire des ravages parmi élèves, frères et pères. Comme je ne connaissais rien à cette maladie, je demandai des explications aux plus âgés. Leurs réponses (mal de tête, fièvre, lassitude, douleurs dans tout le corps) me furent de peu de secours. C’était à midi. Le soir, en prenant place à la table pour souper, je me sentis tout bizarre. La tête me tournait et je n’avais aucune envie de manger. Le père de surveillance s’approcha de moi, tâta mon front et me fit conduire à l’infirmerie où on diagnostiqua la grippe.
Je fus emmailloté des pieds au cou, bras compris, dans des draps bien trempés dans de l’eau chaude et mis à la diète. Cette opération fut répétée de jour comme de nuit, plusieurs fois. Au bout de trois jours, la fièvre avait bien diminué et j’eus droit à des oranges et du lait chauffé. Peu à peu, la nourriture devint plus consistante, et après huit jours, j’étais rétabli et déclaré apte à retourner en classe. Je fus le dernier malade. Pendant la période des soins, il fallut se laver avec du savon noir et le frère infirmier eut beaucoup de mal à me convaincre que ce savon ne me ferait pas ressembler à un nègre !
Le soir du Jeudi-Saint, je fus choisi pour figurer un des douze apôtres dont les pieds seraient lavés pendant l’office. Je refusai catégoriquement car je n’avais pas lavé les miens le matin et je craignais qu’ils ne sentissent pas bon et que j’eusse une punition.
Bientôt Pâques approcha. Nous étions encore au collège pour y célébrer cette fête de la Résurrection de Jésus. Après la messe solennelle, les plus jeunes élèves furent invités à chercher les œufs de Pâques cachés dans le gazon et sous les petits sapins qui bordaient la cour. Quelle joie ! Jamais je n’avais connu une telle fête !
Pendant les vacances passées à Hutting, je pus constater l’énorme différence du niveau de vie ici avec le collège. La toilette se faisait pour tous les membres de la famille dans la cuisine où l’eau coulait sur l’évier de grès grâce à la pompe actionnée à la main. Pour avoir de l’eau chaude, il fallait la chauffer sur la cuisinière. Ma mère et ma sœur attendaient que tous "les hommes" fussent au lit pour faire leur toilette. Nous ne disposions pas encore de l’électricité, donc pas de radio ! Pourtant, la ligne électrique passait à quatre cents mètres environ du hameau. On s’éclairait avec une lampe à pétrole dans la cuisine et un lustre à pétrole dans la salle à manger, la "Schdobb". Les W-C étaient situés à l’extérieur, à l’arrière de la maison. C’était un assemblage de planches qui n’incitait personne à s’y s’attarder en hiver.
Dès le printemps, nous profitions beaucoup de la cour du collège pour jouer surtout à cache-cache. Nous savions tous qu’il était interdit de franchir la limite des petits sapins de la cour. Tout à la joie de ce jeu, après avoir vérifié que personne n’était là pour nous surveiller, nous nous glissâmes, deux camarades et moi, derrière les sapins. Le soir, avant le repas, le père-préfet responsable de la section des petits, demanda aux désobéissants de se dénoncer. A la première injonction, personne ne se leva. A la deuxième, les deux camarades fautifs se levèrent, mais pas moi, croyant être sûr de ne pas avoir été vu. Le père me prit alors au collet et me fit asseoir à une table inoccupée. Ce soir-là, je n’eus rien à manger, mais cela n’était pas prévu dans la punition. C’est seulement à la fin du repas que le père remarqua cette anomalie. C’était mon cousin Charles, le neveu de mon père, qui avait tout bonnement oublié de me servir. Ne l’avait-il pas fait exprès ?
Le jeudi après-midi, si le temps le permettait, on allait se promener en groupe, sous la direction du père responsable, ou bien on pratiquait des jeux dans la cour. Les promenades nous menaient en direction de Bonne Fontaine ou de l’autre côté, vers Bois de Chêne. Bonne Fontaine était un lieu de pèlerinage niché dans un joli cadre de verdure, géré par les Franciscains et où coulait une source miraculeuse.
De grands jeux collectifs à thème étaient aussi organisés pendant les promenades. Un jour, on nous emmena sur un terrain vague où poussaient à foison des genêts très fleuris. Nous fûmes partagés en deux équipes. Chacun d’entre nous reçut, pour le bras gauche, un brassard dans lequel on fichait une bande de papier journal pliée plusieurs fois. Quelques grands élèves en eurent deux, c’était les officiers. Ils ne pouvaient être attaqués que par des gradés comme eux, mais ils pouvaient agresser de simples soldats à une bande. Celui qui se faisait arracher la bande de papier était considéré comme prisonnier et ne pouvait plus combattre. Il devait alors se rendre à un endroit désigné d’avance qui figurait le camp de prisonniers. « Que voilà un beau jeu », me dis-je !
Les touffes de genêts étaient idéales pour s’y cacher et surprendre un adversaire inattentif. Le camp gagnant serait celui qui aurait fait le plus de prisonniers. Tout à coup, je découvris une nichée de levrauts blottis dans une touffe de genêts. Qu’ils étaient mignons ! Un camarade de mon camp me rejoignit, mais cette distraction causa notre perte, nous fûmes faits prisonniers. De toute façon, notre groupe avait déjà perdu la bataille.

Promenade en bon ordre !
Le troisième trimestre fut marqué par l’ordination de plusieurs prêtres un dimanche matin. L’après-midi fut marqué par la confirmation de quelques élèves, dont moi. J’eus l’honneur de servir la messe d’ordination célébrée par un évêque. Mon rôle était de tenir parfois la crosse de l’évêque et de porter le coussin sur lequel reposait la mitre, quand il ne la portait pas. J’étais fier ! Le moment le plus émouvant était celui où les futurs prêtres étaient allongés sur le sol, devant l’autel, face à terre, jambes et bras allongés tandis que l’on chantait la litanie des saints en latin. L’après-midi m’a moins marqué car je ne savais pas trop ce que signifiait cette "confirmation". Ce n’est que plus tard que je compris : on affirmait vouloir vivre en chrétien, on renouvelait les vœux de baptême. Bien sûr, le menu de cette fête était exceptionnel et tout le monde était ravi.

La chapelle est sobre et lumineuse.
Les deux confessionnaux sont visibles au début de la nef.
Le chœur est entouré de plusieurs absidioles, avec autel,
permettant à plusieurs pères de dire leur messe simultanément.
En cours de promenade, nous chantions et chacun avait son fascicule de chant, sauf les plus âgés. Je me souviens avoir croisé un jour un groupe de jeunes qui portaient tous une casquette aux parements dorés avec l’inscription EPS (Ecole Primaire Supérieure). Ces jeunes devaient passer l’examen du Brevet Supérieur qui permettait, après concours d’être admis à l’Ecole Normale d’Instituteurs. J’étais un peu jaloux de cette belle casquette.
Vers la fin du troisième trimestre, nous fûmes mis au courant du danger de la guerre qui se préparait suite aux agissements de Hitler. Toutes les vitres et les ampoules furent badigeonnées d’une peinture d’un bleu foncé. On organisa des exercices d’évacuation du collège de jour et de nuit pour aller se réfugier dans le sous-sol. Aujourd’hui, je me demande si cela aurait servi à quelque chose. Et l’année scolaire terminée, je rentrai à Hutting.

Année scolaire 1959-1960.
Les élèves et la communauté éducative (10 pères, 3 frères et 2 laïcs).
La guerre arrive
Au mois d’août, les craintes d’une guerre imminente se précisèrent. Une lettre du collège de Phalsbourg nous pria de retirer nos affaires personnelles restées là-bas. Ce fut un long voyage à travers tout le département. Hutting, Phalsbourg, Lutzelbourg, Metz, Bouzonville, où ma mère et moi passâmes la nuit. Le lendemain, retour par Hargarten, Béning et Sarreguemines, pour revenir à Kalhausen. Pourquoi ce voyage à travers le département ? Tout simplement pour récupérer mes affaires et aussi revoir la famille avant la guerre.
Au cours du même mois, mon beau-père Eugène et moi, nous nous rendîmes à Aulnoy-sur-Seille où les services de la Préfecture s’étaient repliés. Nounou Emile y était chef de bureau. Tante Gabrielle nous apprit qu’en cas d’invasion allemande, leur famille serait obligée de rejoindre Nancy. Comment se présentait l’avenir ? Personne ne pouvait le savoir.
Et la catastrophe arriva. Le 1er septembre 1939, toutes les localités situées dans une bande de 15 kilomètres de large environ le long de la frontière reçurent l’ordre d’évacuation. Il fallait tout quitter. On ne pouvait emmener que le strict nécessaire. Mais nous avions encore de la chance dans le malheur, car nous disposions d’une charrette et de vaches pour la tirer. Mon beau-père Eugène et le chef de gare de Kalhausen étaient réquisitionnés pour organiser le trafic des trains de l’armée.
Dans la soirée, tous les habitants de Kalhausen se rassemblèrent sur la place du village, devant l’église. Le maire et les conseillers municipaux pointèrent les membres de chaque famille. Contrairement aux habitants de Kalhausen qui rallièrent Réchicourt-le-Château pour embarquer dans des trains en direction de la Charente, nous rejoignîmes Drulingen, puis Phalsbourg et enfin Dannelbourg. Ce village n’avait pas été évacué. Comme mon beau-père Eugène possédait une moto, il retourna à Kalhausen avec le chef de gare pour y organiser les transports militaires. Nous ne restâmes que trois ou quatre semaines sur place. Nous étions logés dans une petite maison où nous nous sentions à l’étroit. A l’époque, les vacances d’été se terminaient le 30 septembre. Les salles de classe étaient d’ailleurs occupées par des soldats.
Au début de notre séjour, nous étions ravitaillés par la commune qui avait organisé une "popote" où j’allais chercher le repas de midi. Ce n’était pas extraordinaire comme menu ! Désœuvrés, Armand et moi, nous errions de ci de là. Un jour, un joli tas de rondins de sapins nous donna l’idée de construire une cabane dans le verger qui faisait suite au potager, non loin de l’orée de la forêt. Mais, ô malheur, nous ignorions que ce bois était réservé pour être vendu aux enchères et trois ou quatre jours plus tard, à notre grand regret, nous dûmes remettre ces rondins à leur place : il n’en manqua aucun !
Beau-père Eugène et son chef de gare étaient maintenant affectés à la gare de Diemeringen. Nous déménageâmes avec nos quelques affaires dans un logement exigu se composant d’une cuisine et de deux chambres, situé à Mackwiller. Entre temps, il avait réussi à ramener de Kalhausen la plus grande partie de notre mobilier et nos affaires. Et il fallut retourner à l’école primaire de ce village qui en comptait deux : une catholique et une protestante. Chacune de ces écoles ne comptait qu’une seule classe regroupant les élèves de six à quatorze ans. A l’époque, surtout en Alsace, il ne fallait pas mélanger les religions !
C’était une maîtresse déjà âgée qui était chargée de l’école catholique. Je fus affecté au cours de fin d’études ainsi qu’un autre élève également réfugié et dénommé René, comme moi. Nous étions assis côte à côte, au dernier rang, à côté de quelques filles. Notre famille habitait dans un écart du village, sur la route de Diemeringen à Durstel. C’était la dernière maison.
Tous les immeubles (maisons, granges, hangars) fourmillaient de soldats. Or la "popote" militaire fonctionnait dans un bâtiment ouvert sur un côté, tout près de notre logement. Quand j’étais libre, je distribuais les rations dans les gamelles de ces militaires dépaysés dont certains étaient de race noire et étaient venus des colonies pour défendre leur "patrie".
Un soir, le menu était constitué d’une bouillie de riz chocolatée guère appréciée de ces pauvres hères. Et le reste, une grande marmite pleine, me fut donné par le cuisinier. Nous, les enfants, nous nous sommes régalés pendant trois jours de cette délicieuse manne.
Je fis aussi connaissance d’un abbé en tenue militaire qui m’aimait bien. Il m’offrit un jour des tartines de rillettes délicieuses, "fabriquées maison", c’est-à-dire sur place, par un soldat qui avait tué un cochon certainement récupéré dans la zone évacuée. J’étais aussi garçon de courses pour acheter
du "pinard" à l’épicerie. Le vin se vendait à l’époque en vrac, dans un récipient apporté par le client. Parfois je recevais quelques piécettes d’un à dix centimes qui me permettaient d’acheter des gâteries : abricots séchés, cacahuètes, bonbons…
Entre midi, les soldats occupaient la salle de classe pour écrire des lettres à leur famille. La maîtresse n’appréciait guère et se plaignit plusieurs fois à leur chef pour désordres, papiers sur le sol…Mais les vrais fautifs étaient certains élèves, qui profitaient du départ des soldats pour entrer dans la salle de classe et y faire de bêtises dont étaient ensuite accusés les hommes de troupe.
Cette période était excitante pour moi et mon camarade René, car du point de vue intellectuel, nous dépassions largement les autres élèves. La maîtresse m’avait baptisé René 1 et mon camarade était René 2, elle avait enfin compris qu’en appelant René, tous les deux se levaient et aucun ne savait à qui cela était adressé.
Un jour, la maîtresse m’interrogea sur la formation du pluriel des noms. Aussitôt, René 2 me souffla : « Deux s ! » C’est la réponse que je donnai et la punition tomba aussitôt : « 50 fois. Pour former le pluriel, on n’ajoute qu’un seul s. » Puis René 2 fut interrogé sur la formation du féminin et sa réponse fusa : « Deux e, mademoiselle ! » Lui aussi écopa de 50 fois. Les filles se marraient en douce, tête baissée.
Comme la maîtresse profitait de la récréation pour monter dans son logement de service, nous étions sans surveillance. Un jour, quelqu’un eut l’idée de visiter pendant la récréation, un "bunker" situé non loin de l’école. Les petits ne furent pas mis au courant de ce projet. Tous les grands s’éclipsèrent donc discrètement pour faire la connaissance approfondie d’une casemate, ce qui demanda un certain temps, car les deux René ne manquèrent pas de faire étalage de leurs connaissances au sujet des meurtrières, du béton armé et du blindage des ouvertures.
Mais quand notre équipe rejoignit enfin l’école, la récréation était terminée depuis longtemps et la maîtresse "s’arrachait les cheveux" au sujet de la mystérieuse disparition d’une partie des élèves. Nous fûmes sévèrement réprimandés et nous promîmes avec conviction de ne plus jamais recommencer, non sans expliquer auparavant le but pédagogique de notre escapade.
Notre chère maîtresse détestait l’odeur des cacahuètes. Grâce à "mes pourboires" d’origine militaire, tous les grands profitaient d’en manger avant l’entrée en salle de classe. Toutes les haleines étaient infectes et elle n’arrivait pas à trouver l’origine de cette "épidémie" qui avait gagné les grands.
J’étais "riche" par rapport aux autres, car je me faisais aussi de l’argent de poche, en tant qu’enfant de chœur à l’occasion de baptêmes, non seulement à Mackwiller, mais aussi dans les villages voisins de Thal-Drulingen et Berg. Le curé, qui habitait Thal et qui desservait aussi Mackwiller, avait appris par l’aumônier militaire que j’avais été élève du collège Saint Antoine de Phalsbourg. Il se proposa de me donner ainsi qu’à l’autre René, des cours de latin. Pour moi, c’était une initiation, je ne connaissais que le latin d’église, plutôt de servant de messe, que je répétais bêtement sans le comprendre.
Chaque jeudi matin, je filais à bicyclette (un vieux "clou" !) jusqu’à Thal, situé malgré son nom sur une colline, alors que Berg se trouve dans la vallée ! Les cours de latin duraient deux heures et ne coûtaient rien. Et moi, j’étais heureux !
Le curé m’avait aussi chargé de former des enfants de chœur à Mackwiller. Cette fonction me plut beaucoup. Le jeudi après-midi donc, je leur apprenais le vocabulaire latin en usage lors de la messe et faisais des exercices pratiques dans la petite église, en jouant le rôle du prêtre. Or, un jour, notre maîtresse fit irruption dans l’église et que vit-elle ? René 1 encensant l’autel et bénissant des paroissiens imaginaires au moyen du goupillon en disant : « In nomine patris et filii et spiritus sancti. », les apprentis servants de messe répondant : « Amen. » Cette bonne dame cria au blasphème et s’en ouvrit au curé qui, après quelques explications de ma part confirmées par mes camarades, éclata de rire devant la maîtresse médusée.
Puis arriva le jour de la Communion Solennelle à Thal, pour les trois paroisses. C’était bien sûr moi, le chef des enfants de chœur. Après la messe, alors que je m’apprêtais à rentrer à la maison, sachant que je devais de toute façon revenir dans l’après-midi pour les vêpres, le curé m’invita à rester déjeuner dans une des familles concernées par la Communion. La famille s’est montrée si accueillante, si sympathique que je ne pus refuser. Le menu de la journée était simple, mais délicieux : bouchées à la reine, pot-au-feu au gros sel, le tout accompagné de salades, puis le soir, coq rôti au four accompagné de légumes, sans oublier chaque fois les desserts : gâteaux, tartes et fruits. Je fus choyé par la famille et j’eus même droit à un verre de liqueur ! Le soir, après le dîner, je rentrai à Mackwiller, heureux et comblé, sur mon vieux biclou.
Beau-père Eugène et le chef de gare s’absentaient souvent avec la moto. Un jour, ils rentrèrent avec une automobile, chose rare pour l’époque. D’où provenait-elle ? Je ne saurais le dire. Toujours est-il qu’ils firent alors un voyage à Paris. Je croyais rêver. Paris ! Quel évènement ! Au retour, ils racontèrent leur séjour dans la capitale. D’après leur récit, il me sembla que leur principal but de voyage avait été "les Folies Bergères" et "le Moulin Rouge". Je ne pouvais pas m’imaginer ce que c’était, car la télé et les magazines n’existaient pas.
L’hiver 39-40 était rude et les deux ruisseaux étaient saisis par la glace, ce qui nous permit de les franchir sans problème pour raccourcir le trajet de l’école. Un jour pourtant, la glace céda et mes pieds furent trempés. J’en étais quitte pour revenir à la maison me changer et rattraper le retard. Armand avait eu plus de chance, il était passé sans encombre.
Le printemps arriva et je trouvai une nouvelle occupation : la pêche aux goujons que j’avais observés à travers l’eau cristalline, sur un banc de sable. C’était une méthode de pêche originale : on disposait au fond de l’eau une bouteille dont le fond avait été coupé, ouverture vers l’amont. Le goulot était obstrué par un bouchon de liège et une ficelle était attachée à la bouteille. Un bout de pain était placé dans la bouteille et servait d’appât. Quand je jugeais que le nombre de goujons dans la bouteille était suffisant, je tirai un coup sec sur la ficelle et la bouteille atterrissait sur l’herbe. Je recommençais plusieurs fois pour avoir la quantité de poissons suffisante pour une friture. Après le nettoyage des poissons, ma mère nous préparait une bonne friture dont tout le monde se régalait.
Le mois de mai arriva et fut celui qui nous causa les premiers soucis de la guerre, après ceux de l’évacuation. Jusque là, on avait parlé de "Drôle de Guerre", car rien ne s’était encore passé dans notre région. Mais là, les Allemands avaient envahi la Hollande, la Belgique et la menace d’une attaque contre la France se précisait. Des avions ennemis sillonnaient déjà le ciel et les masques à gaz civils devaient accompagner toute personne circulant dehors. Un jour, un avion ennemi survola notre maison et aussitôt les soldats tirèrent dans sa direction, tout en blaguant. Je me posais des questions :
« C’est ainsi qu’on fait la guerre ? » Et l’avion disparut.
Une autre fois, des "Messerschmitt" manoeuvraient dans le beau ciel bleu de mai. Nous, les enfants, conformément aux instructions reçues, nous enfilâmes notre masque à gaz. Nous ressemblions à des bêtes curieuses. Mais imaginez la peur de notre chère maîtresse, en nous voyant ainsi défigurés, faire irruption dans la salle de classe. Ce fut un tollé général ! Tout de suite, après nos explications, elle décida de nous renvoyer à la maison, vu le danger potentiel pour ses élèves.
Le lendemain, tout était calme et nous reprîmes "courageusement" le chemin de l’école. L’après-midi, les grands (les 12-14 ans) eurent à dessiner de mémoire une fraise avec son feuillage. Or, au cours du trajet vers l’école, une des filles qui habitaient avec nous l’écart de la route de Durstel, nous avait raconté qu’elle allait jouer un petit tour à cette bonne demoiselle d’institutrice. A la fin de l’exercice de dessin, assise à son bureau, l’institutrice se mit à contrôler l’exécution artistique de la fraise. Lorsque mon tour arriva, elle trouva que ma fraise ressemblait plutôt à une pomme, vu sa taille. J’étais outré ! Soudain, elle bondit de sa chaise, tout en criant :
« Mon Dieu, mon Dieu, ça me démange de partout ! » Et elle se mit à se gratter le dos, le cou, la poitrine…
« Rentrez immédiatement à la maison, mes enfants ! Pas de devoirs.»
Bien sûr, elle ne fut pas obligée de le répéter deux fois. Que s’était-il passé ? La fille en question avait ouvert une petite boîte contenant des fourmis qui ne demandaient pas mieux que de se promener partout, surtout sur le corps de notre maîtresse, provoquant des démangeaisons. Comme nous avons ri sur le chemin du retour !
N’empêche, notre bonne maîtresse a su me donner le goût de la lecture. Elle choisissait toujours un livre dans la bibliothèque et lisait à la classe le début de l’histoire. Puis elle demandait qui voulait lire le livre pour connaître la suite. Je levais souvent le doigt et je dévorais le livre en une soirée. J’en reprenais un autre le lendemain. C’est ainsi que je devins "accro" à la lecture.
La période allemande
L’arrivée des Allemands
Un beau jour, les soldats français nous quittèrent, pour aller où ? Personne ne le savait. Le chef de gare et beau-père Eugène nous apprirent que les Allemands étaient tout proches. Je pensais les voir arriver de Diemeringen, mais ils vinrent de Durstel. Je n’y comprenais plus rien, ce n’était pas de ce côté qu’ils devaient venir. Comment expliquer cette surprise ? Tout simplement par l’invasion de la Belgique, pourtant pays neutre. Ils avaient envahi le nord de la France et prenaient donc les troupes françaises de la ligne Maginot à revers. Et les soldats français avaient reçu l’ordre de se replier. Tout cela, je ne le compris que plus tard, lorsque je pus me documenter.
Je me trouvais devant la maison de Mackwiller, lorsqu’une moto avec side-car s’arrêta. Deux soldats allemands en descendirent et, claquant des talons, le bras tendu à hauteur des yeux et le corps droit, me saluèrent d’un tonitruant « Heil Hitler ! » L’un d’eux devait être un officier et il s’adressa à moi dans sa langue natale, mais je ne comprenais pas grand-chose. Le propriétaire de notre maison arriva alors et les reçut fort aimablement, ce que j’eus du mal à comprendre. Moi, j’observais nos ennemis d’abord avec circonspection, mais je l’avoue franchement, ils me firent ensuite bonne impression : ils étaient bien habillés, ils étaient polis, ils avaient l’air aimable. Les soldats français que j’avais appris à connaître, au contraire, n’étaient pas à leur hauteur avec leur tenue débraillée, leurs bandes molletières et leur grand manteaux brun. Les Allemands étaient vêtus correctement et proprement : bottes lustrées, mains gantées, fière casquette sur la tête…et non ce calicot porté négligemment !
Voici donc les Allemands sur place ! Quelques jours plus tard, nous déménageâmes à Diemeringen, dans une maison plus spacieuse située en direction
de Wingen. Il n’y avait plus classe, je m’ennuyais fermement et j’en profitais pour découvrir le bourg et ses alentours.
Le retour à Hutting
Quelques semaines plus tard, fin août 40, beau-père Eugène annonça que le retour à Kalhausen était autorisé. Nous retrouvâmes enfin, après pratiquement un an d’absence, notre maison de Hutting qui heureusement n’avait pas subi de dégâts. Grâce à son emploi de cheminot et sa présence fréquente sur les lieux, il avait pu surveiller la maison et préserver ainsi le mobilier restant. Nous avons donc eu peu de dédommagements de guerre par rapport à d’autres familles qui rentrèrent plus tard et retrouvèrent leur demeure saccagée. Désormais nous étions, pour un moment, les seuls habitants de Hutting.
Ce fut pour nous, les enfants, l’occasion de fouiner un peu partout. Devant l’église de Kalhausen, sur la place du village, traînait une belle bicyclette abandonnée. Je voulus me l’approprier, mais ma mère me l’interdit fermement. Elle, par contre, en profitait pour s’accaparer de certaines choses qui l’intéressaient. "Fais ce que je te dis, mais pas ce que je fais.", aurait pu être sa morale.
Nous devions subvenir à nos besoins par nos propres moyens. Au village abandonné, il n’y avait encore rien. Par contre, en Alsace Bossue, à Diemeringen, qui n’avait pas été évacué, on pouvait trouver de tout. Chaque semaine, je devais me rendre à vélo à la brasserie de Lorenzen, distante d’une douzaine de kilomètres, pour y acheter un bidon à lait plein de morceaux de levure de bière destinée à la fabrication de belles miches de pain qui se conservaient à la cave pendant une semaine.
Je pédalais allègrement sur un vieux "biclou", regrettant amèrement ne pas posséder le beau vélo de la place de l’église. Et plus d’une fois, je revenais
de mon voyage, trempé jusqu’aux os par des averses orageuses.
A Hutting bivouaquaient des soldats allemands gardant des prisonniers français chargés de réparer le pont de chemin de fer qui avait été démoli pour empêcher les Allemands d’avancer. Parmi ces Français, il y avait quelques hommes de couleur "café" qui étaient venus en France pour défendre leur "patrie". Tous ces prisonniers souffraient de faim et de soif. Parfois, je leur apportai quelque nourriture et de l’eau. Les Allemands me laissaient faire sans rien dire. Certains prisonniers étaient prêts à donner n’importe quoi pour un peu de nourriture, mais je ne me laissai jamais aller à ce troc honteux.
Entre temps, je parlais déjà un peu l’allemand courant. Un jour, un gradé allemand me demanda si mon beau-père battait ma mère. Je tombai des nues et restai muet. Sur sa demande réitérée, je répondis avec conviction n’avoir jamais remarqué pareil comportement de la part d’Eugène. Je ne voyais pas mon beau-père battre ma mère, il était très gentil avec les enfants. Ce n’est que récemment que ma sœur Yvette me donna des explications. Selon elle, ma mère provoquait son mari et il en arriva parfois à de telles réactions. Pourquoi ? Parce qu’elle voulait hériter de son mari pour ses enfants. En effet, la maison de Hutting était un bien personnel d’Eugène, qu’il avait hérité de ses parents et nous, les enfants, n’avions aucun droit, puisqu’il n’était pas notre père.
Ainsi, elle faisait tout ce qui était possible pour qu’elle soit déclarée héritière de la maison en cas de décès de son mari et elle obtint ce qu’elle voulait.
Un acte notarial retrouvé après la mort de ma mère le confirme.
Une autre civilisation commence
Les habitants du village revinrent en septembre 40 et trouvèrent leur maison saccagée. Les troupes françaises avaient brûlé tout ce qui pouvait l’être : meubles, stock de bois, poutres du toit, planchers, car l’hiver avait été rude. De plus, beaucoup de soldats provenaient de régions au climat plus doux. Théoriquement, cela était strictement interdit, mais vu les circonstances, c’est explicable.Toute guerre a inévitablement des conséquences anormales.
Nos soldats détruisaient et volaient, alors qu’ils étaient censés protéger nos biens et nous défendre… et pendant ce temps on incitait les Français à leur envoyer des gants, des chandails, des sous-vêtements chauds…
La "Volksschule", l’école du peuple, démarra aussitôt en septembre. L’instituteur allemand nous initia à la lecture et à l’écriture gothiques, ce qu’on appelle la "Spitzschrift" ou "Sütterlin". Ce ne fut pas facile pour beaucoup d’élèves, mais je m’en sortais très bien. Je sais actuellement encore lire
cette écriture, et un peu moins l’écrire à cause des majuscules.
 |
L’école était meublée de mobilier hétéroclite récupéré un peu partout : les chaises, les bancs, les tables étaient tout, sauf du mobilier scolaire. Tout avait aussi disparu pendant la Drôle de Guerre. Chaque semaine, je devais me rendre à vélo à Rohrbach pour y chercher des fascicules spécialement imprimés pour les écoliers mosellans et appelés "Der Schulhelfer", l’aide scolaire, en vue de l’acquisition et de la pratique de la langue allemande qui a une tout autre structure "phraséologique" que la langue française. Exemple : le participe passé est rejeté à la fin de la phrase (J’ai mangé du pain. Ich habe Brot gegessen.). Cette revue était d’abord rédigée dans les deux langues, puis uniquement en allemand. La germanisation était en route !
Je me rappelle d’une leçon de géographie pour la section des grands : le maître nous parla du Rhin,"Vater Rhein" : sa source, l’altitude, les pays traversés ou longés, les villes arrosées, son estuaire, sa longueur…Bref, c’était un cours magistral, au contenu très développé. Tout cela, sans aucun document, sans photos, sans carte. Après la leçon, chaque élève devait reprendre, par écrit, sur l’ardoise, certains détails de la leçon. Puis le maître contrôla les réponses. Presqu’aucun élève n’avait noté quelque chose de cohérent. Le premier élève contrôlé demanda mon ardoise pour répondre, puis le second. Au troisième, le maître remarqua que c’était toujours le même texte. Il flaira la supercherie, saisit l’ardoise et se mit en quête de trouver celui qui ne possédait plus son ardoise. Bien sûr c’était moi, le coupable. J’eus droit à un beau sermon sur la tricherie et il réprimanda les autres pour leur inattention. Je ne fus pas puni et à la fin de l’année scolaire 1940-1941, il me fit admettre à la "Oberschule " de Sarreguemines, au lycée, dans la " Klasse 1" la sixième.
L’Oberschule comptait huit années de scolarité pour obtenir l’ "Abitur", l’équivalent du baccalauréat : Klasse 1, la 6°, Klasse 2, la 5°, Klasse 3, la 4°, Klasse 4, la 3°, Klasse 5, la 2°, Klasse 6, la 1ère, Klasse 7, la préterminale, Klasse 8, la terminale. Les élèves aux résultats insuffisants étaient éliminés au fur et à mesure.
Les notations se faisaient ainsi : 1, "sehr gut" (très bien), 2, "gut" (bien), 3, "befriedigend" ou "zufriedenstellend" (satisfaisant), 4, "ungenügend" (insuffisant). Auparavant, il existait un 4, "ausreichend" (passable) et un 5," mangelhaft" (insuffisant).
Après 1943, les élèves, à partir de 16 ans révolus, devaient servir dans le "Luftwaffenschutz", auxiliaire de la "Flak ", la DCA allemande (la Défense contre Avions).
L’Oberschule de Sarreguemines était aussi fréquentée par des lycéens provenant du land de Sarre (Saarland) et habitant des localités proches de Sarreguemines et situées dans les vallées de la Sarre et de la Blies. Certains professeurs étaient d’origine mosellane ou alsacienne et poursuivaient leur carrière, malgré l’annexion : Braun, Cichoky (lettres), Sonntag (mathématiques), Muller (anglais), Hiegel (histoire-géographie).
Cette première année de lycée ne fut pas catastrophique pour moi, puisqu’à la fin de l’année scolaire, je fus admis directement en troisième année. Que dire des professeurs ?
La plupart étaient très corrects. Le professeur principal, Monsieur Welsch, nous enseignait l’anglais et l’allemand. Je me rappelle d’un sujet de rédaction :
"Großmutter erzählt ein Märchen." (grand-mère raconte un conte).
J’obtins une très bonne note pour avoir bien cadré l’histoire dans la pénombre du soir, à la lueur du feu dans la cheminée. Pendant les cours d’anglais, il en reçut des postillons dans la figure, quand il nous enseignait la prononciation du son "th", le bout de la langue devant s’insérer entre les deux rangées de dents !
Les programmes n’étaient pas chargés et les devoirs demandaient peu de temps. Les cours débutaient à 8 heures pour se terminer à 13 heures, tous les jours, du lundi au samedi. Le matin, à 6 heures et demie, je prenais le train à la gare de Kalhausen, en compagnie des ouvriers et employés qui travaillaient à Sarreguemines. Les lycéens qui arrivaient au lycée en avance sur l’horaire trouvaient accueil dans la salle de musique où trônait un piano à queue fermé à clef bien entendu. Il n’y avait aucune surveillance et je puis affirmer qu’en général on se tenait tranquille, car on craignait la discipline allemande. Il en était de même tant qu’un professeur n’était pas encore arrivé.
L’hiver 42-43 fut très dur et une couche de neige de près d’un mètre recouvrait le sol et resta jusqu’en février. Nous construisîmes, dans les prés, des igloos au moyen de grosses boules de neige taillées à la bêche en forme de parallélépipèdes. Les igloos n’étaient pas fermés au sommet et des meurtrières étaient pratiquées dans les murs pour pouvoir observer "l’ennemi" sans danger. Il y avait deux camps, les défenseurs et les assaillants. Le combat commençait au signal. Tout "soldat" touché par une boule de neige était considéré comme mort et devait cesser le combat. Le gagnant était le dernier survivant !
Une autre de nos activités préférées était la "navigation" sur l’Eichel, rivière qui passait à Hutting. A notre retour de l’évacuation, nous avions trouvé dans la nature des caissons en métal renfermant encore des munitions pour mitrailleuses. Nous les avions vidés de leur contenu et fait exploser plusieurs de ces bandes de balles en les jetant dans le feu. Ces jeux stupides nous furent interdits par nos parents à cause du danger, mais les caissons devinrent des embarcations de fortune, pour notre plus grand plaisir. Avec six caissons, arrimés entre eux, deux par deux, nous fabriquions un radeau qui nous permettait de naviguer sur les mares formées par les inondations ou les fortes pluies, et même sur l’Eichel. Une latte en bois nous servait alors de rame.
Pour nous, tout se passait bien, mais il en fut autrement pour notre copain Raymond Herrgott. Un jour, alors qu’il s’adonnait à la navigation sur une mare, l’un de nous lui cria : « Attention, l’eau rentre par l’arrière ! »
Il se pencha alors vers l’avant et l’eau rentra par la proue. Il fit alors exprès de se balancer plusieurs fois d’avant en arrière, de sorte que l’embarcation prit l’eau et sombra. Raymond prit pied dans la grande flaque d’eau, fier d’avoir pu sauver son embarcation, mais trempé jusqu’aux os. A la maison, une bonne paire de claques fut la réponse à son naufrage, mais il ne s’en offusqua pas.
Quelques jours plus tard, il connut encore une fois les périls de la navigation. Lui et moi, nous naviguions paisiblement sur l’Eichel. Soudain, il voulut satisfaire un besoin naturel et décida d’accoster sur la rive gauche, moins escarpée que la droite. Il se dressa dans l’embarcation et agrippa une branche de saule. Mais ce mouvement chassa l’embarcation vers le milieu de la rivière et voilà mon Raymond, accroché à sa branche et les jambes dans l’eau ! La branche pliait de plus en plus, sous le poids, et Raymond s’enfonçait de plus en plus dans l’eau froide de ce mois d’octobre. Finalement, elle céda et Raymond se retrouva dans l’eau jusqu’à la poitrine. Pour retourner sur la rive droite et pouvoir rentrer à Hutting, il dut faire un détour et traverser la rivière sur un tronc d’arbre providentiellement tombé en travers. Il se tira de cette mésaventure avec une bonne bronchite et aussi une raclée mémorable qui lui fit passer l’envie de jouer au capitaine de bateau.

Notre joyeuse troupe insouciante. Le plus grand, c’est moi.
Le lendemain commençait un travail dégoûtant pour moi. Il me fallait plonger la main dans la masse de grenouilles devenue visqueuse à cause de la bave secrétée pendant la nuit et attraper les bêtes. Prenant les grenouilles une par une, par les pattes postérieures, je les assommai en les frappant sur un billot de bois. Puis, au moyen d’une hachette, je séparai les pattes arrière du tronc. Ce travail terminé pour toutes les bêtes, je dépeçai les membres en tirant sur la peau, depuis le haut des cuisses jusqu’aux pattes. Enfin, il fallait nettoyer, laver et saler ces précieuses cuisses de grenouilles. Ma mère n’avait plus qu’à les faire frire et nous nous régalions de ce mets délicieux.
Une autre activité spécifique nous occupait encore en automne, après la récolte du regain, c’était la garde des vaches dans les prés, le plus souvent, entre le chemin de fer et l’Eichel. Comme le temps devenait frisquet, nous en profitions pour allumer un feu avec du bois mort et nous régaler au moyen de pommes de terre chipées dans un champ voisin et cuites dans les braises. Mais les pommes et les quetsches, préparées de la même façon, étaient bien meilleures.
Lien vers le dossier de l'A.H.K "La pâture"
Les bombardements
Déjà, dans la nuit du 2 septembre 1942, le quartier de l’église de Sarreguemines fut gravement endommagé par 60 à 70 bombes et une mine aérienne qui provoquèrent la destruction de 27 maisons, l’endommagement grave de 53 autres et la mort de 7 personnes. En outre, 143 personnes furent blessées, dont 20 grièvement.
Le 4 octobre 1943, nous, les élèves du lycée, nous vécûmes un terrible bombardement sur Sarreguemines. Nous étions réfugiés dans l’abri souterrain aménagé sous le monticule où s’élèvent actuellement les nouveaux bâtiments du lycée Jean de Pange. Soudain, la lumière s’éteignit et le sol trembla sous nos pieds pendant plusieurs minutes, ce qui augmenta notre angoisse dans le noir complet. Ce bombardement dura de 10h 55 à 11h 35, faisant 132 morts, 73 blessés graves et 236 blessés plus légers. Je me rappelle ces écoliers allongés dans leur cercueil et recouverts d’un drap blanc dont seule émergeait la tête. C’était des élèves de l’école de la Sarre située Chaussée du Louvain, sur la rive gauche de la Sarre. Pauvres victimes d’une guerre impitoyable ! Il semble que les trois ponts et les usines étaient particulièrement visés.
Après le bombardement, nous fûmes renvoyés à la maison. Par curiosité, je suis allé voir les dégâts dans l’actuelle zone piétonne. L’emplacement des Nouvelles Galeries était effondré. Tous les réfugiés de cet abri moururent soit par blessure, soit par noyade, car les conduites d’eau s’étaient rompues. En face de l’ancien cinéma Eden et des chaussures Bata, une maison s’était écroulée et des gens hurlaient. J’en avais assez vu et entendu et décidai de rentrer rapidement.
Je me rendis alors à la gare où j’appris que la circulation des trains était interrompue, les voies ferrées ayant été endommagées. Il ne me restait plus qu’à regagner Hutting à pied, soit une quinzaine de kilomètres. Avant d’arriver à la gare de Kalhausen, je me rendis au poste d’aiguillage où travaillait mon beau-père. Comme il fut heureux de me voir sain et sauf, car il était au courant qu’une école de Sarreguemines avait été touchée. A mon retour à la maison, ma mère ne manifesta aucun sentiment de joie, car elle ne pouvait pas savoir ce qui s’était passé à Sarreguemines. Je lui racontai ce que j’avais vécu, mais elle resta de marbre, insensible, comme si cela ne la concernait pas.
Il y eut encore d’autres bombardements, mais dans lesquels je n’étais pas impliqué. J’ai cependant assisté de loin au bombardement de Sarreguemines du 1er mai 1944. En raison de la fête du Travail, nous n’avions pas classe et j’étais, vers 19 heures, devant la maison à Hutting, quand j’entendis un fort vrombissement : plusieurs vagues de B 17, "les forteresses volantes", en tout soixante avions, se dirigeaient vers Sarreguemines, en suivant le tracé de la voie ferrée Strasbourg-Sarreguemines et lâchèrent des chapelets de bombes (299 au total). Les voies ferrées, les autres voies de communication, les industries d’armement et le réservoir d’eau de la ville étaient cette fois visés.
«Pauvres Sarregueminois, pensai-je, ils n’ont pas fini d’en baver !»
Le bilan de cette attaque fut de 56 morts civils et 169 destructions. Les voies ferrées menant au chef-lieu d’arrondissement étaient détruites et ne furent rétablies que le 22 mai suivant (9)
__________________
9) Les renseignements chiffrés cités par René sont tirés de l’ouvrage "La Tragédie Lorraine Sarreguemines-Saargemünd 1939-1945" Tome 1 d’Eugène Heisser Editions Pierron 1978
Mais j’ai encore connu d’autres alertes aériennes, comme à Bouzonville, par exemple. Lors de cette alerte nocturne, je dormais comme d’habitude dans une chambre de l’étage. Grand-père demanda à grand-mère de me réveiller. Comme il était interdit d’allumer une lampe, elle dut passer par une pièce sans fenêtre où se trouvait l’escalier menant au rez-de-chaussée. Elle tomba dans le noir et dégringola l’escalier. Je fus réveillé par le bruit de la chute. Elle gisait sur les dernières marches, la tête ensanglantée. Grand-père perdit tous ses moyens. Je lui demandai de m’aider à la soulever et à la conduire doucement à la cuisine. Puis j’allumai la lumière et, avec un gant de toilette mouillé, lui nettoyai avec doigté la figure. Une affreuse plaie béait sur son front et saignait abondamment. J’ordonnai à grand-père d’aller quérir la sage-femme qui habitait tout près. Grand-mère était presque inconsciente. A l’arrivée de la sage-femme, je fus soulagé et elle me félicita pour mon esprit d’initiative. Elle jugea nécessaire d’appeler un médecin qui la fit transporter à l’hôpital de Boulay. Ce n’est que quelques jours plus tard que je fus autorisé à lui rendre visite. Jamais je ne l’aurais reconnue : sa tête était boursoufflée, ses yeux complètement fermés, la peau teintée de toutes les couleurs, jaune, rouge, violacée et bleue. Elle se remit heureusement assez vite car elle n’avait aucune fracture à la tête.
Même Hutting et Kalhausen furent bombardés, mais uniquement avec des bombes incendiaires au phosphore. Quelle cible visaient les aviateurs ? Il n’y avait aucun objectif militaire dans les alentours. Le sol était jonché de tubes de section carrée qu’on nous interdisait formellement de toucher.
De plus, on trouvait aussi, comme à Bouzonville, des bandelettes de papier argenté qui servaient à brouiller les radars. Ces bombes endommagèrent la première maison de Kalhausen, en venant de la gare. Les dégâts furent sérieux. En deux jours, les bombes furent ramassées par des spécialistes de la "Wehrmacht" (10)
Une autre nuit, je fus réveillé par des avions. Je me lève et regarde par la fenêtre. Que vois-je ? Probablement deux parachutes. Je me lève tôt le matin et me rends à l’endroit du parachutage. Il n’y avait plus rien, mais l’herbe était foulée et on voyait nettement des traces de pas. Que s’était-il passé cette nuit-là ? Je n’ai jamais pu le savoir.
__________
10) Il s’agit de la maison Juving. Ci-dessous témoignage de Marie Elise Fabing, née Juving, de Kalhausen qui habitait justement cette maison. Source : "Les années sombres". Claude Freyermuth 1994
Le 22 septembre 1942, vers 23 h, je suis tirée de mon sommeil avec toute ma famille par l’explosion de bombes larguées par un avion en détresse. Une première bombe au phosphore explose tout près et des centaines de fragments s’abattent sur notre maison, rue de la gare et sur les alentours. La grange et les étables sont immédiatement la proie des flammes. Autour de nous, tout brûle, les prés, au-delà de la route, à l’arrière de la maison, jusqu’au fond de la vallée où coule le ruisseau d’Achen, et même le coteau vers la forêt du Grosswald.
Une seconde bombe explose au lieu "Rohrbruch" et y creuse un cratère profond. Pour nous, c’est la panique lorsque nous apercevons que la maison flambe. Nous sautons du lit et ensemble cherchons à sortir du brasier, mais il y a des flammes partout. En pyjama et chemise de nuit, nous quittons la maison en passant par la cave et nous nous réfugions sur le coteau d’en face d’où nous subissons ce spectacle de désolation. Choqués, nous allons nous réfugier dans le bunker à côté de l’actuelle maison Bellott, rue des vergers, pour revenir par la suite à la "Welschmühl". Pendant ce temps, le corps local des sapeurs-pompiers arrive sur place et tente d’intervenir avec ses faibles moyens de l’époque. Certains pompiers rentrent dans l’habitation, tentent de sauver des meubles et d’autres effets en les jetant par la fenêtre. Or, comme les fragments de phosphore brûlent tout autour de la maison, tout ce qui passe par la fenêtre prend aussitôt feu.
Ce jour-là, Rémi Klein se distingue tout particulièrement par son courage puisqu’il grimpe sur le toit et scie la panne faîtière pour que la charpente des dépendances s’effondre, dans le but de préserver la maison d’habitation. Les vaches et les chevaux sont épargnés, mais les cochons, les poules et les lapins périssent dans l’incendie. Nous logerons dans la cave pendant tout l’hiver car la maison ne sera habitable qu’au printemps 1943, malgré la réfection du toit pour Noël.
…/...
Je me souviens aussi d’un après-midi de début août 43. Nous sommes affairés, mon père et moi, à charger une charrette de gerbes d’avoine au lieu-dit "Hüttingerberg", près de la forêt. Un avion de chasse américain se met soudain à nous mitrailler. Nous nous réfugions rapidement à la lisière du bois, derrière de gros arbres. L’avion revient à la charge à plusieurs reprises, mais sans nous atteindre. A la fin août 1943, un train de voyageurs est aussi attaqué sur la voie de chemin de fer entre Hutting et Oermingen. Là, non plus, pas de blessés, les voyageurs ont pu sortir du train et se mettre à l’abri derrière le ballast, changeant rapidement de côté à chaque nouveau piqué des avions.
J’ai aussi été témoin oculaire du bombardement de l’actuel centre de détention d’Oermingen, alors transformé en hôpital militaire allemand. Mon père,
ma sœur et moi, nous nous sommes plaqués au sol, dans un sillon, pour nous protéger.
…/…
Le 1er septembre 1944, depuis notre maison, j’ai observé les avions alliés lâcher des bombes sur Weidesheim. Ce sont essentiellement les étables, les écuries et les dépendances qui ont été atteintes et malgré l’immense nuage de poussière provoqué par les explosions, j’ai pu voir les poutres de la toiture projetées dans les airs. Les avions avaient en réalité raté leur cible puisque c’était un train chargé de matériel militaire qui était visé.
…/…
Dans la nuit du 3 au 4 décembre, les Allemands qui sont cantonnés dans notre maison, la quittent à pas feutrés et, au matin, il n’y a plus âme qui vive. Durant la journée du 4 décembre, les derniers groupes d’Allemands passent à pied, venant de Sarralbe. Parmi eux, un très jeune soldat s’adresse à mon père et s’enquiert de la distance jusqu’à Pirmasens, car, dit-il, «Je suis originaire de là-bas et si j’arrive à atteindre ma ville, je n’irai pas plus loin et je me cacherai.»
Dans la nuit du 4 au 5 décembre, les Américains déclenchent un tir de barrage sur le carrefour, mais les obus manquent leur cible et atterrissent derrière notre maison, en contrebas, vers le ruisseau. Ces tirs, à raison d’un obus toutes les deux minutes, chronométrés par mon père, durent pratiquement toute la nuit. Il n’y a heureusement ni dégâts, ni blessés.
Le 5 décembre, au crépuscule, un à un, quelques Américains arrivent par le coteau d’en face, venant d’Oermingen, et investissent notre demeure qui devient ainsi la première maison libérée du village. Notre famille est contrainte pour des raisons de sécurité de passer la nuit dans la casemate à côté de la maison. Nous y resterons aussi terrés le 6 décembre et grâce aux meurtrières, nous pourrons suivre l’attaque de Weidesheim.
…/…
Au moment de la contre-offensive allemande de janvier 1945, notre famille accueille dans la cave une trentaine de réfugiés de Bliesbruck, dont l’abbé Schoving. Ils y resteront trois mois…Pendant ce temps, des unités d’un régiment d’artillerie prennent position à Hutting (entre les maisons et le chemin de fer). Avec leurs canons à gros calibres, ils envoient des déluges d’obus sur les villages encore sous l’emprise allemande, tel Bliesbruck. »
Vers la fin de l’annexion
A partir de septembre 1944, les cours à l' "Oberschule" (enseignement secondaire ou supérieur) furent suspendus suite à l’avance des troupes du général Patton. Tous les Allemands fuirent. Profitant de leur départ, je fouinais dans tous les endroits où ils avaient séjourné et…trouvai un bel atlas. Imaginez ma joie ! Je pouvais suivre sur les cartes le retrait "planifié" des occupants, selon les indications recueillies par les personnes qui écoutaient la radio anglaise. J’annotai tout cela sur les cartes. Mais quelques jours plus tard, le no-mans-land revit le retour des Allemands.
Nous nous étions réjouis trop tôt !
Il me faut aussi relater un autre évènement survenu au lycée. A la rentrée 43, le directeur "Buna" me convoqua dans son bureau pour m’ordonner d’assister aux réunions de la Jeunesse Hitlérienne à Kalhausen, sous peine d’exclusion du lycée. Je dus obtempérer devant ce chantage. A la première réunion, le responsable cantonal (Scharführer) me désigna d’office chef cantonal des jeunes garçons de moins de 10 ans. Or, pour pouvoir exercer cette fonction, il me fallait acheter un uniforme. Malgré mes objections (manque d’argent, pas de ticket de vêtements), je dus encore me soumettre aux ordres et porter cet uniforme honni. Chaque semaine, je devais exercer ces jeunes à la marche au pas et leur donner une éducation sportive. Heureusement je fus sauvé de cette corvée par un fait incroyable : le responsable cantonal de la "HJ" (Hitlerjugend) fut, un soir, copieusement rossé par des "inconnus" et, la guerre prenant l’allure d’une défaite, on ne le revit plus jamais. L’uniforme me servit pourtant quelques semaines plus tard d’une façon prodigieuse.

(Photo internet)
Pour en revenir aux attaques aériennes, il faut aussi préciser que les mitraillages de trains de marchandises et de convois militaires par les avions de chasse américains étaient fréquents et qu’ils visaient aussi les locomotives des trains civils. Une telle attaque se produisit un jour à Hutting même. Les soldats du convoi militaire durent attendre plusieurs heures l’arrivée d’une autre locomotive venue de Sarreguemines, pour pouvoir poursuivre leur voyage (11).
__________________
11) Ces avions de chasse, appelés par les Allemands "Jabos", pour "Jagdbomber", étaient très certainement des "Republic P-47 Thunderbolt", munis de 4 mitrailleuses placées dans les ailes et alimentées chacune par une boîte de 350 cartouches.

(Photo internet)
Plus grave fut l’attaque aérienne que je vécus moi-même. C’était en août 44 et je séjournais alors chez mes grands-parents. Grand-père, ayant appris que les Américains avançaient et que les mitraillages de trains se multipliaient, me força à rentrer immédiatement à Hutting, où je serais plus en sécurité. Je pris donc le train en direction de Béning, via Hargarten. A l’arrivée à Béning, je remarquai le survol du train par des avions. «Ils ne vont quand même pas attaquer un train de voyageurs !», me dis-je intérieurement.
Quelques femmes, avec de grands paniers, s’installèrent dans le compartiment. Les avions passaient toujours plus bas. Le train démarra, mais n’alla pas bien loin. Soudain, ce fut l’arrêt. Un des avions nous survola en rase-mottes, mais sans lâcher de rafale. Il était urgent de quitter le train ! Les femmes, au lieu de se mettre immédiatement à l’abri, s’occupèrent à récupérer leurs paniers et perdirent un temps fou. J’étais coincé dans le compartiment. Déjà un second avion arrivait, mitrailleuses crépitant. Je m’allongeai rapidement sur le plancher, la tête sous la banquette et les mains par-dessus. Déjà les balles sifflaient ! Aussitôt la rafale terminée, je bondis hors du wagon et sautai dans le fossé bordant les rails, au milieu des ronces et des orties. Je rampai, malgré les griffures et les piqûres, pour m’éloigner du train.
L’attaque terminée, je me relevai et regardai alentour. Certaines personnes qui avaient pu se réfugier dans un petit bois tout proche, revinrent vers les wagons et tous les voyageurs se rassemblèrent dans un champ fraîchement moissonné. Soudain, j’entendis des gémissements sur ma gauche. J’avançai dans cette direction, vers des gerbes de blé disposées en moyettes et je découvris un spectacle horrible : deux garçons, âgés de dix à douze ans, gisaient là, l’un éventré par des balles et les entrailles sortant du ventre et l’autre, avec un bras quasi sectionné. Tout le monde afflua. Je ne sais pas comment les deux blessés furent secourus, ni par qui et ramenés chez leurs parents. J’allai ensuite récupérer ma valise dans le train qui avait été mitraillé de la locomotive jusqu’au dernier wagon. Il a fallu attendre l’arrivée d’une nouvelle locomotive pour pouvoir repartir. A mon retour à Hutting, je racontai à ma mère mon voyage mouvementé et elle poussa un grand soupir de soulagement.
Je vécus encore un autre bombardement en allant à Sarreguemines, toujours avec mon vieux "biclou". A 200 m du pont ferroviaire de Zetting enjambant la route, la Sarre et le canal, je vis surgir dans le ciel des avions. Je sautai rapidement du vélo pour m’aplatir dans le fossé heureusement à sec. Déjà les bombes tombaient autour du pont qui ne fut pas touché. J’étais encore une fois sain et sauf, mais que d’émotions !
Quelquefois, en me rendant à Sarreguemines, je rencontrais des camarades réquisitionnés pour creuser des tranchées le long de la Sarre, près de Zetting, on les appelait des "Schanzer". J’ai échappé à cette réquisition car je n’avais pas encore seize ans (12).
_______________
12) Il s’agissait de creuser des tranchées, des trous d'hommes et d'ériger des obstacles pour arrêter, sinon freiner l'avancée américaine. En fait, tous les hommes valides de 16 à 65 ans étaient astreints à ce service sous peine de sanctions disciplinaires.
L’affaire de la Waldhütte
Lien vers le dossier de l'A.H.K "Les insoumis de Hutting"
La sœur de mon beau-père Eugène se prénommait Eugénie Muller. Après le décès de son mari, elle était venue s’installer à Hutting, dans la maison de ses parents également décédés. Elle avait trois enfants, Bernard, Else et Lucien. Il se trouve qu’elle hébergeait, ou plutôt qu’elle cachait son fils Bernard, un voisin et son beau-frère, ainsi qu’un ami de son frère Eugène, Joseph Soulier. Trois d’entre eux étaient des réfractaires qui avaient refusé d’endosser l’uniforme allemand et le beau-frère du voisin était déserteur de l’armée allemande, ce qui était encore plus grave. Pendant la belle saison, ils se cachaient dans la forêt de Herbitzheim, au-delà de la rivière Eichel, près de la ferme de la "Waldhütte", dont le propriétaire sympathisait beaucoup avec eux.

Un jour d’octobre 44, j’apportai le repas de midi à mon beau-père qui travaillait au poste d’aiguillage près de la gare de Kalhausen. Eugène me dit alors d’aller prévenir sa sœur que l’affaire des cachés était découverte et qu’elle prenne les mesures nécessaires avant l’arrivée de la police ou de la Gestapo.

Eugénie et son fils Bernard.
- «Ne t’en fais pas, nous y arriverons.»
Personnellement, je n’étais pas du tout rassuré, car je savais que la "Feldgendarmerie" était depuis quelque temps au courant ou au moins se doutait de quelque chose. En effet, les gendarmes étaient déjà venus plusieurs fois enquêter à Hutting. La dernière fois, ils lui avaient dit, avant de partir :
-« La prochaine fois, Frau Müller, n’oubliez pas d’enlever le cendrier rempli de mégots, car sinon il ne sert à rien de répandre du lait sur la plaque chaude de la cuisinière.»
Je pense que les gendarmes faisaient leur boulot, mais sans trop insister, car ils devaient se rendre compte que la guerre était perdue pour eux et faire du zèle était inutile dans ce cas.
Le jour même, à la tombée de la nuit, alors que je cherchais un livre au grenier, j’entendis tout à coup une voix sèche commander :
-« Alle Männer raus !» (Tous les hommes dehors !)
N’ayant pas encore seize ans, je ne me considérais pas comme un adulte et je restais caché. La voix reprit, plus furieuse que jamais :
-« Da fehlt noch einer !» (Il en manque un !)
Ce ne pouvait être que moi et je descendis. Des hommes en uniforme se saisirent de mon beau-père, de mon frère Armand et de moi et nous emmenèrent vers la dernière maison du hameau. En cours de chemin, je pus constater que tout Hutting était encerclé de soldats, fusil en mains et prêts à tirer. Comme je l’avais craint, cela devenait sérieux.
Arrivés devant la cuisine, les soldats y firent entrer mon beau-père. Armand et moi, nous dûmes rester dehors, les bras en l’air et un fusil avec baïonnette braqué sur le ventre, chacun d’un côté de la porte qu’ils refermèrent. Après un moment de silence, nous entendîmes des aboiements rauques ainsi que des coups sourds suivis de gémissements. Ils étaient en train de procéder à un interrogatoire musclé. Je tressaillis. Aussitôt le garde en face de moi appuya un peu plus profondément avec la baïonnette contre mon ventre avec l’ordre de me tenir tranquille. Puis ce fut de nouveau le silence. Quelques minutes plus tard, on me fit entrer dans la cuisine : mon beau-père était allongé sur le sol, un bandage ensanglanté autour de la tête, presque inconscient. Puis les soldats firent aussi entrer mon frère Armand qui n’eut aucune réaction. Ils nous ordonnèrent alors de ramener notre beau-père à la maison en précisant qu’il serait arrêté le lendemain.
Pourquoi ne l’ont-ils pas arrêté tout de suite ? Ils recherchaient pourtant un employé des chemins de fer nommé Eugène. Mystère ! A moins qu’ils n’aient pas eu, en tant que militaires, le droit de procéder à une arrestation. Armand et moi, nous traînâmes notre beau-père à la maison et notre mère ne sut l’accueillir qu’avec des reproches sur son comportement. Avec notre aide, il alla se coucher. Au cours de la nuit, j’entendis un léger bruit : c’était mon beau-père qui se levait. Qu’allait-il faire ? Prendre la fuite ou bien se cacher pour ne pas être arrêté ? J’étais sûr qu’il allait entreprendre quelque chose.
Le lendemain matin, je questionnai ma mère, mais elle ne semblait pas savoir où était allé son mari. Elle me dit de revêtir l’uniforme de la "HJ" et d’aller déclarer la fuite de mon père aux gendarmes qui logeaient à Kalhausen. L’après-midi, je me proposai de garder les vaches de l’autre côté de la voie ferrée, tout en emportant quelques livres de classe. A un moment, j’entendis un ronflement de moteurs.
«Voilà qu’ils arrivent !», me dis-je.
Après quelques minutes d’attente, je grimpai à quatre pattes sur le talus du chemin de fer pour me retrouver…face à face avec un soldat allemand, qui faisait le guet, fusil en mains.
« Que viens-tu faire ici ? Comment t’appelles-tu ? Fous le camp !»
A l’annonce de mon nom, il me laissa partir, parce qu’ils ne recherchaient pas de Geisler. Je descendis du talus, et mes livres sous le bras, je repassai sous le pont du chemin de fer, abandonnant mes vaches, avec l’air innocent et insouciant de quelqu’un qui rentre tranquillement chez lui. Arrivé à hauteur de la maison d’Eugénie, je vis la camionnette et dedans, ma tante Eugénie avec sa fille et son fils, sa voisine, ma mère et une jeune femme russe réfugiée chez Eugénie (elle m’initiait au russe).
Tous me faisaient des signes désespérés de filer, mais je continuai tranquillement mon chemin tout en leur faisant des signes discrets d’au revoir.
Rentré à la maison vide de mes parents, je me mis à réfléchir. Que faire maintenant ? Il me fallait ressortir, aller dans la maison d’Eugénie, voir ce que je devais entreprendre... La camionnette était partie. Dans la maison voisine de celle d’Eugénie, vivait encore une vieille femme, la mère de la voisine et qui se déplaçait difficilement. Je devenais d’un coup responsable de mon frère et de ma sœur, responsable de la vieille femme, responsable des 5 vaches, de la basse-cour, de la porcherie, des lapins, etc…
Je commençai mon travail chez Eugénie, avant de continuer chez nous. Après avoir nourri poules et lapins, je commençai à préparer la pâtée pour les porcs. Soudain, un soldat allemand surgit :
«Mains en l’air ! Tu vas être immédiatement fusillé, tu as livré des munitions aux Partisanen ! Avance !»
Il me conduisit vers un officier qui réitéra l’accusation. Je rétorquai :
-« Où aurais-je pu me fournir en munitions ?
- Ce n’est pas la peine de nier, car toi et d’autres, vous avez pris des caissons de munitions, en 1940, après votre retour de l’évacuation.
- Les caissons, lui expliquai-je, nous ont servi à fabriquer de petites embarcations pour naviguer sur l’Eichel et ils s’y trouvent encore. Quant au contenu, nous l’avons laissé sur place.»
L’officier ordonna au soldat de m’accompagner au cours d’eau pour vérifier mes affirmations. Mais, comble de malchance, la "flotille" avait été entraînée par une forte crue, vu qu’elle n’était attachée à la rive qu’avec des ficelles. De colère, le soldat saisit son fusil par le canon et m’asséna un sacré coup du plat de la crosse dans la figure. Il me ramena, titubant et pleurant devant l’officier. Or, qui se trouvait aussi là ? Notre camarade d’aventures Raymond Herrgott, de 2 ans plus jeune que moi et qui affirmait encore détenir de ces caissons au grenier.
« Quel imbécile, me dis-je, pourquoi raconter tout cela, alors qu’il n’est nullement impliqué dans cette histoire?»
Et après vérification de ses dires, il fut arrêté et moi, relâché. Je me souvins alors des deux parachutes et des paroles de la jeune femme russe qui me parlait de Résistance. Y avait-il effectivement un groupe de résistants dans le coin ? Décidément cette affaire prenait un tour sérieux.
Je me remis au travail dans la maison d’Eugénie, en pensant au sort qui attendait les réfractaires et le déserteur.
Je fus de nouveau interrompu par l’arrivée d’autres soldats encadrant le propriétaire de la "Waldhütte", les mains en l’air, torse nu et le dos largement zébré de coups de fouet. Effectivement, j’appris plus tard qu’il avait été attaché à un arbre et fouetté pour lui arracher des aveux. Lui et moi, nous fûmes alors conduits dans l’étable vide. L’homme déclara que tout ce qu’il savait, c’était que la cachette était aménagée sous la mangeoire, en-dessous du râtelier. Le chef du commando m’ordonna de m’accroupir et d’enlever la paille et le foin qui jonchaient le sol. Je commençai le déblaiement sans savoir ce qui allait se passer. Les insoumis étaient-ils encore là ou avaient-ils pu fuir à temps ?
Les soldats formaient un cercle autour de moi, devenu leur otage, le fusil pointé vers la cache. Tout à coup, je mis à découvert un fil de fer, mais le chef du commando l’avait aussi vu et il m’ordonna de suivre le fil pour voir où il aboutirait. Le fil me conduisit vers une pierre munie d’un anneau et que je dus soulever. Je savais que les insoumis disposaient de fusils et d’autres armes. Ma dernière heure semblait venue. Me plaçant de côté, je soulevai lentement la pierre et découvris la cache. Rien ne se produisit. Un trou noir béait et le chef m’ordonna de descendre dans le trou. J’atterris dans une dizaine de centimètres d’eau. L’officier me passa une lampe-torche pour balayer toute la cache de son rayon de lumière. Il n’y avait absolument rien dedans à part cette eau qui s’y était infiltrée. Les résistants avaient eu le temps de s’enfuir en emportant leur armement. Que se serait-il passé, si on les avait découverts là-dedans. Je n’ose y penser. Il y aurait certainement eu une fusillade et des morts. Que serait-il advenu de moi, puisque j’étais en première ligne ?
Quand je voulus ressortir du trou, un soldat se vengea sur moi, en m’écrasant les doigts avec ses bottes. Je n’insistai pas et attendis leur départ pour sortir. Les Allemands repartaient donc avec un seul prisonnier, déçus et furieux d’avoir fait chou blanc. C’était une petite victoire pour nous.
Je terminai mon travail chez Eugénie, puis rentrai à la maison pour continuer. Armand et Yvette avaient ramené les vaches dans l’étable. Je leur expliquai la situation. Nous devions traire les vaches. L’une d’elles avait un sale caractère et se montrait souvent rebelle pendant la traite. Je liai une corde autour de la cheville droite de cette vache et demandai à mon frère et à ma sœur de tenir fermement la corde pour que la vache ne puisse pas donner de coup de pied dans le seau, pendant que je la trayais. Tout se passa bien au début, mais vers la fin, elle décocha un violent coup de pied dans le seau rempli aux trois quarts et la catastrophe ne put être évitée. Je valsai au sol, le seau de lait se renversa sur moi et les deux autres se retrouvèrent aussi au sol, sur la paille souillée. Nous étions bons pour une bonne toilette et un changement d’habits. Après ces émois, je me rendis encore chez la vieille femme, mais elle déclina gentiment mon aide.
Pour ce soir, j’avais réalisé tous les travaux courants. Mais nous étions orphelins de père et de mère, bien seuls dans cette grande maison et il fallait encore s’occuper d’une autre exploitation, celle de tante Eugénie. Je racontai en détail tous les évènements de la journée à Yvette et à Armand. Nous nous voyions mal continuer tout seuls le travail des champs qui restait à faire. Pour la nourriture, il n’y aurait pas de problème, car nous disposions d’un potager, d’un verger, d’œufs et de viande de lapin… A nous trois, nous pourrions nous débrouiller. J’avoue que je ne dormis guère cette nuit-là.
Le lendemain matin, mon camarade Raymond, relâché par la Gestapo, vint nous annoncer une bonne nouvelle : mère reviendrait encore dans la soirée. Et ce fut vrai. Quel soulagement ! Nous étions sauvés ! Elle nous raconta à quelle condition elle fut relâchée : elle avait juré de livrer son mari s’il revenait au foyer. Je fus abasourdi par cette nouvelle et lui fis savoir que c’était honteux de sa part. L’aurait-elle vraiment fait ou était-ce simplement un stratagème pour recouvrer sa liberté ? Elle ne trahira heureusement pas son mari et je suis fier de sa conduite. La vie pouvait désormais reprendre son cours dans notre maison, mais un être nous manquait, beau-père Eugène.
Le soir du retour de notre mère, Bernard, le fils réfractaire de tante Eugénie, arriva chez nous, à moitié trempé et nous raconta l’odyssée des insoumis recherchés par les autorités allemandes.
Dès que j’avais, sur l’ordre de mon beau-père, averti Eugénie de la découverte de la fameuse lettre, Bernard avait revêtu un uniforme allemand (certainement celui du voisin déserteur), pris un fusil et "conduit" ses camarades réfractaires, comme des prisonniers dans la forêt du "Schlosswald".
Ils attendirent la nuit pour se réfugier à la "Waldhütte". On n’y voyait pas à trois mètres à cause du brouillard et la maison avait été investie par les Allemands. Le petit groupe tomba malheureusement dans la souricière. Une fusillade éclata et fit un tué chez les soldats allemands, ainsi qu’un blessé grave. Bernard Muller, le déserteur armé, fut capturé, traduit en justice, condamné à mort et interné à la prison de Colmar. Mais il eut une chance inouïe : lorsque la 2° DB de Leclerc perça en Alsace pour libérer Strasbourg, il fut transféré en hâte dans le camp de concentration de Dachau. Son dossier par contre ne fut pas transféré et les autorités du camp ignoraient donc la raison de sa présence. Il eut ainsi la vie sauve. Il y côtoya le propriétaire de la "Waldhütte" qui y laissa sa vie, miné par les remords pour avoir dénoncé (sous la torture) ses amis et aussi par les mauvais traitements subis et le manque de nourriture.
Une nuit, mon beau-père revint à la maison, après avoir été poursuivi jusqu’à Hutting par des soldats allemands qui heureusement s’empêtrèrent dans des clôtures barbelées qui entouraient un parc à bestiaux. La porte de la cave n’était jamais fermée à clé pour qu’il puisse rentrer. Ma mère me confirma son retour, mais me recommanda de ne rien en dire à personne, même pas à mon frère, ni à ma sœur, ce que j’aurais fait de toute façon. Je savais ce que nous risquions, si les Allemands l’apprenaient et surtout le retrouvaient. J’étais sur mes gardes, car un agent de la Gestapo, perché dans un arbre, surveillait pendant la nuit l’entrée de la maison. Je l’avais repéré, mais n’en dis mot à ma mère, pour ne pas aggraver la tension dans laquelle elle vivait.
Tous les jours, j’apportai de la nourriture à mon beau-père, dans sa cachette située sous l’escalier menant à l’étage. J’emmenais toujours mon fidèle berger allemand, très intelligent et que j’avais bien dressé, pour le cas où…Je l’avais baptisé Rizza.
Pour en revenir à l’agent de la Gestapo qui surveillait la maison, celui-ci avait pris l’habitude de souper assez souvent chez nous, vu que ma mère s’était engagée de livrer son mari à son retour. Cet homme, très affable et cultivé, parlait couramment le français et l’anglais. De plus, il s’y connaissait aussi en latin.
Un jour, après que tout le monde se fut couché, j’appelai doucement mon beau-père pour lui signifier que la voie était libre et qu’il pouvait sortir de sa cachette pour souper. Les volets étaient bien fermés, mais malgré cela, j’avais toujours peur que l’agent de la Gestapo puisse grimper sur une échelle et jeter un coup d’œil dans la cuisine ou bien nous entendre discuter.
Or, mon beau-père avait cultivé du tabac en raison du rationnement très strict des cigarettes. Et comme il fumait parfois, les feuilles de tabac suspendues à un fil dans l’appentis en vue de leur séchage, diminuaient en quantité. Un jour, je lui fis part du danger que nous courions pendant qu’il soupait. Il me proposa alors d’avoir toujours une tabatière dans la poche, ainsi que du papier à cigarettes et des allumettes. Il me demanda aussi de m’exercer à rouler des cigarettes. Ce que je fis. Effectivement, l’agent de la Gestapo avait remarqué que le nombre de feuilles diminuait. Il apparut un jour dans l’appentis, alors que je réparais un outil et me fit une remarque sur les feuilles de tabac.
« Ce sont probablement des Russes évadés de Sarralbe et je fume aussi parfois.», fut mon explication. Aussitôt, il me demanda de rouler une cigarette avec ce tabac et de la fumer, puis une seconde. Je toussais pas mal, mais je tins bon, affirmant que c’était bon. C’était sa première attaque insidieuse.
Un autre jour, mon beau-père nous demanda, à moi et à mon frère, d’aller ensemencer un champ avec du blé. Alors que nous avions presque terminé, un type, vêtu d’un bleu de travail et un bonnet bien enfoncé sur la tête, nous accosta :
-« Comme vous êtes courageux au travail ! Où est donc votre père ?
- A la guerre, sur le front russe, lui répondis-je, reconnaissant soudain l’agent de la Gestapo.
- Quelle est la superficie de votre champ et combien de semence te faut-il ?
Je lui donnai les renseignements demandés. Il rajouta :
- Comment se fait-il que tu saches tout cela ?
- Je me suis renseigné auprès d’autres paysans.»
Il nous quitta alors après m’avoir longuement dévisagé, certainement déçu de ne pas avoir pu me prendre en défaut.
« Ouf, dis-je à Armand, on l’a échappé belle !»
Mais comme mon frère ignorait tout de la présence de notre beau-père à la maison, il ne comprit pas le sens de mes paroles.
Fin novembre, l’agent de la Gestapo essaya encore une dernière fois de me soutirer l’emplacement de la cachette d’Eugène. Nous étions seuls dans la cuisine et cette fois, il utilisa d’autres moyens.
« Si tu me dis où est caché ton "Stiefvater", alors je te donnerai 10 000 marks.»
J’étais tellement furieux contre ces manières que le lui rétorquai aussi sec :
« Même pas pour dix fois plus, je ne le dénoncerai jamais et de toute façon, je ne sais pas où il est.»
A partir de ce jour, je ne le revis plus jamais. Les autorités allemandes ne purent rien tirer de moi, ni de ma famille. Mais si elles étaient venues, à l’improviste, perquisitionner dans la maison, en plus avec des chiens policiers, ils auraient tôt fait de découvrir la cache. Dans ce cas, toute la famille aurait dû payer et nous aurions aussi été internés, au moins les adultes.
L’affaire de la "Waldhütte" trouva ainsi son dénouement. Mais ce n’est qu’à mon retour de l’hôpital de Nancy que j’appris comment cette histoire s’était terminée : toutes les personnes arrêtées revinrent saines et sauves dans leur foyer après la Libération, sauf le propriétaire de la "Waldhütte" décédé
dans le camp de concentration de Dachau.
Les émois de la Libération
Début décembre, des troupes allemandes prirent leurs quartiers dans les maisons de Hutting. Apporter de la nourriture à mon beau-père devint alors plus périlleux, mais j’y parvins toujours.
Une nuit, vers trois heures du matin, par un temps glacial, j’entendis des coups frappés contre la porte d’entrée de la maison et des ordres hurlés. Ma mère refusa de se lever et d’aller ouvrir. C’est donc moi qui descendis l’escalier pour ouvrir la porte à des soldats, furieux d’avoir dû attendre longtemps dans le froid.
Ils s’installèrent dans la cuisine, autour de la table et y étalèrent une carte qu’ils se mirent à étudier. J’étais debout de l’autre côté et je pouvais observer et…comprendre ce qu’ils disaient. Ce devait être les officiers d’une unité d’artillerie, car leurs objectifs, d’après ce que j’avais compris, étaient les ponts sur la Sarre et l’Albe, précisément à Sarralbe. Leur discussion dura jusqu’à l’aube. Quand ils me virent toujours debout dans un coin de la cuisine, leur chef m’ordonna de décamper. Je lui répondis que j’aimerais bien prendre mon petit-déjeuner maintenant, vu qu’il en était l’heure. Contre toute attente, ils plièrent bagages et déménagèrent dans la maison d’un célibataire où la place ne manquait pas et où ils seraient moins dérangés (12).
________________
12) Il doit s’agir de la maison de Marcien Léon Edouard Stamm (1904-1976), située un peu plus bas, de l’autre côté de la rue.
Quelques heures plus tard, une unité de défense aérienne arriva encore à Hutting. Elle s’installa dans les prés, dans une cuvette, entre la voie ferrée et le chemin menant à la gare. Leur chef était un haut gradé portant de nombreuses décorations (croix de fer avec feuilles de chêne et pierres précieuses). Il piqua plusieurs crises de colère à cause de nous, les jeunes, qui traînions toujours dans les parages. Le campement allemand fut un jour survolé par des chasseurs américains qui le mitraillèrent. Nous pouvions suivre dans le ciel les balles traçantes tirées contre les avions par les mitrailleuses allemandes à 4 canons ou les nuages de fumée noire dus à l’éclatement des obus de la Flack. Tout cela se passait très vite car les avions surgissaient à l’improviste au-dessus des Allemands et la riposte allemande n’était pas toujours efficace, les obus éclatant souvent loin des avions. Nous ne nous privions pas de critiquer les ratés allemands et de nous moquer d’eux. Comme nous étions assez près, le haut gradé surprit nos remarques et il nous adressa des menaces, mais nous prîmes rapidement la poudre d’escampette.
Le gradé possédait une voiture amphibie "Schwimmwagen" et il la garait dans la grange des voisins arrêtés par la Gestapo (13). Un jour, nous découvrîmes ses jumelles sur un des sièges. Raymond voulut se les approprier, mais je l’en empêchai par peur d’avoir encore des histoires. Mais il
le fit quand même plus tard. Le gradé ne manqua pas de piquer une colère et menaça de faire fusiller le coupable, s’il le trouvait.
_______________
13) Ce véhicule fut produit à partir de 1940 sur une base de Coccinelle. Il pouvait transporter 4 personnes et servait de véhicule de liaison, de reconnaissance ou d’évacuation de blessés.

(Photo internet)
Raymond commit encore un autre forfait : il coupa, à deux reprises, un fil téléphonique qui permettait les relations entre l’unité installée à Hutting et les autres forces allemandes. Je menaçai alors de le dénoncer aux Allemands, s’il continuait. De toute façon, je ne l’aurai jamais fait. Je voulais simplement freiner ses ardeurs, car nous étions déjà assez en danger comme cela.
Dans notre grange bivouaquaient des soldats. J’avais sympathisé avec l’un d’eux et il me faisait part de son découragement dans cette guerre. Son unité possédait un avant-poste entre Sarralbe et Keskastel. Un jour, je le vis, les larmes aux yeux : il devait prendre son service dans cet avant-poste. Or, tous ses camarades qui y avaient été envoyés, n’en étaient pas revenus. Ce Berlinois, que j’aimais bien, non plus, n’en revint pas et je l’avoue, j’eus les larmes aux yeux lorsque j’appris la mauvaise nouvelle.
Les artilleurs avaient installé trois canons dans notre pré, sous les pommiers et ils tiraient trois fois par jour quelques obus en direction de Sarralbe.
Ils quittèrent Hutting le 4 décembre, mais l’unité de la Flak, commandée par le haut gradé aux multiples décorations, voulut encore rester pour résister plus longtemps. Il dut pourtant aussi battre en retraite le lendemain devant l’arrivée imminente des Américains.
Après le départ des Allemands, beau-père Eugène put sortir de sa cachette pour se promener librement dans la maison. Par prudence, il ne sortait pas encore dans le jardin ou dans le hameau. Quant à nous, nous allions fureter dans notre pré maintenant vide des artilleurs, dans l’espoir de trouver quelques objets abandonnés. Soudain un soldat SS surgit de la haie qui bordait le pré sur un côté. A sa vue, nous fûmes pris de frayeur. Mais déjà il cria :
« N’ayez pas peur, je ne vous veux pas de mal, donnez-moi, s’il vous plaît, quelque chose à manger et à boire.»
En le dévisageant de plus près, je me rendis compte qu’il ne pouvait guère être plus âgé que moi et j’eus pitié de lui. Je l’accompagnai à la maison et ma mère lui donna du pain et du fromage blanc. Il mangea d’un appétit féroce, but de l’eau et demanda l’autorisation d’emporter le reste de la miche de pain. Pendant qu’il mangeait, il nous raconta son odyssée : près de Voellerdingen, son groupe anti-chars avait été attaqué par des chars américains. Les pauvres soldats allemands ne disposaient que de bazookas. Pour pouvoir s’en servir, ils creusaient un trou et se cachaient dedans. Or, lorsque les tankistes américains repéraient une telle position de tir, ils manoeuvraient de façon à écraser avec les chenilles celui qui s’y trouvait. Quelle horreur ! Avant de partir, il dit avoir été versé d’office dans la "SS" (Schutzstaffel) et nous demanda la direction de l’Allemagne. Il nous remercia du fond du cœur pour notre accueil et partit…Ce fut le dernier Allemand que je vis.
La journée du 5 décembre fut calme après le départ de tous les Allemands. Seul, un avion de reconnaissance américain, un "coucou" survolait parfois Hutting pour s’assurer de leur départ. On ne voyait plus personne dans le hameau et alentour. On entendait pourtant tonner des canons, au loin, en direction d’Oermingen. Dans la nuit du 5 au 6, les grondements se rapprochèrent et des obus tombèrent autour de Hutting. Nous avions l’habitude depuis plusieurs jours de nous abriter dans notre cave. Malheureusement le sous-sol de la maison n’était pas enterré, ni à l’arrière, ni sur le côté gauche et nous n’étions donc pas en sécurité dans la maison.
Un obus venait juste d’éclater sur le tas de fumier, à côté de la maison. Beau-père Eugène jugea alors plus prudent d’abandonner la maison et de se réfugier, avec nous tous, à 500 m de là, dans la casemate la plus proche et qui se trouvait dans le triangle formé par les voies de chemin de fer, "de Drèiéck", vers la gare. A peine arrivés dans le bunker, les obus pleuvèrent tout autour. Nous n’étions pas en sécurité là non plus, et lors d’une accalmie, beau-père Eugène décida de regagner Hutting et de se réfugier dans la cave voûtée de la maison Nicolas Kirch. Nous passâmes toute la nuit dans l’angoisse.
(Cliquez sur la carte pour l'agrandir)
Le triangle formé par les voies de chemin de fer est bien visible à gauche sur la carte.

Ce blockhaus était conçu pour des armes d’infanterie,
une mitrailleuse Hotchkiss et un fusil mitrailleur. Il était muni d’un périscope.
(Photo wikimaginot)
A l’aube, tout était redevenu calme et nous regagnâmes notre cave pour nous endormir profondément sur le tas de pommes de terre et de betteraves. Vers 8 heures, Eugène nous réveilla en hurlant :
«Les Américains sont là !» (14)
_____________
14) Il s’agit d’éléments du 1er bataillon du 104° Régiment d’Infanterie appartenant à la 26° Division d’Infanterie. Source : Kalhausen à l’heure américaine Bernard Zins www.kalhausen.com
Nous étions enfin libérés ! Grande était notre joie ! La période d’octobre à décembre 44, pendant laquelle les Américains se rapprochaient et bombardaient constamment la région avait été une période dure et nous avions vécu souvent dans la peur, réfugiés dans la cave.
Nos libérateurs arrivaient d’Oermingen par le chemin qui longeait la voie ferrée. Nous allâmes à leur rencontre. Ils étaient une trentaine, certains avaient la mine patibulaire (j’appris plus tard que certains "GI" étaient des condamnés de droit commun qui s’étaient engagés dans l’Armée pour ne pas purger leur peine). A notre vue, ils s’arrêtèrent, méfiants, le doigt sur la détente.
Ils ignoraient qu’ils se trouvaient en face de Français et non d’Allemands. Je leur expliquai, avec le peu d’anglais que je savais, que les Allemands s’étaient repliés. Le responsable du groupe nous demanda de les accompagner. Je transmis cette proposition à mon beau-père qui accepta. Même pas cent mètres plus loin, des obus tombèrent autour de nous. Immédiatement, nous fîmes demi-tour, en direction du hameau, dans l’intention de nous abriter. Je courais en tête, suivi par Armand. Soudain, je tombai à terre, après un violent choc à l’épaule. Armand cria, son coude saignait. Je me relevai et continuai de courir vers la maison, suivi par Armand et notre beau-père. En cours de route, je sentis quelque chose de chaud qui coulait sur ma poitrine. Le blouson étant entrouvert, je vis une tache rouge qui auréolait mon pull : c’était du sang ! Moi aussi, j’étais donc blessé. Et il fallait que cela nous tombe dessus le jour de notre libération !
En arrivant à la maison, je dis à ma mère :
«Prends les pansements oubliés par les Allemands et que j’ai rangés dans un tiroir.»
Elle m’enleva le pull et la chemise. Déjà le moindre mouvement me faisait souffrir. J’avais une blessure à l’épaule. D’un trou de la grosseur de mon petit doigt, coulait du sang et, pendant que notre mère pansait nos plaies à tous les deux, Eugène partait à Oermingen chercher du secours. J’allai me coucher sur mon lit, grelottant et tremblant de douleur. Deux infirmiers américains arrivèrent et nous embarquèrent dans une Jeep pour nous conduire par le chemin de terre qui longe la voie ferrée, le chemin de la Libération, mais aussi le chemin de la souffrance, vers Oermingen. Nous étions cahotés, secoués et j’avais terriblement mal. En cours de route, ils s’arrêtèrent pour charger, tel un sac de patates, un soldat probablement mort et le jetèrent tout bonnement à nos pieds. Après ce martyre qui avait semblé durer une éternité, nous arrivâmes devant une grande maison, en face de l’église. Un infirmier me proposa une cigarette que je refusai. Il me fit une piqûre de morphine et renouvela mon pansement. De là, nous fûmes transportés au pensionnat de Fénétrange transformé en centre de tri de blessés. Mes douleurs s’étaient calmées suite à l’injection.
Les blessés, civils ou militaires, étaient, soit assis, soit couchés sur des brancards, dans une grande salle du pensionnat. Des médecins militaires, des infirmiers et des infirmières s’affairaient autour d’eux et décidaient de leur évacuation vers l’arrière ou de leur renvoi à domicile. Après une autre injection, je fus transféré avec mon frère Armand dans une seconde ambulance qui nous emmena en direction de Dieuze. Je n’avais aucun mal à reconnaître le tracé rectiligne de la route après Fénétrange. Nous fûmes hébergés dans une caserne à Dieuze et c’est là que je perdis la trace de mon frère.
Je commençai à divaguer et fus emmené dans une petite pièce où attendaient une douzaine de blessés. Je grelottais et avais terriblement soif. Profitant d’un instant d’inattention du personnel, je m’éclipsai vers le couloir où j’avais remarqué la présence de robinets. Au moment où je me penchai vers l’un d’eux pour étancher ma soif, je fus agrippé au cou par un infirmier militaire qui m’apostropha d’une voix forte : «No drink, forbidden !» (ne pas boire, c’est interdit) et il me ramena dans la pièce où je perdis connaissance.
Lorsque je me réveillai, j’étais couché dans un lit, toujours assoiffé. Une lumière blafarde brillait au plafond. Je me rendis compte que j’étais tout nu. On avait découpé mes vêtements aux ciseaux, comme je l’appris plus tard. Quelle heure était-il ?
Soudain je perçus des gémissements et des appels en dialecte. Je me tournai doucement vers ma gauche et je vis, couché sur une civière à côté de mon lit, en contrebas, un homme, d’après sa voix, qui avait la tête complètement bandée. Seuls, émergeaient le nez et la bouche.
Je lui expliquai en dialecte que son désir de boire ne serait pas satisfait. A ce moment, je sentis une bonne odeur de café et j’en déduisis que c’était l’heure du petit-déjeuner (on était le 7 décembre). Effectivement, le personnel servait le repas aux autres blessés. Je n’avais rien mangé depuis 24 heures et je commençai à avoir faim. Je demandai alors aussi un "breakfast" (petit déjeuner) pour chacun de nous deux. Je mis mon voisin au courant de ma commande et il se calma. Il fut servi le premier, mais il n’eut pas droit à du café, ni à du thé, à aucune boisson, par contre on lui servit un bol de bouillie bien épaisse qu’on le força à avaler. Il recrachait ce qu’on lui ingérait de force dans la bouche. Quant à moi, je ne fus pas mieux servi. J’avalai avec peine trois ou quatre cuillerées, ce fut tout. Quand on desservit, je réclamai à boire, mais la réponse fut : «No! »
Peine perdue, je dus continuer à endurer la soif. J’étais donc là, me demandant sans cesse où pouvait bien être mon frère. Je fis part de mon tourment à un infirmier, mais déjà on m’embarquait dans une ambulance. Un autre blessé fut allongé à côté de moi. En tournant légèrement la tête, je reconnus mon frère Armand. Comme j’étais content de le retrouver ! Je lui demandai aussitôt s’il savait où on allait nous transporter, mais il l’ignorait également. Alors une voix féminine nous répondit : «Nancy». Immédiatement je pensai à tante Gabrielle qui habitait cette ville depuis l’évacuation à Aulny des services de la Préfecture en 1940. J’en fis part à mon frère.
« Si c’est vrai, nous reverrons tante Gabrielle et nounou Emile.», me répondit-il.
Et c’est ainsi que commença la seconde période française de notre vie.
La seconde période française
La période d’hospitalisation
Effectivement nous atterrîmes à l’Hôpital Central de Nancy. Des médecins et des infirmières s’affairaient autour des blessés. Soudain une infirmière souleva ma couverture et s’écria :
- « Mais vous êtes tout nu !
- Oui, madame, aussi nu qu’un ver de terre ! Les Américains ont dû découper mes vêtements en raison des douleurs au moindre mouvement. Je ne possède plus rien. »
Elle était très étonnée de mon bon français. Un jour, je me sentis mal à cause de la douleur et je m’évanouis. On me transporta inconscient, dans une grande salle. Quand je repris mes esprits, j’avais tellement chaud que je voulus me lever de mon lit de camp. Je me souviens seulement m’être laissé glisser sur le bord en serrant les dents et, dans un effort surhumain, malgré la douleur, m’être levé. Puis, ce fut de nouveau la nuit totale.
Lorsque je repris conscience, j’étais attaché au lit, mourant de soif, grelottant de fièvre, n’arrivant plus à rassembler mes pensées et je retombai dans le néant. Je me réveillai dans " l’antichambre de la mort", c’est-à-dire un coin isolé de la grande salle par une paroi en bois munie de vitres translucides. Une sœur religieuse de forte corpulence s’affairait autour de moi. J’avais été opéré !
Elle me demanda si je souffrais.
« Non, ça va ! Mais, s’il vous plaît, pourriez-vous retrouver mon frère et prévenir notre tante ? »
Je lui donnai son adresse. Etonnée de ma bonne élocution, elle s’enquit de la façon dont je fus blessé et m’apprit que je devais repasser sur la table d’opération le lendemain matin, le professeur Barthélémy n’ayant pas réussi à extraire l’éclat d’obus coincé dans l’articulation de l’humérus. Elle me promit d’aller prévenir ma tante et de rechercher mon frère Armand.
Le lendemain matin, je repassai donc sur le billard. Je fus endormi, mais me réveillai avant que le professeur ait terminé. Il était entouré d’un assistant et de plusieurs jeunes étudiants en médecine qui écoutaient attentivement les explications du "patron". Assis, je regardai le sang répandu autour de moi, puis la plaie. Le professeur me déconseilla cette vue, mais je lui répondis que j’avais l’habitude de la vue du sang. Il me montra ensuite l’éclat d’obus qui était resté trois jours dans l’articulation. Puis, on me lava, pansa la plaie et mit un grand plâtre autour du bras et du thorax. Je retournai dans mon lit de camp, au fond de la grande salle. C’était un dimanche.
Vers 14 heures 30, Armand arriva, tout heureux de me retrouver et une demi-heure plus tard, ce fut tante Gabrielle. Elle me posa une foule de questions sur les circonstances de mon accident, sur la famille. Malheureusement, elle et Armand ne purent pas rester longtemps auprès de moi, car, fatigué, je sombrai doucement dans le sommeil, rassuré par les retrouvailles, après cinq années de séparation.
J’étais très fatigué et ne tenais plus sur mes jambes. Pourtant, il le fallait car l’interne de service chargé de ma personne dut faire des découpes dans le plâtre, sur l’avant et sur l’arrière, en vue de soigner les deux plaies importantes qui suppuraient fortement. L’éclat d’obus avait quand même une largeur de plus de 1,5 cm pour une longueur de 4 à 5 cm, ses arêtes étaient irrégulières et tranchantes. S’il m’avait frappé de son long, j’aurais eu le bras à moitié sectionné.
Tante Gabrielle m’apportait de temps en temps une bouteille Thermos peine de pot-au-feu très appétissant. Grâce à elle, je fus sauvé, car avec ce que nous avions à manger, je ne me serais jamais rétabli. Le tétanos et surtout la gangrène gazeuse faisaient des ravages. J’eus à plusieurs reprises des injections massives de produits antitétaniques. Contre la gangrène, ce fut un combat sérieux de la part du professeur et il eut beaucoup de soucis avec moi. Lors de ses visites, il s’attardait toujours autour de mon lit, entouré de ses "élèves". Il "baragouinait" toujours je ne sais quoi à mon sujet. Un jour, avant midi, la sœur infirmière passa pour une piqûre dans la cuisse à tous les blessés. Je fus le premier à être servi et elle termina la rangée de droite. Après déjeuner, elle devait repasser pour l’autre rangée. Soudain, j’eus l’impression que j’avais le corps en feu. Tous les "piqués" se mirent bientôt à gémir. Ce supplice dura environ une heure. Les autres se moquaient de nous. Mais bientôt ce fut leur tour d’être piqué et peu après ils se mirent eux aussi à se lamenter. Nous eûmes alors beau jeu de nous moquer d’eux, comme ils l’avaient fait auparavant pour nous. Nous n’avons par contre jamais pu savoir quel était ce médicament "bon pour tous les blessés".
Quelques explications sont ici nécessaires. Le tétanos est une affection d’origine infectieuse qui provoque des contractions musculaires douloureuses dans tout le corps et peut aboutir à la mort. On peut le combattre avec du sérum antitétanique, ce qui fut fait chez moi.
La gangrène est une redoutable complication des plaies profondes souillées par de la terre. Les toxines produisent des gaz à odeur putrescente. La douleur est intense, la fièvre élevée et la maladie affaiblit beaucoup. Si la gangrène est localisée dans un membre, le malade est amputé, car il n’existe pas de chance de guérison.
Chez moi, on ne pouvait heureusement pas envisager une amputation, puisque la blessure se situait en partie sur le thorax. Le professeur utilisa alors les découpes faites dans le plâtre pour pratiquer deux incisions à l’aide d’un stylet chauffé à blanc, une sur le bras et l’autre à la pointe de l’omoplate. Ces incisions servaient à injecter au moyen d’une seringue sans aiguille un produit brûlant comme du feu et qui m’aurait fait sauter au plafond, si quelques étudiants présents ne m’avaient fermement maintenu sur la chaise. Je supportais tout sans gémir et le professeur me félicita pour mon courage et mon endurance à la douleur. Ces séances de "tortures" se répétaient deux à trois fois par semaine pendant trois à quatre mois. Et je fus sauvé !
Un jour, l’interne, que les plus anciens de la chambrée appelaient "Coco", vint me chercher pour enlever le plâtre. Quel soulagement ! C’était comme si on m’avait déchargé d’une tonne ! Puis il me demanda de bouger les doigts, mais ils refusèrent tout mouvement. Etais-je paralysé suite à la section d’un
nerf ? Je ne me donnais plus de chance de pouvoir utiliser mon bras droit et mon moral sombra brusquement. Alors "Coco" commença à plier mes doigts, à les déplier. Puis ce fut au tour de la main, de l’avant-bras et du bras. Il forçait sur les articulations et je souffrais le martyre, mais aucune plainte ne sortit de ma bouche. La douleur me fit de nouveau perdre conscience. Heureusement, une infirmière se tenait derrière moi et elle me retint.
On me coucha sur une civière et on me ramena dans une autre chambre. Le lendemain matin, le professeur, en présence de ses acolytes, me demanda ce qui s’était passé la veille. Je n’osai pas lui dire que j’avais été "martyrisé", mais mes camarades de chambrée lui expliquèrent tout, disant que la séance de manipulations avait duré plus d’une heure. Le grand chef jeta un regard plein de colère sur "Coco" et s’écria : « Dehors, et que je ne vous voie plus jamais ici ! »
J’étais soulagé et à partir de ce jour, ce fut une étudiante qui s’occupa de mon cas et de celui du garçon couché à ma droite. Lui aussi avait eu à souffrir des maltraitances de "Coco". Sa blessure se trouvait à l’entrejambe. Là encore, pour accéder à la plaie, il avait pratiqué une ouverture dans le plâtre, mais avait malencontreusement entaillé un des testicules, ce qui avait fait atrocement souffrir le blessé. Il ne parlait pas le français et réclamait la présence de sa mère qui avait également été blessée. J’en parlai à la sœur à qui je rendais souvent service en enroulant les bandes de pansement après usage. Un jour, elle me chargea de préparer le jeune à la rencontre avec sa mère qui avait été amputée de la jambe. Je le fis avec beaucoup de prudence et de tact et quand je jugeai que le garçon était prêt, j’en avisai la sœur.
La mère arriva après le déjeuner, sur ses béquilles. Son fils dormait et elle attendit patiemment son réveil, assise sur une chaise apportée par la sœur, tout en faisant la causette avec moi en dialecte. Au réveil du jeune, quelle joie sur son visage ! Il faut avoir vécu de telles retrouvailles pour comprendre l’amour d’une mère pour son enfant et l’inverse. A partir de ce jour, la santé du blessé s’améliora sensiblement et il nous quitta rapidement.
Sa place fut occupée par un jeune homme âgé de 20 à 25 ans, étendu sur une civière posée à même le sol. Je l’entendais pleurer en se cachant le visage. Il ne parlait pas et ne semblait pas être blessé, ni malade. Des Américains se pointèrent pour lui faire subir un interrogatoire. Je dus faire l’interprète et ils partirent après avoir vérifié son identité. Quelques heures plus tard, deux policiers français leur succédèrent. Le jeune homme en pleurs fut arrêté et emmené. Il m’avait avoué être un collaborateur et s’attendait à être fusillé. Décidément la guerre présentait beaucoup de mauvaises facettes, mais j’avais quand même pitié de lui.
Un des blessés, au bout de ma rangée, avait été amputé d’une jambe. Vers la fin mars-début avril, j’appris, lors d’un contrôle médical, qu’il était décédé. Il n’arrêtait pas d’arracher le pansement qui enveloppait son moignon et s’amusait à sautiller sur une jambe dans la salle où se trouvaient une trentaine de blessés. Il insultait aussi les infirmiers en dialecte, mais ils ne comprenaient heureusement rien à ses vociférations.
Noël arriva. Pour nous, ce n’était pas un jour de fête. Isolés du monde, nous avions plutôt le cœur gros. Un petit rayon de joie illumina pourtant ce jour : des dames de la Croix Rouge nous rendirent visite, mais pas les mains vides ! Je fus le premier à recevoir un cadeau, un magnifique pull en laine vierge. Enfin, j’avais de nouveau un vêtement ! A cela s’ajoutèrent quelques friandises qui me firent grand plaisir et me remontèrent le moral. Personne ne fut oublié : les autres reçurent des cigarettes et également des friandises.
Moi, je pensais sans arrêt à ma famille dont je n’avais pas de nouvelles depuis presque un mois. Quelques rares blessés recevaient parfois une visite. Un jour, un couple de visiteurs demanda dans la salle qui était René Geisler. Je levai la main et répondis :
« C’est moi ! »
Que me voulaient ces gens que je ne connaissais pas ? Ils me firent savoir que mon beau-père Eugène avait essayé de rejoindre Nancy à moto. Mais, ne possédant pas de laissez-passer, il fut refoulé par un contrôle. Ces quelques nouvelles me rassurèrent quand même.
Un autre jour, un homme encore jeune fut admis dans notre chambre, il avait été renversé par un camion militaire américain et présentait une fracture ouverte du bras. Les médecins s’affairèrent autour de lui, mais malgré leurs efforts, il mourut quelque temps après. Le professeur expliqua que la morphine pouvait être très dangereuse pour une personne atteinte de problèmes cardiaques. Il est vrai que les Américains donnaient systématiquement ce calmant à tout blessé.
Plus tard furent encore admis deux jeunes originaires de la région de Forbach. Leur visage et leur corps étaient couverts de petits boutons rouges. Ce n’était pas la rougeole ! En voulant rejoindre les Américains, ils avaient marché sur une mine qui en explosant se désintégrait en une multitude de minuscules éclats, ce qui avait provoqué ces nombreuses petites blessures. Et comment fit le professeur pour extraire les éclats ? Il utilisa un puissant aimant qui en retira la plus grande partie.
Un autre blessé, amputé du bras, nous raconta sa mésaventure : incorporé de force dans l’armée allemande, il ne rejoignit pas son unité après une permission et se cacha dans son village. Lors de la libération, un obus éclata dans la cave où il s’était réfugié avec sa famille et un éclat lui arracha la moitié du bras. Des soldats américains le soignèrent sans ménagement : ils le couchèrent sur la table de la cuisine, le maintinrent fermement et avec un couteau de cuisine, ils coupèrent le reste du bras pantelant, sans aucune anesthésie !
Arriva la fin de l’année. Par un journal français prêté par un camarade de chambrée, j’appris la contre-attaque lancée par les Allemands dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier et appelée Opération "Nordwind". Les chars allemands arrivèrent jusqu’à Achen, soit à peine 5 km de Hutting. Mes soucis recommençaient. Qu’allait-il arriver à ma famille ? La Gestapo allait-elle revenir et de nouveau arrêter tout le monde ?
On avait enlevé mon plâtre et mon bras était soutenu par une sorte de goulotte métallique qui prenait appui sur le flan droit. Un écrou placé sur une tige filetée me permettait de varier la hauteur de la goulotte et donc mon confort. Le professeur m’encouragea à manœuvrer le plus possible cet écrou pour solliciter l’articulation. On m’avait lavé du haut jusqu’en bas car j’empestais à tel point que j’aurai tué une mouche à quinze pas rien qu’avec mon odeur.
Le lendemain, j’avais un peu de fièvre et le professeur en fut étonné au point qu’il me demanda ce qui me tracassait. Quand il apprit mes inquiétudes pour ma famille, il comprit que j’étais à bout et me dit qu’il en parlerait à ma tante. J’étais en effet très affaibli, incapable de marcher, et surtout déprimé.
Mais auparavant, je fus encore le sujet d’un exposé dans l’amphithéâtre de la faculté de médecine de Nancy, devant une centaine d’étudiants. Mais pour m’y rendre, quel cauchemar ! Un infirmier m’accompagna heureusement, car tous les trois pas, je devais m’adosser à un mur pour reprendre mon souffle. Le professeur a certainement expliqué, cobaye à l’appui, sa méthode pour enrayer la gangrène. En tout cas, cela m’a semblé durer une éternité. A la fin de son exposé, il me félicita devant toute l’assemblée pour mon courage démontré lors de tous les actes médicaux douloureux.
Le 13 janvier, ma tante me ramena chez elle. Elle avait récupéré un peu partout de quoi m’habiller : chemise, pantalon de cavalier, chaussettes, galoches et pèlerine. Il n’y avait pas d’ambulance pour me conduire, ni de taxi, il fallut parcourir tout le trajet à pied. De plus, le trottoir était parfois encore enneigé à certains endroits et rendait la marche périlleuse. De temps en temps, je m’adossais au mur d’une maison, car j’étais très fatigué, mais pourvu d’une volonté farouche pour y arriver, je reprenais mon chemin. J’étais stimulé par la joie d’avoir pu quitter l’hôpital et de retrouver un foyer. J’avais hâte de revoir mon frère Armand qui avait quitté l’hôpital déjà avant Noël et mon cousin Lucien qui était pour moi comme un frère, vu que j’avais été recueilli dans sa famille à Sarreguemines, après le décès de mon père.
Après trois jours de bons repas, je tenais de nouveau sur mes jambes. Plus besoin de m’aliter ! Le premier souci de ma tante fut de me relaver de la tête aux pieds et de me frictionner à l’eau de Cologne. Enfin, j’étais de nouveau présentable ! Il me fallait pourtant retourner à l’hôpital trois fois par semaine et toujours à pied. J’en profitais pour rendre visite à mes anciens camarades de chambrée qui n’en revenaient pas de me voir marcher. J’allais aussi chercher ma cousine Fernande, la sœur de Lucien, à la sortie des cours. Quand Lucien rentrait du lycée, il sifflait ou chantait toujours, heureux comme un poisson dans l’eau. Je suivais ses devoirs pour m’entraîner au système français qui était beaucoup plus difficile que celui des Allemands.
Vers la fin janvier, Armand fut rapatrié à Hutting par la Croix Rouge. Moi, je restais, ne sachant quand ce serait mon tour. La poste recommençait à fonctionner. J’écrivis une lettre à ma famille et demandai à ma mère de m’envoyer les trois cents francs que j’avais gardés en 1940. Avec cet argent, j’achetai un stylo, du papier et des livres d’occasion de grammaire et de composition française. De mon plein gré, je faisais des devoirs que nounou Emile vérifiait lorsqu’il revenait le week-end de Metz, où les services de la Préfecture de la Moselle avaient repris leurs fonctions. A Metz, il logeait chez une sœur de ma grand-mère.
Un jour, en allant chercher Fernande à la sortie des classes, j’entendis sonner toutes les cloches. Des vendeurs de journaux proposaient sur les places publiques et dans les rues une édition spéciale : l’Allemagne avait capitulé. On était le 8 mai 1945 et la guerre était terminée.
Quelques jours plus tard, je tombai sur une vitrine exposant des photos de déportés dans les camps de concentration. Pendant une heure, j’observais les clichés, ne pouvant les quitter des yeux, sidéré par les atrocités commises par les Allemands, choqué par la vue des détenus morts et des squelettes vivants. Je n’en croyais pas mes yeux. Pour moi, c’était inimaginable ! Ces photos, je les regardais chaque jour, en passant devant la vitrine, je m’imbibais de ces horreurs, me demandant comment on pouvait traiter des êtres humains de la sorte. Je n’avais pas encore tout vu, ce n’est que plus tard que j’appris par les livres et la visite du camp du "Struthof" toutes les atrocités commises par les Nazis.
Peu à peu, mes plaies commençaient à se cicatriser. Mon bras reposait maintenant dans une écharpe et j’arrivais tant que vaille à écrire un peu correctement avec mon bras blessé. Le professeur me confia aux mains d’un kinésithérapeute. La main droite était fixée sur le rayon d’une roue qui tournait lentement d’un mouvement de plus en plus excentrique, ce qui obligeait le bras à se déplacer de plus en plus haut. Puis le kiné procédait à des massages, des contractions et des élongations. Enfin des impulsions électriques réveillaient peu à peu le système neurologique. C’était très pénible, mais je tenais une fois encore le coup.
Vers le 20 mai, deux Sarregueminois débarquèrent chez ma tante : Zacharias, un cousin de ma tante et Angermuller, entrepreneur de bâtiments. Ils étaient à la recherche de matériaux pour la reconstruction. Ils me proposèrent de me ramener à Hutting, mais il leur fallait l’autorisation du professeur, chez qui je me rendis immédiatement. Puisque j’avais l’occasion de me faire soigner sur place par les sœurs d’Oermingen, il m’autorisa à retrouver ma famille et à rentrer. Immédiatement, j’emballai mes maigres affaires et le lendemain, je quittai Nancy pour aller à Toul. Notre promenade dura ainsi toute la journée. Je ne savais même plus où nous étions. Nous couchâmes quelque part, et après une nuit d’insomnie à cause d’un polochon auquel je n’étais plus habitué, nous repartîmes avec la Traction Citroën pour Metz où je dus attendre plusieurs fois assez longtemps dans la voiture. Dans la soirée, nous arrivâmes enfin à Sarreguemines après avoir dû nous arrêter en route à un poste militaire. Les deux Sarregueminois avaient un laissez-passer en règle et moi, un certificat signé par le professeur de médecine. Je débarquai dans la famille Angermuller, un peu déçu de ne pas avoir été ramené à Hutting. Le lendemain, ils me déposèrent à Oermingen. Je laissai ma valise chez les sœurs et pris tout de suite rendez-vous pour le renouvellement des pansements. Et je pris le chemin du retour, le long de la voie ferrée Sarreguemines –Strasbourg pour arriver à Hutting sur le coup de midi. Ma famille était en train de déjeuner.
Mais ce retour ne fut pas un moment de bonheur, car ma mère reprocha à son mari d’avoir été la cause de mon état physique, puisque j’avais encore le bras en écharpe. Alors je tançai, avec véhémence, ma mère, disant que mon beau-père n’y était pour rien du tout, qu’elle ferait mieux d’être heureuse que je sois encore en vie, et cela grâce aux soins du professeur Barthélémy, à la bonne chère de tante Gabrielle et aux efforts fournis par nounou Emile pour cette cause. D’autre part, mon beau-père avait fait l’effort d’essayer de me rendre visite à Nancy, malgré le froid, alors qu’elle n’avait pas bougé un seul petit doigt ! J’en eus les larmes aux yeux, mais mes remarques lui clouèrent le bec !
Je me rendis encore une seule fois à Oermingen chez la sœur infirmière, car mes plaies se cicatrisèrent enfin. De temps en temps, je devais me rendre à Nancy, pour un contrôle auprès du professeur qui était toujours heureux de me revoir. Mais pour cela je devais me rendre à pied, par la forêt, pour ne pas allonger le trajet, à la gare de Sarralbe et y prendre le train de 4 heures du matin. J’en profitais toujours pour passer une nuit chez tante Gabrielle qui était très heureuse de me revoir et d’avoir des nouvelles de la famille.
Puis, un jour, le professeur m’annonça que c’était le dernier contrôle et il m’expliqua l’intervention qu’il envisageait pour rendre mon bras plus mobile : il s’agissait d’enlever le cartilage qui soudait l’omoplate au reste de l’humérus et bloquait ainsi mon bras. Mais je refusai catégoriquement car je voulais reprendre mes études secondaires, les cours ayant déjà repris au lycée de Sarreguemines. Il comprit très bien ma raison de refuser et me recommanda de beaucoup nager et de mouvoir le plus possible mon bras droit, ce que je promis et fis par la suite. Je pus facilement suivre son premier conseil en nageant dans l’Eichel, mais le second fut plus difficile à mettre en pratique. La fenaison avait débuté et je revendiquai le droit de charger le foin sur la charrette avec la fourche alors que mon beau-père le disposait correctement. Cette exigence ne fut pas facile à obtenir, car tous pensaient que je ne tiendrai pas le coup, mais devant ma volonté inébranlable, j’obtins gain de cause. Voilà qui remplaça efficacement les séances de kiné, bien sûr, je souffris beaucoup, mais je ne cédais pas devant les douleurs dans mon bras, surtout après le travail. Mon bras devint ainsi plus mobile, mais cela prit beaucoup de temps.
Dès mon rétablissement, j’avais pris contact, selon les conseils de mon grand-père, avec son Inspecteur de l’Education Nationale, qui était encore en service, pour passer le concours d’entrée à l’Ecole Normale des Instituteurs, la scolarité y étant gratuite, à condition de signer un engagement de dix ans après la réussite des examens. Mais malgré les références apportées (un grand-père instituteur retraité et titulaire du grade d’Officier de l’Instruction Publique qu’il connaissait bien), malgré mes explications et les preuves écrites du retour tardif de l’hôpital, il refusa, les inscriptions au concours étant déjà closes. Plus tard, j’appris qu’il était plutôt mal vu par la majorité des " instits", à cause de sa sévérité.
En désespoir de cause, je me rendis au lycée de Sarreguemines pour l’admission en seconde. Hélas, le passage en seconde était soumis à examen. Nous étions peu nombreux. Il fallut rédiger une dissertation française, réaliser un problème de mathématiques et que sais-je encore ! J’étais stupéfait devant les exigences françaises qui ne tenaient pas compte de notre situation exceptionnelle due à l’annexion au Reich pendant 5 années !
Le sujet de la dissertation consistait à commenter une morale tirée d’une fable de La Fontaine : "Travaillez, prenez de la peine, c’est le fonds qui manque le moins !" Qu’est-ce que ce charabia d’un auteur dont j’ignorais tout de son existence sur terre ? Bon, je compris le sens et pondai, d’un seul trait, un texte en exposant mes sentiments et mes impressions. Tout l’examen fut bien noté d’après les confidences faites par un ancien professeur du temps de l’annexion.
Mais je ne pensais pas que cette maxime me harcèlerait dès la rentrée jusqu’à la fin de mes études. En effet, le programme français était beaucoup plus chargé que le programme allemand. J’en ai bavé pour me mettre à niveau ! Il me fallut bien suivre le conseil de La Fontaine : "Travaillez, prenez de la peine". Les résultats furent en conséquence du travail fourni et, ô surprise, je décrochai le prix d’excellence à la fin de l’année scolaire.
A l’époque, la distribution des prix était une cérémonie très brillante à laquelle assistaient de nombreux invités, comme le sous-préfet, le maire et bien d’autres personnalités. Tous les professeurs revêtaient leur toge agrémentée d’une épitoge de couleur jaune pour les professeurs de lettres et rouge pour les professeurs de sciences. Tout ce monde prenait place sur l’estrade de l’aula. Puis le proviseur, après un discours d’entrée, donnait lecture du palmarès en commençant par le niveau le plus élevé (philo, math élèm). Pour chaque matière, étaient décernés un 1er, un 2° et un 3° prix qui consistaient en des livres se rapportant en général à la matière concernée. Le prix d’excellence revenait à l’élève le plus méritant de la classe. Cette cérémonie durait environ trois heures.
Année 1946-1947.
En 1ère, une matière me rebutait particulièrement, la littérature française. Qu’est-ce qu’on pouvait passer du temps à disséquer des phrases, des mots, des rimes, le clair-obscur d’un auteur ! J’eus le dégoût de la lecture, et encore aujourd’hui, quand je lis un roman, je saute systématiquement les passages où l’auteur fait des descriptions fastidieuses. J’aime l’action et pas du tout les détails qui ne servent à rien. Heureusement j’eus le droit de passer la première partie du bac en session spéciale pour victimes de guerre. L’épreuve ne comportait que des épreuves écrites et se déroulait à Metz. En anglais, je me demande ce que le correcteur a pu penser de ma traduction. Je n’aurais pas été étonné s’il avait pensé avoir affaire à un candidat détraqué. Mon faible vocabulaire anglais ne me permit pas de faire une traduction cohérente, elle fut plutôt fantaisiste. Cela explique la mention passable à l’examen, mais peu importait.
Au mois de mars, j’accédai donc en classe de philosophie. Encore une fois, dans mon parcours cahoteux, j’eus des difficultés d’adaptation, et comme le disait si bien La Fontaine, je travaillais et prenais de la peine, car le fonds manquait le moins. Sur les conseils de mes professeurs, je me préparai à passer la seconde partie du bac à la session d’octobre, ce qui impliquait de nombreux rattrapages dans toutes les matières pendant les vacances d’été. Mais à côté des travaux intellectuels, il y avait aussi les travaux manuels, car il me fallait donner un coup de main dans les activités agricoles (moisson à la main, battage des céréales, binage, sarclage des cultures) et ménagers (barattage de la crème pour la production de beurre). Dès septembre, une fois le regain récolté, je menais les vaches au pâturage, et j’emmenais les manuels scolaires, bien content d’être tranquille pour pouvoir rattraper les cours qui me manquaient. Vers la mi-septembre, je constatai avec stupeur que je ne retenais plus du tout ce que je lisais. Je consultai un médecin qui me conseilla d’arrêter ce "bourrage de crâne", il ne pouvait pas m’aider médicalement, j’étais tout bonnement surmené. Puisque j’étais inscrit à l’examen, je me présentai quand même à l’épreuve écrite et …échouai. Il ne me manquait que trois quarts de points sur quarante pour pouvoir passer l’oral et il ne me restait plus qu’à refaire une année de philo ! Le redoublement fut bénéfique pour moi, car je fis d’énormes progrès et remportai pour la seconde fois le prix d’excellence. J’obtins sans problème le bac, avec la mention bien. Pourquoi seulement bien ? Et bien, je vous l’expliquerai un peu plus loin. Pour les élèves d’Alsace-Lorraine, un programme transitoire avait été institué :
- le français figurait encore au programme de la classe de philo
- en latin, nous n’avions pas le niveau des élèves de "l’intérieur", ce qui ne nous empêcha pas d’attaquer dès la seconde le fameux "De bello gallico" de Jules César, puis Salluste et Cicéron. En 1ère, nous attaquions " l’Enéide" de Virgile. En classe, pour les traductions faites dans les conditions du bac, nous avions le droit d’utiliser un dictionnaire, mais ne comportant pas d’index grammatical.
- en anglais, notre vocabulaire n’était pas à la hauteur. Notre professeur de seconde ne nous faisait pas apprendre méthodiquement ce vocabulaire, alors que le professeur de l’autre classe de seconde le faisait.
- en géographie, à l’oral, je fus interrogé sur la Belgique, mon pays de naissance, qui ne figurait même pas au programme. L’examinateur fut d’accord avec moi au sujet des observations faites au cours de deux voyages dans ce pays et lors d’entretiens avec mon oncle Louis Geisler. Une seule fois, il me rectifia au sujet d’un centre universitaire important. Les voyages ont formé ma jeunesse car j’observais tout et enregistrais facilement toutes les informations.
- en histoire, j’eus la chance inouïe de tomber sur le Second Empire de Napoléon III, que je connaissais dans ses moindres détails. L’examinateur dut arrêter mon exposé, alors que j’en étais seulement à l’attentat d’Orsini en 1858 et que j’avais déjà dépassé le temps alloué.
- en physique-chimie, je fus le dernier candidat à me présenter devant l’examinateur. Je fus accueilli par une "douche froide" :
« Ah ! Vous voici enfin ! Vous appréhendiez certainement cette partie de l’examen ! »
Je m’excusai poliment car les exposés dans les autres matières m’avaient retenu plus longtemps que la durée normale auprès de ses collègues. Normalement on devait traiter un chapitre, mais lui, il avait une grande feuille devant lui, avec questions et réponses, où il puisait les questions-pièges destinées à faire trébucher les malheureux candidats. Et les questions fusèrent sur la chimie (j’avais été prévenu par mes camarades). Après une trentaine de questions, constatant que j’avais réponse à tout, il m’en posa encore trois en physique. Mais là aussi, il ne put pas me prendre en défaut et il admit que j’étais le seul à avoir répondu correctement à ses questions. Or, je connaissais bien la chimie pour l’avoir déjà étudiée pendant le troisième trimestre de l’année dernière. Notre professeur actuel, un agrégé de surcroît, ne savait pas réaliser correctement une seule expérience de chimie. Quand le mélange de deux gaz devait provoquer une petite déflagration, lui en annonçait une terrible et inversement. Il était vraiment inconscient du danger. Un jour, il nous annonça une expérience avec des gaz et je me méfiai, car je savais la dangerosité du mélange. Comme j’étais assis au premier rang, je me cachai sous le pupitre. Le professeur Bachaud, au nom prédestiné, n’avait pas mis de gants de protection, et en approchant la grosse éprouvette du bec Bunsen, il provoqua une forte explosion qui fit voler en éclats toutes les vitres de la salle de chimie et le blessa à la main. Au bruit de l’explosion, le censeur déboula en trombe dans la salle de chimie, mais ne put que constater les dégâts matériels et corporels. A la récréation, le proviseur me demanda d’expliquer ce qui s’était passé et je ne pus qu’insister sur l’imprudence du professeur.
Je dus passer les épreuves orales à Metz. En allemand, première matière de l’oral, ce fut plutôt burlesque. L’examinateur, légèrement "cuité", arriva très en retard. Il ouvrit Faust de Goethe et me désigna quatre lignes à lire et à traduire. L’un des vers était : "Warmes Leben floss durch seine Adern". La traduction littérale donnerait : "Une vie chaude traversait ses artères". Moi, je refusai cette version et je cherchai une traduction plus poétique. Le professeur me demanda la traduction que j’avais en tête et je lui citai la moins poétique. Il approuva parce que j’avais compris. Je dus encore expliquer le texte précédent le passage traduit et ce qui suivait. En raison de mon flot de paroles, il m’interrompit rapidement et dit laconiquement :
« Sehr gut ! ».
Rentré à la maison, je trouvai la traduction que j’aurais aimé donner : "Un souffle chaud parcourut ses veines".
En littérature française, je tombai sur le sujet suivant : "Démontrez que ce personnage (Tartuffe ou le Misanthrope de Molière, je ne sais plus) est ci ou ça". J’eus cinq minutes de réflexion, puis l’examinateur m’appela. Je lui démontrai tout le contraire de ce qu’il attendait, l’amenant tout doucement vers une conclusion non conforme. Pendant mon exposé, bizarrement, il approuvait par des hochements de tête. Mais à la fin, il explosa et entra dans une vive colère, s’écriant : « Jamais un tel comportement ne me fut infligé ! »
Moi, je jubilais intérieurement d’avoir pu me venger de toutes ces vérités saugrenues qu’on nous avait fait avaler au cours de nos études littéraires. Après l’oral, je fus rejoint sur la plate-forme du tramway qui me ramenait à la gare par la prof de math qui m’apprit que la mention "très bien" m’avait été refusée par ce prof de littérature. Mais peu importait, j’étais bachelier et de toute façon, aucune mention ne figurait sur le diplôme.
Arrivé à la gare, je repris ma bicyclette laissée à la consigne. Le train que je devais prendre était parti depuis une dizaine de minutes. Or, à midi, en mangeant dans un petit restaurant avec d’autres camarades, je m’étais aperçu qu’il me manquait un billet de cent francs dans le porte-monnaie. Il ne me restait que quelques pièces. Ma mère avait pris le billet et elle avait oublié de me le dire. Il ne me restait plus qu’à rentrer à Hutting à bicyclette. Mais la soif me tenaillait et je comptai les pièces de monnaie restantes, cela pouvait suffire pour une bière à condition de la boire au comptoir. La soif étanchée, je repris la route, mais je me perdis dans la nature, car je ne disposais pas de carte. Après plusieurs demandes de direction, je pus rejoindre la route correcte, pour arriver à la maison à deux heures du matin.
Je ne peux résister à l’envie de raconter encore une mésaventure qui m’est arrivée en classe d’allemand, alors que j’étais en seconde B. Sur mon bulletin, figurait la remarque suivante :"se désintéresse souvent". Ce qui n’était pas du tout exact. J’avais été vexé par l’attitude du professeur qui m’avait compté comme une faute l’emploi de l’accusatif dans une dissertation, alors que lui préconisait le datif. Quinze jours plus tard, je réintroduisis la même phrase dans une autre dissertation et je mis le datif. Cette fois, le prof exigeait l’accusatif. Cette attitude équivoque du professeur fut le point de départ de mon désintérêt, puisqu’il n’admettait pas son erreur.
Une autre fois, une punition non méritée me fut aussi infligée en classe de seconde. Revenu de la récréation pour le cours d’anglais, je fermai la fenêtre car j’étais celui qui était assis dans le banc près du mur. En fermant la fenêtre, j’avais remarqué dans la cour la présence d’une prof de sport du lycée de filles qui initiait ses élèves au saut en hauteur. Le cours d’anglais venait de commencer et soudain le censeur fit irruption dans la salle de classe, s’exclamant : « Les élèves qui ont fermé les trois fenêtres, debout ! »
Je me levai spontanément, mais pas les deux autres élèves qui avaient aussi fermé chacun une fenêtre. "Huit heures de retenue pour avoir manqué de respect envers la prof de sport !", telle fut la sanction.
Avant d’avoir pu placer un mot pour m’expliquer, le censeur avait déjà disparu. Je ne savais pas ce qui s’était passé, en tout cas j’étais innocent. Qu’avait fait l’un des deux autres ? Avait-il jeté un objet en direction de la prof ou avait-il fait une grimace ? Je n’ai jamais pu le savoir. Le coupable était un lâche, il aurait pu se dénoncer. La punition ne me dérangea pas énormément, car je pouvais en profiter pour faire mes devoirs en toute tranquillité et échapper ainsi aux travaux agricoles qui m’attendaient à la maison. Mais j’allai quand même voir le censeur pour m’expliquer et il réduisit la retenue à quatre heures.
Et maintenant gagner son pain à la sueur de son front
Premier emploi
Avec mon diplôme en poche, j’aurais pu effectuer des études supérieures à la faculté de lettres de l’Université de Strasbourg, mais la situation financière de mes parents ne le permettait pas. Je contactai un cousin de ma mère à la Direction de la SNCF de Strasbourg, mais sans succès. Avec le bac Math élèm (mathématiques élémentaires), j’aurais été embauché sur le champ !
Nounou Emile fit des démarches auprès d’un autre cousin de ma mère, Directeur adjoint du CIAL de Metz qui fit le nécessaire pour que je sois embauché à l’agence de Sarreguemines, dans le but de faire un stage dans les différents services. Je fus finalement embauché. Première surprise, je fus soumis à un examen complètement idiot comportant une dictée, des opérations (addition, soustraction, multiplication et division) et une version allemande. Le directeur m’affecta au service portefeuilles qui tient un fichier sur chaque client et gère les chèques ainsi que les traites des commerçants. C’était un service très astreignant à partir du 10 du mois, et surtout vers la fin du mois, parce que c’est là que les effets commerciaux arrivaient à échéance. Il fallait s’assurer que les clients aient donné leur accord pour le paiement et que les comptes étaient suffisamment approvisionnés. Chaque soir, il fallait faire le bilan de la journée, chaque fin de mois, le bilan mensuel et à la fin de l’année, le bilan annuel. Pour ce dernier, nous étions à trois. Aucune heure supplémentaire n’était payée, et si je devais travailler jusqu’à deux ou trois heures de la nuit, je ne touchais aucune indemnité pour le repas du soir. Avec mon premier salaire, même pas 12 000 francs, je me payai une belle bicyclette neuve pour pouvoir rentrer à la maison le soir ou pendant la nuit.
Une nuit, vers deux heures du matin, alors que je pédalais allègrement malgré l’orage qui avait éclaté, je fus stoppé dans ma course par…un policier dont j’avais heurté l’entrejambes avec la roue avant. C’était près de la gare de triage, entre Sarreguemines et Rémelfing. Il se mit à vociférer :
« Comment, on roule maintenant en pleine nuit sans éclairage ! »
Je m’excusai poliment, lui faisant constater que la dynamo était en position de marche, contre le pneu , mais qu’elle patinait à cause de la pluie. Puis la conversation porta sur la raison de ma présence sur la route en pleine nuit et sous la pluie. Au cours de la conversation, je voulus allumer une cigarette, mais il m'en empêcha violemment car un wagon contenant un produit inflammable s’était renversé et son contenu se déversait dans le fossé longeant la route. Là-dessus, il me souhaita quand même bonne route.
Une fois, il m'arriva d’avoir une différence d’un centime dans mon bilan mensuel. J’avais eu la chance de pouvoir utiliser la calculatrice électrique imprimante. Mon dernier train allait bientôt partir et j’emportai tous les documents comptables à la maison, ce qui était interdit. Après le souper, je me couchai. Vers minuit, je me réveillai et me rappelai que j’avais frappé la touche 3 au lieu de la touche 4 pour les centimes. Je me levai aussitôt, vérifiai toutes les colonnes par calcul mental et constatai effectivement qu’il y avait une erreur d’un centime : la machine avait compté 3 centimes, mais imprimé 4 centimes. Ouf ! Je me recouchai à deux heures pour me relever à cinq heures du matin, toujours sans réveil, dont je ne faisais jamais usage.
Pour le bilan de l’année 1948, le directeur de la banque avait, dans sa "grande" magnanimité, accordé le repas de midi au restaurant, payé aux frais de l’agence. Nous étions trois employés, un ancien avec une quarantaine d’années dans la boîte, un jeune avec un brevet d’études commerciales, recruté récemment pour m’assister, et moi. A midi, nous nous installâmes dans un restaurant, près de l’église saint Nicolas. Pour commencer, notre chef de groupe commanda un apéritif, puis un menu complet, avec dessert, café et même "pousse-café". Le lendemain, il présenta la note au directeur qui trouva que l’on avait un peu exagéré. Mais notre collègue, l’ancien, lui rétorqua :
« Notre menu était certainement plus ordinaire que le vôtre au jour de l’an, qui était pour vous un jour férié, alors que nous avons dû travailler sans rémunération ! »
Au mois de septembre, éclata une affaire qui allait mal tourner. Une traite avec protêt, d’un montant de 500 000 F, était arrivée pour un commerçant de la ville. Or, le compte du client débiteur était déjà dans le "rouge", et comme la traite devait être payée dans les 48 heures, je le signalai au sous-directeur, puis au directeur, à son retour dans l’agence. Ce dernier m’assura qu’il allait s’occuper personnellement de l’affaire. Le lendemain il partit et ne se montra plus de la journée, ni le jour suivant. Le second jour, vers 16 heures, n’ayant toujours pas de directive, je recontactai le sous-directeur qui me conseilla d’attendre encore un peu. Vers 17 heures, le directeur ne s’étant toujours pas présenté, il me chargea de porter l’affaire devant un huissier.
Le lendemain, le commerçant arriva et demanda à voir le directeur qui était alors présent. Une minute plus tard, j’étais convoqué dans le bureau du directeur. Le "grand chef" m’accusa de ne pas avoir tenu compte de ses consignes pour le règlement de cette affaire. Alors "la moutarde me monta au nez" et je lui répliquai vertement, devant le commerçant ébahi qu’il ne m’avait donné aucune consigne, vu qu’il avait été totalement absent ces deux derniers jours et que tous les collègues, même le sous-directeur pouvaient confirmer cela. Pour finir, je lui fis part de mon intention de lui remettre ma démission écrite pour la fin du mois, rajoutant que je préciserai dans ma lettre les raisons qui me motivaient. Et je quittai le secteur bancaire sans regret.
Et maintenant instituteur
Après ce coup de tête, je me retrouvais sans emploi ! Immédiatement je postulai auprès de l’Inspection Académique de la Moselle pour avoir un poste d’instituteur remplaçant. Je demandai même les dossiers pour être affecté en Algérie, en Tunisie ou au Maroc. Heureusement que je ne fus pas nommé en Afrique du Nord, car un camarade de classe, déjà en Algérie, fut une des premières victimes des violences qui débutaient et allaient se transformer en guerre.
Année 1949-1950
Ma carrière d’instituteur commença donc le 25 octobre 1949, à l’école de garçons de la Blies de Sarreguemines, située sur la rive droite de la Sarre. J’exerçais au cours élémentaire 2e année, dans une baraque. Tous les collègues m’avaient prévenu qu’il y avait des éléments très perturbateurs dans cette classe. A l’époque, on exigeait de tout enseignant d’avoir un emploi du temps hebdomadaire bien précis et d’établir une répartition mensuelle des matières enseignées, conformément aux Instructions Officielles.
J’avais donc une quarantaine d’élèves. Je n’admettais pas de manquements à la discipline, ni le manque de soin dans le travail écrit, sinon c’était la retenue le soir, après la classe. La retenue consistait en un travail écrit surveillé. J’avais tout mon temps après 16 heures, car le premier train pour rentrer ne partait que vers 18 heures. Les élèves étaient surtout issus du milieu gitan et ils aimaient la liberté. Les priver de liberté était la pire des punitions. Ils s’assagirent et je n’eus pas de problème. Tous les collègues et même le directeur n’en revenaient pas, mais j’aurais pu avoir des ennuis, car j’ignorais la règlementation de la retenue, à savoir prévenir les parents pour le jour, la durée et le motif de la punition.
La pédagogie ne s’apprend pas en un seul jour. En voici un exemple : au programme figurait la soustraction sans emprunt. Pour moi, c’était évident, mais pas pour les élèves. Après quelques démonstrations au tableau qui semblaient avoir été comprises, je donnai un exercice au cahier, car toute leçon devait laisser une trace écrite. Le soir, lors de la correction, je découvris avec stupeur que la plupart n’avaient rien compris et je mis à creuser ma cervelle pour expliquer cet échec. Le lendemain, je repris la leçon avec utilisation des doigts (matériel qui ne fait pas de bruit et qui est toujours disponible). Les enfants comprenaient très bien "6 moins 3", mais pas "3 ôté de 6". Pendant toute ma carrière je remarquerai cette difficulté de compréhension. Pour ma part, je continuerai à utiliser le "moins" à la place du "ôté de", malgré la remarque faite un jour par un inspecteur.
A l’époque, tout enfant d’âge scolaire, surpris dans la rue pendant les heures de cours, était ramené par la police à l’école, à moins d’avoir une autorisation d’absence signée par le directeur. A l’école de la Blies, ils atterrissaient tous chez moi, dans la baraque.
Dans cette école enseignait un instituteur originaire de Kalhausen et qui exerçait au cours préparatoire. Il me montra sa méthode personnelle d’apprentissage de la lecture qui me servit lors de mon remplacement. Pour chaque phonème ou son (par exemple, le son "o" peut s’écrire de plusieurs façons : o, au, eau, aux, eaux, ot, os, op…), il avait fabriqué des bandelettes en carton où figuraient différents dessins ou images représentant le mot avec son écriture : une orange, un enfant, la jambe, il tremble…(15)
__________________
15) Il s’agit de Nicolas Lenhard (1915-1998) qui finira sa carrière à la même école, toujours comme maître de CP. Pour se rendre à Sarreguemines, il prenait chaque jour le train à la gare de Kalhausen. Comme les ouvriers de l’époque, il emmenait sa gamelle et réchauffait son repas de midi à l’école.
Le matériel pédagogique était souvent fabriqué par l’enseignant lui-même à partir de matériel de récupération. L’outil dont parle René est en carton. Les bandes coulissantes peuvent comporter des dessins correspondant à des noms, comme le décrit René, ou des phonèmes, comme sur la photo ci-dessous, pour travailler la combinatoire et former des syllabes. Ces bandes sont interchangeables.
 |
 |
Le 15 novembre, je dus faire un remplacement à Grosbliederstroff, dans un cours préparatoire, pour remplacer un maître parti en stage d’éducation physique. Je prenais mes repas dans un restaurant tenu par les parents d’un camarade de classe de "philo" et je dormais chez une ancienne institutrice ayant exercé à Kalhausen, du temps de grand-père (16). Un jour, le camarade de classe m’entraîna à Kleinblittersdorf, en Allemagne. On traversa la Sarre dans une barque, pour atterrir dans un bar et y consommer quelques coupes de champagne. Mais n’y faisait-on que cela ? Je lui fis la remarque que ce lieu ne m’intéressait pas et nous n’y remîmes plus les pieds. Ce remplacement d’une durée de quinze jours fut une période bien tranquille en classe, pas comme à Sarreguemines !
Le 16 décembre, je débarquai à Bambiderstroff pour un remplacement qui allait durer jusqu’au 31 mai de l’année suivante, ce qui était bénéfique pour moi, puisque je n’étais payé que pour les jours de remplacement. J’avais un cours triple, cours préparatoire et cours élémentaires 1 et 2. Le travail était plus compliqué avec ces trois niveaux, de plus, je devais encore assurer des cours d’adultes, le soir, de 20 à 22 heures, pour les jeunes filles. Pour se rendre dans ce village, il n’était pas question d’utiliser ma bicyclette. Il me fallut utiliser le train, puis le bus, pour arriver à Zimming, et terminer le trajet à pied, par un sale temps de brouillard épais et par une pluie verglaçante. On n’y voyait pas à dix mètres !
_______________
16) Il pourrait s’agir de mademoiselle Kalis.
Sur place, j’étais nourri et logé dans une famille très gentille qui vivait d’un peu de culture et d’élevage et qui tenait encore un café. Le second fils faisait des études pour devenir prêtre, et le plus jeune était en apprentissage dans les mines de charbon de Faulquemont, les plus modernes d’Europe. En plus, il était champion départemental de ping-pong. J’étais très bien vu par les habitants du village, car je fréquentais les offices religieux et à l’église, j’avais la place attribuée officiellement à l’instituteur. Mes élèves aimaient rester avec moi en classe, après seize heures et je leur prodiguai des conseils pour la pratique de la division.
Pendant les vacances de Noël, j’attendais avec impatience de savoir si l’institutrice que je remplaçais allait reprendre son travail ou non. Ne voyant rien venir, je me rendis à Metz, auprès du secrétaire général de l’Inspection Académique, qui était un ami de nounou Emile. Il regarda ses tableaux, puis le courrier du jour qu’il n’avait pas encore consulté et trouva une lettre venant de Bambiderstroff qui confirmait que l’institutrice ne reprenait pas encore sa fonction.
Mais lorsque mon traitement fut viré sur mon compte, je constatai que les vacances de Noël n’avaient pas été payées. Le jeudi suivant, je me rendis de nouveau à Metz, auprès des services comptables de l’Inspection Académique, mais ceux-ci refusèrent de me payer mon dû, arguant du fait que j’avais envoyé un avis de cessation de fonction pour les vacances. J’eus beau affirmer que j’avais droit au paiement des vacances, puisque j’occupais le poste avant et après les vacances, rien n’y fit ! Alors je filai au siège du syndicat pour y expliquer ma situation et le refus de paiement de l’Inspection Académique. Le secrétaire général me demanda de patienter un peu. Quand il revint, il m’annonça que j’avais eu gain de cause et je le remerciai vivement pour son aide, car l’argent m’était nécessaire, n’en ayant pas de trop, puisque je vivais en pension complète.
Au mois de janvier eut lieu un accident concernant un de mes élèves et qui aurait pu avoir de graves conséquences de responsabilité pour moi. A la fin de la récréation, des élèves me prévinrent que le petit Joseph était tombé et ne pouvait plus marcher. La cour était encore recouverte de pavés très irréguliers. Je l’aidai à regagner la classe en le soutenant, puis j’auscultai mon blessé qui se plaignait de son genou. Mais j’avais beau tâter et presser la zone douloureuse, je ne trouvais rien d’anormal, ce qui n’empêcha pas Joseph de pleurer jusqu’à 11 heures. Je réexaminai encore une fois le genou sans pouvoir déceler quoi que ce soit. A la sortie des classes, je demandai aux élèves de prévenir sa grande sœur qui était scolarisée chez le directeur. Elle et un autre camarade aidèrent Joseph à regagner le domicile familial assez éloigné de l’école. A 13 heures, j’appris qu’il avait été hospitalisé pour une fracture de…la cheville ! Dur à avaler, mais vrai ! Sa mère passa à l’école à 16 heures et je lui expliquai le déroulement des évènements.
Mais l’affaire n’en resta pas là, puisque l’Inspecteur de Boulay se présenta à l’école pour diligenter une enquête administrative et en même temps me faire passer la première inspection de ma carrière. Il m’avertit que le défaut de surveillance effective pouvait entraîner éventuellement ma responsabilité avec des conséquences judiciaires. Mais il m’excusa, puisque j’étais jeune débutant dans l’enseignement et que je ne pouvais pas tout savoir. Il souligna par contre la responsabilité du directeur qui aurait manqué à son devoir de surveillance. Il se rendit alors chez le directeur. Cette affaire eut-elle des conséquences ? En tout cas, pas pour moi. Et pour le directeur ? Je dois avouer qu’il ne m’en a pas parlé et qu’il continuait à bricoler pendant les récréations dans son garage où il réparait des voitures qu’il revendait ensuite, pendant que moi, je surveillais. Il m’en proposa même une, mais je n’avais pas les moyens d’en acheter et je refusai.
J’avais au cours élémentaire 2 une élève allemande probablement de la zone russe et qui ne pratiquait pas encore bien la langue française. Sa mère me demanda de lui donner des cours de soutien, ce que j’acceptai de bon cœur et je le fis gratuitement. Le jeudi donc, je passais deux heures avec elle et, à chaque fois, j’eus droit de la part de la mère à un cognac aux œufs fait maison. Elle s’adonnait aussi à une activité que je n’avais encore jamais vue et que je ne reverrai pas dans ma vie, la dentelle au fuseau "klöppeln". Le travail exécuté était d’une beauté exceptionnelle et je la félicitai pour son art, car je n’avais encore jamais vu un tel chef-d’œuvre.
Lors de mon départ, les élèves pleuraient, car ils craignaient le retour de leur maîtresse. Moi-même, j’eus aussi beaucoup de peine de devoir quitter cette classe si attachante. Ce fut le moment le plus émouvant de ma carrière !
Année 1950-1951
A la rentrée de 1950, je fus nommé à Rohrbach-lès-Bitche, en remplacement d’une institutrice en congé de maladie, à cause d’une épidémie dangereuse pour les femmes enceintes. Tous les jours, je faisais le trajet Hutting-Rohrbach à bicyclette, malgré la difficile et longue côte de Singling. Un jour, je dérapai sur la route et m’étalai de tout mon long. Déjà du verglas au mois d’octobre! Il est vrai que le plateau de Rohrbach est réputé pour ses températures plus basses que dans la vallée et son enneigement plus abondant. Je venais d’en faire la découverte à mes dépens.
Le 14 novembre, je repris à Roppeviller, au fin fond du pays de Bitche, non sans avoir fêté la "Kirb" à Hutting, avec ma fiancée Adrienne. Je partis le cœur lourd, car je savais que nous ne nous reverrions que pour Noël, les liaisons avec ce petit village étant difficiles. Le transport du vélo par le train ne me posa pas de problème, mais à Bitche, il fallut recourir à un car des "Transports de Lorraine" qui refusaient catégoriquement le transport de bicyclettes. Après quelques palabres avec le chauffeur, et un petit pourboire, et à condition de monter et descendre moi-même le vélo de la galerie du car, nous arrivâmes à un accord, sans garantie si le vélo restait accroché à une branche d’arbre pendant le trajet.
Tout de suite, une remarque importante : les villageois de Roppeviller n’avaient retrouvé leurs maisons qu’après 1945, les Allemands ayant incorporé le village dans la zone militaire du camp de Bitche.
L’instituteur que je remplaçais avait fait une attaque cérébrale (AVC), il était père de deux enfants dont l’un avait tout juste quelques semaines. Quelques jours après mon arrivée, il partit à l’hôpital de Strasbourg pour des examens cliniques et j’aidais alors son épouse à garder les enfants, surtout le bébé qui pleurait souvent.
La salle de classe était pourvue d’un matériel hétéroclite fait de tables et de chaises récupérées. J’avais une classe unique regroupant tous les écoliers du village, garçons et filles de 6 à 14 ans. L’emploi du temps était difficile à mettre en œuvre, car je devais jongler avec les différents cours : pendant que je faisais une leçon magistrale avec un cours, tous les autres avaient un travail écrit. Mais les enfants étaient très sages et je n’eus pas de problème de discipline.
Un jour, je fus surpris par le comportement des enfants du cours élémentaire lors d’une leçon sur les transports ferroviaires. Je remarquai leur manque d’intérêt et leur passivité. Pourtant une belle illustration était disponible dans leur livre de vocabulaire. Je compris enfin qu’ils n’avaient jamais vu de
train ! Ce que me confirma l’épouse du collègue que je remplaçais. Ces gosses connaissaient à peine Bitche et comme moyen de transport, le seul car qui les reliait au chef-lieu de canton. On dit que les voyages forment la jeunesse, mais si les parents ne voyagent pas, il ne faut pas s’étonner que les enfants vivent repliés sur eux dans leur petit monde.
Le curé qui desservait Roppeviller et aussi Liederschiedt était un personnage unique dans son genre. Il avait été professeur de mathématiques au petit séminaire de Bitche et muté dans une cure à l’initiative du directeur de l’établissement car il aurait construit de ses propres mains sa maison d’habitation, ce qui ne correspondait pas exactement avec sa fonction et son sacerdoce. Il venait tous les jours enseigner le catéchisme à l’école, mais en réalité, il venait surtout faire un brin de causette qui durait souvent assez longtemps. Un jour, il me dit :
« Vous les pauvres instituteurs, vous êtes quand même à plaindre ! »
Je lui demandai pourquoi et il me répondit :
« Tous ces cahiers à corriger ! »
Je lui fis alors remarquer qu’en tant que professeur de mathématiques, il avait lui aussi été astreint au même devoir de correction, mais il me rétorqua :
« Que nenni ! En mathématiques, il n’y a que deux possibilités. Soit la réponse est juste et la note est 20 sur 20, soit la réponse est fausse et c’est un 0. Il n’y a pas d’autre note ! »
J’étais sidéré. Décidément, c’était un personnage bizarre. Quand il fut nommé curé des deux paroisses, il demanda au maire de Roppeviller un bon d’achat pour une moto à cause de ses déplacements à Liederschiedt et à l’archiprêtré de Bitche. Cette demande fut transmise via la Sous-Préfecture de Sarreguemines à la Préfecture de Metz qui bien sûr opposa son refus. Alors le curé adressa une longue lettre au ministère compétent, expliquant la nécessité d’un tel moyen de locomotion. Deux à trois semaines plus tard, il reçut la réponse avec un bon d’achat. Le plus étonnant dans cette histoire véridique, c’est que le ministre à l’époque était un communiste !
Quand l’instituteur que je remplaçais à Roppeviller revint de l’hôpital de Strasbourg, il reçut la visite d’une femme accompagnée de sa fille. C’était un dimanche après-midi. La mère parla beaucoup, fit étalage de la richesse de sa famille et de la grandeur de ses biens. Après leur départ, je demandai à mon collègue ce que signifiait cette comédie. Il m’avoua qu’elle cherchait un bon mari pour sa fille, ce que je soupçonnais depuis le début.
« Qu’elle cherche toujours à m’aguicher, lui répondis-je, j’ai déjà une fille en vue. » Et nous rîmes de tout cœur.
Un jour, après treize heures, l’inspecteur se pointa dans ma classe. Dès son entrée, je me souvins que j’avais desserré le nœud de ma cravate et ouvert le col de ma chemise. Mais déjà son index pointait dans cette direction. Le formulaire du rapport d’inspection comportait une ligne sur la tenue vestimentaire, mais l’inspecteur ne mentionna pas ce petit relâchement de ma tenue. Que dirait-il de nos jours en voyant la tenue de nos jeunes enseignants (jeans, pas des cravate…) ?
Sa manie, c’était de vérifier si les grands élèves maîtrisaient bien l’accord du participe passé. Il utilisait pour cela le procédé La Martinière qui consistait à écrire sur l’ardoise le mot demandé, en l’occurrence le participe passé, dans le but de contrôler son orthographe exacte. Le résultat du contrôle fut assez correct.
Vers la fin janvier, un dimanche, je donnai rendez-vous à Adrienne à Sarreguemines. Je dus partir très tôt de Roppeviller pour revenir tard dans la soirée. Mais j’étais content de la revoir et de pouvoir parler avec elle, les occasions de discuter étant par ailleurs rares dans le village.
J’étais logé chez des gens qui faisaient un peu de culture, de l’élevage et qui tenaient également un petit café. Ma chambre était séparée de la cuisine par un rideau, car la porte n’avait pas encore été réparée. Ces braves gens attendaient d’obtenir l’indemnité pour dommages de guerre. Pour moi, c’était un handicap. Je me couchais en général vers minuit, mais j’étais réveillé chaque matin vers cinq heures déjà, car on préparait dans la cuisine les seaux contenant la nourriture pour les porcs.
Roppeviller était parfois coupé du monde. La route venant de Bitche s’arrêtait à la sortie du village, vers la forêt. Mais le comble, c’était quand elle était interdite à toute circulation en raison des manœuvres dans le camp de Bitche. Pas de boulanger ambulant, pas de boucher, pas de bus…Nous étions complètement isolés, le temps des manœuvres. Heureusement que personne n’avait besoin de médecin pendant ces périodes!
La dernière semaine de remplacement fut pour moi la plus pénible, car j’avais hâte de retrouver un monde plus civilisé. De plus, à chaque repas pris dans ma famille d’accueil, midi et soir, figurait le chou frisé ou chou d’hiver, le "Kéhl". Après cette "overdose", il n’est pas étonnant que de nos jours je n’apprécie pas tellement ce menu.
Début mars, je fus nommé au cours élémentaire 2 de l’école protestante de Sarrebourg. Cette école recevait aussi des enfants juifs et anabaptistes. Comme la classe commençait par une prière en Alsace-Moselle, il me fallut dès le départ composer une prière "œcuménique" qui ne choque aucune confession. Je soumis le texte de la prière au pasteur qui l’approuva.
Ensuite, il me fallut déterminer à quel stade du programme étaient les élèves. Les documents affichés n’étaient pas à la page, la programmation mensuelle datait du mois de novembre ! Les cahiers étaient presque vierges depuis novembre aussi. Après moult questions faites aux élèves, j’eus un aperçu assez vague de l’avancement des programmes me permettant le soir d’élaborer une progression dans les différentes matières.
Le lendemain matin, j’eus droit à la visite de l’inspecteur de Sarrebourg. Nous eûmes une longue discussion au sujet de la situation de la classe, puis l’inspecteur prit place au fond de la classe. Je n’en croyais pas mes yeux, il était donc venu pour m’inspecter et je n’avais pas préparé de leçons, car je voulais encore définir la situation exacte des élèves au moyen de quelques tests. L’inspecteur me sanctionna et baissa ma note. J’étais furieux quand je reçus le rapport d’inspection qu’il fallait à l’époque recopier trois fois.
Pendant toute la période de remplacement effectuée à Sarrebourg, j’eus beaucoup de déboires. Je prenais le train à six heures du matin à la gare de Kalhausen et ne rentrais qu’à vingt heures trente. A midi, je me contentais d’un repas froid. Le soir, avant de prendre le train pour rentrer, je me permettais de boire une bière au buffet de la gare et plus d’une fois, je me laissais tenter par un casse-croûte, car j’avais vraiment faim. Cela me revenait cher à la longue !
En février, j’avais passé la partie écrite du Certificat d’Aptitude Pédagogique (le CAP) et d’après l’inspecteur de Sarreguemines, je devais passer la partie pratique et l’oral après les grandes vacances seulement. Mais son collègue de Sarrebourg téléphona au directeur de l’école et ce dernier me fit savoir que je passerai ces examens très prochainement, dans trois ou quatre semaines. Malgré mes protestations, l’inspecteur de Sarrebourg maintint sa décision. J’étais coincé et je n’avais plus beaucoup de temps pour me préparer, car je voulais encore approfondir certains aspects de la pédagogie et surtout assimiler la législation scolaire.
Or, le directeur d’école m’avait demandé de préparer avec ma classe un spectacle pour la fête des mères. Un samedi après-midi donc, j’avais prévu de faire une première répétition avec mes élèves dans la salle des fêtes. Un collègue me prévint à midi que l’inspecteur passerait dans l’après-midi pour les épreuves du CAP. J’étais complètement paniqué, puisque j’étais pris au dépourvu : j’avais programmé pour ce jour, dans mon cahier-journal, la répétition du spectacle et non des leçons devant les élèves et…l’inspecteur. Tout ce que j’avais préparé en vue du CAP, tous mes documents étaient restés à la maison, et pour cause ! (17)
_______________
17) Le cahier-journal est essentiel pour tout enseignant. C’est un registre (cahier, classeur…) qui regroupe pour une même journée toutes les activités envisagées dans la classe, selon l’emploi du temps (leçons, exercices). On y inscrit également en fin de journée ce qui n’a pas été fait par manque de temps ou ce qui n’a pas été satisfaisant. C’est un journal de bord, consultable également par l’inspecteur.
A l’oral, l’inspecteur me posa la question suivante :
« Vous soupçonnez un élève d’avoir une maladie contagieuse. Que faites-vous ? »
Je lui répondis que je demanderai une attestation médicale certifiant qu’il est exempt de toute maladie.
« Ce n’est pas ce que je veux savoir. », rétorqua-t-il et j’échouai à l’examen…
Et, pour montrer à quel point il exagérait avec sa mauvaise volonté, je décidai de coincer l’inspecteur sur un point de mon rapport. Dans ce rapport, il avait noté que le programme de vocabulaire n’était pas assez explicite sur ma répartition mensuelle. Je profitai d’une conférence pédagogique pour débutants, tenue à Gosselming, où il avait son bureau, pour lui demander poliment de bien vouloir m’expliquer sa remarque. Il prit le fameux livre "Leterrier", qui donnait beaucoup d’exemples de pédagogie pratique, l’ouvrit à la page "vocabulaire" et me montra un exemple. Tout de suite, je pus l’attaquer, car il me montrait ce qui se rapportait au cours moyen, alors que j’enseignais dans un cours élémentaire. Je lui en fis la remarque.
« Ah oui ! Veuillez m’excuser. », fut sa réponse.
Et il chercha la page du cours élémentaire…pour y trouver justement ce que j’avais noté sur ma répartition mensuelle. Confus d’avoir eu tort, il marmonna que ma répartition devait être plus détaillée. Sur ce, je le quittai, écœuré de voir des supérieurs imbus de leur autorité et voulant toujours avoir raison. Heureusement le 13 juillet me libéra de cette atmosphère déprimante et les grandes vacances me changèrent les idées. La seule consolation de mon remplacement à Sarrebourg fut que mon spectacle musical de la fête des mères avait remporté un franc succès auprès des mamans.
Année 1951-1952
A la rentrée de cette nouvelle année scolaire, je fus nommé pour un remplacement à Obergailbach sur un poste que je devais théoriquement garder toute l’année. Après avoir pris contact avec le maire, j’entrevis encore une fois des difficultés pour me loger et me restaurer. Il fallait se débrouiller tout seul ! Avec l’aide de ma mère, je meublai le logement scolaire : lit militaire métallique de récupération, deux chaises, une table, un réchaud à gaz, plus tout ce qu’il fallait pour survivre. Il nous fallut aussi effectuer un nettoyage radical, surtout enlever une couche de deux centimètres de cadavres de mouches sur les rebords des fenêtres. Ma première nuit fut assez mouvementée car j’entendais continuellement des bruits de galopades de souris dans l’épaisseur du plafond. Le lendemain, j’accueillis quand même de bonne humeur mes nouveaux élèves dans la salle de classe : 43 garçons et filles de 6 à 14 ans ! J’étais bien servi, encore une classe unique ! Après avoir assigné une place à chaque élève, je constatai avec stupeur qu’il me restait trois enfants sans place assise ! J’appris par eux que des bancs scolaires "traînaient" quelque part. J’envoyai alors quatre garçons solides pour en récupérer deux et les ramener à l’école. A leur retour, stupéfaction, il manquait les pieds !
« Qui a de grands clous à la maison ? Qui a un marteau ? »
J’envoyai encore une fois deux garçons me ramener le matériel nécessaire. A leur retour, je me mis rapidement au travail et fixai aussi bien que possible les bancs estropiés aux autres, sous le regard intéressé des enfants. Soudain un grand calme se fit dans la salle et un invité surprise se joignit à nous, c’était l’inspecteur de Sarreguemines !
« Que faites-vous donc ?
- J’installe des bancs supplémentaires pour trois élèves en surnombre.
–Vous ne pouvez pas rester à Obergailbach, il n’y a pas de restauration sur place. Vous irez à Epping cet après-midi et le collègue de ce village vous remplacera ici. »
Or, c’était un camarade de classe. Il piqua une petite colère, je lui expliquai alors que je n’y étais pour rien et que la décision venait uniquement de l’inspecteur. Le soir, en revenant d’Epping, je partis à la recherche d’une personne qui pourrait déménager mes pauvres affaires et je m’installai dans mon nouveau poste.
A part la restauration sur place, je n’avais pas hérité beaucoup mieux : l’école et le logement scolaire se trouvaient dans des baraques, entre les deux coulait une fontaine munie d’une auge qui servait d’abreuvoir pour le bétail de tout le village. Je dus acheter une paire de bottes en caoutchouc pour pouvoir accéder à l’école par temps pluvieux. En hiver, je "crevais" de froid. Je corrigeais les cahiers, les pieds dans le four du poêle charentais que maman avait récupéré chez une tante. L’eau pour la toilette, que je gardais dans un seau à côté du fourneau, était complètement gelée le matin. Il fallait d’abord faire un bon feu pour dégeler le tout. Il est vrai, le bois ne manquait pas, car je recevais des chutes de bois de la part d’un menuisier du village qui habitait près de l’école. Par contre, en été, la chaleur était intenable dans les baraques.
C’est à Epping que je passai pour la seconde fois les épreuves pratiques du CAP. Je n’eus encore une fois pas beaucoup de chance, car, contrairement à beaucoup d’autres jeunes collègues, je n’ai pas été prévenu par un membre du jury de la date de l’examen et donc de la venue de l’inspecteur assisté de deux collègues. Mais peu importe, cette fois, j’obtins le diplôme qui me permettait de devenir stagiaire et par conséquent de ne plus avoir désormais que des postes à l’année.
Je prenais mes repas de midi et du soir au petit restaurant où j’eus la chance de rencontrer des gens de Sarralbe qui travaillaient pour la reconstruction : le chef des pompiers et Robert Port.
Vers le printemps, arriva à Urbach, annexe d’Epping, un jeune débutant, comme moi. Il s’appelait Pierrard et venait de Sarralbe. Il avait eu la chance d’avoir été prévenu pour son CAP. Je ne l’ai plus jamais rencontré par la suite et personne n’a pu me renseigner sur sa famille.
D’habitude, le mercredi et le samedi, nous nous rendions ensemble à vélo à la gare de Woelfling où nous prenions le train pour Sarralbe. Mais lors d’une conférence pédagogique, l’inspecteur avait fait une remarque sur la présence de deux instituteurs à vélo, sur la route, et cela avant la fin des cours. Nous étions bien sûr visés, c’était illégal, mais nous étions forcés de partir plus tôt de nos écoles pour ne pas rater le train et avoir une correspondance à Sarreguemines.
Tous deux, nous décidâmes alors, après l’hiver, de profiter du temps plus clément, et de ne plus prendre le train, mais de rentrer directement dans nos foyers à bicyclette.
Lorsque l’inspecteur vint pour le passage du CAP, il oublia son porte-documents dans ma classe. Je le lui rapportai un mercredi soir et j’en profitai pour lui demander l’autorisation de modifier les horaires scolaires de l’après-midi, c’est-à-dire de passer à 12h50-15h50 au lieu de 13h-16h. Cela nous permettrait de partir un peu plus tôt et d’être dans la légalité. Il accepta à condition de demander l’autorisation au maire, ce qui ne posa pas de difficulté. Désormais, nous étions en règle.
Un lundi matin, j’appris une triste nouvelle, la mort d’une élève. J’avais remarqué le samedi matin, qu’après la récréation, elle commençait à somnoler et même à s’endormir. Elle était décédée d’une méningite, selon les dires. Le soir, après la classe, je rendis visite à ses parents pour leur présenter mes condoléances et prier au chevet de la défunte. J’allai ensuite trouver le curé que nous fréquentions souvent, Pierrard et moi, pour faire des parties de cartes et déguster un bon verre de blanc. Par téléphone, j’avisai l’inspecteur et demandai l’autorisation d’assister à l’enterrement avec les élèves. Nous fabriquâmes des fleurs en papier blanc, en vue de les déposer au cimetière sur le cercueil. J’appris aussi aux élèves deux chants appropriés aux circonstances.
Les fenêtres de ma salle de classe ne s’ouvraient que vers l’extérieur et, en été, j’aurais bien voulu les ouvrir et fermer les volets pour avoir un peu d’ombre. Mais c’était impossible. Pendant plusieurs jours de forte chaleur, je faisais alors classe à l’extérieur, derrière une haie où il y avait un peu de fraîcheur. Vous voyez le "topo" ! Enfin arriva le 13 juillet. Ouf !
Mais auparavant j’avais avec un autre collègue organisé une sortie pédagogique au "Struthof", le seul camp de concentration situé en France. Celui-ci était encore dans l’état où les nazis l’avaient laissé. Impossible de décrire la stupeur des enfants lors de cette visite et surtout pendant les explications du guide. Comment des êtres humains ont-ils pu arriver à de telles exactions ?
Année 1952-1953
A la rentrée de 1952, je fus nommé à Goetzenbruck, en remplacement du directeur devenu professeur de CEG à Bitche (professeur d’enseignement général) et j’héritai du travail administratif de directeur, mais sans toucher l’indemnité attachée à la fonction. C’était une école à trois classes et mes collègues étaient des femmes. Entre nous régnait une bonne entente.
Goetzenbruck était le village natal de mon père et en plus, mon grand-père avait déjà exercé dans cette école, précisément dans ma classe ! Je logeais chez tante Rosa, la sœur de mon père, mais je prenais les repas de midi et du soir au restaurant. Comme il n’y avait pas de correspondance entre les trains venant de Sarralbe et ceux se dirigeant vers Bitche, je devais retourner à mon poste déjà le mercredi soir et le dimanche soir. Mais à partir du printemps, je ne partais que le lundi et le jeudi matin de Sarralbe, via Kalhausen, pour arriver à Wingen-sur-Moder où je prenais mon vélo pour faire le reste du trajet. Il y avait une montée de près de 8,5 km et je ne suis jamais arrivé en retard ! A l’époque, un fourgon spécial était à disposition des voyageurs, pour y déposer leur bicyclette.
J’effectuais deux fois par semaine des cours d’adultes à destination des jeunes ayant déjà quitté l’enseignement primaire, mais qui voulaient se présenter au certificat postscolaire. Ce travail était rétribué par la commune. Les cours ne duraient que jusqu’à fin février, mais ce fut pour moi un joli pactole de
12 000 francs que je reçus en mars. Malheureusement, cette somme me fut volée un peu plus tard, lors d’un bal de carnaval. Ma déception fut grande, car j’avais prévu d’utiliser l’argent dans le but d’acheter une bague pour Adrienne.
A la fin de l’année scolaire, les élèves me proposèrent de faire la cueillette de myrtilles pour financer la caisse de la coopérative scolaire. C’était une tradition dans le village. La récolte fut très fructueuse et les élèves me firent en plus cadeau d’un beau panier rempli de ces délicieux fruits. Toute la famille fut heureuse de cette aubaine.
Le sport pratiqué à l’école consistait surtout en des séances de football le mercredi après-midi. Mont but était principalement d’inculquer aux élèves l’esprit d’équipe et quelques-uns de ces jeunes devinrent de très bons joueurs.
C’est à regret que je quittai Goetzenbruck, après avoir remporté avec ma classe un très bon succès au brevet sportif et au certificat d’études. Ce remplacement m’avait procuré beaucoup de satisfactions : les élèves avaient eu une conduite exemplaire -cela facilita mon enseignement, le maire, qui était ingénieur à la verrerie, m’avait accueilli très amicalement, -il me fit même visiter son usine et m’offrit des boules en verre pour décorer le sapin de Noël.
Années 1953-1956
A la rentrée du 14 septembre, je fus nommé à Neufgrange. Sachant qu’à partir du 1er janvier, je serai nommé stagiaire et que je pourrai ainsi garder mon poste, nous décidâmes, Adrienne et moi, de nous installer dans l’appartement mis à disposition gratuitement par la commune (17). Enfin, j’allais avoir une vie familiale normale et ne plus devoir courir à droite et à gauche pour effectuer des remplacements dans le département. Nous étions équipés du juste nécessaire : cuisine et chambre à coucher.
__________________
17) Les communes sont tenues par la loi à fournir aux instituteurs un logement de fonction convenable. Si ce n’est pas le cas, elle doit leur verser une indemnité compensatrice. René s’était marié pendant les grandes vacances, comme c’était la coutume pour les enseignants, le 16 août 1952 avec Adrienne Schuster de Salzbronn.
Le maire était très accueillant et très soucieux de la situation de l’école du point de vue équipement. Lors de mon arrivée, je constatai que mon prédécesseur pratiquait la méthode Freinet (18). Il m’a fallu un certain temps pour me familiariser avec cette méthode pédagogique et acquérir une pratique suffisante. J’avais les garçons du CE1 au cours de fin d’études. Les élèves étaient tellement intéressés qu’ils restaient souvent très tard à l’école pour composer les textes à imprimer et graver sur linoléum les dessins destinés à illustrer les textes.
18) La pédagogie Freinet prend le contre-pied des modes éducatifs traditionnels, car elle place l’enfant au centre du projet éducatif. L’autorité magistrale et l’apprentissage par la répétition sont délaissés au profit d’une plus grande autonomisation. Le but de cette méthode est de permettre à l’enfant de développer ses capacités à son rythme ainsi que son esprit critique. Pas de stress, mais l’envie de progresser. Pas de contraintes, mais des activités intéressantes et créatives. Pas de compétition, mais une émulation et une collaboration enrichissantes. Pas de notes, mais des dialogues d’évaluations. Pas de punitions, mais des conseils, des exemples, du dialogue…et le jugement des autres enfants.
Les outils employés sont l’expression libre (prises de parole, textes, dessins, musiques, sculptures…), la coopération (échanges de savoirs, travail en groupe), la démocratie scolaire (règles de vie réfléchies, discutées et acceptées, apprentissage de la citoyenneté, responsabilisations, sanctions décidées par le conseil de classe…), le plan général de travail de la semaine mis en place avec le maître et le plan individuel où chacun écrit les tâches qu’il veut accomplir sur la semaine, les brevets de validation des acquis, les fichiers autocorrectifs, la boîte à idées installée au fond de la classe.
Selon Freinet, l’enfant trouve sa motivation dans sa volonté d’agir sur le monde et non plus de subir, dans son envie de répondre aux questions qu’il se pose et dans son besoin de communiquer, d’où l’utilisation de la correspondance scolaire interclasse, de l’imprimerie et du journal scolaire retraçant la vie des élèves.
Malheureusement, le nouvel inspecteur était très pointilleux et plutôt porté sur les anciennes méthodes. Je ne l’avais vu que de très loin, lors de la première conférence pédagogique tenue dans la salle de fêtes du lycée de Sarreguemines. Lorsqu’il vint me voir dans ma classe, je ne le reconnus pas et lui fermai la porte au nez, pensant avoir affaire à un représentant et arguant qu’il était interdit de déranger l’instituteur pendant les heures de classe. Plus tard, à sa seconde visite, il me rabaissa la note sous le prétexte que je ne respectais pas l’horaire, ni la répartition mensuelle ! (19)
______________
19) Chaque visite de l’inspecteur débouche sur un rapport d’inspection analysant les séances présentées par l’enseignant, la programmation mensuelle ainsi que le travail exécuté dans les différents cahiers ou classeurs et sur une notation de l’enseignant. La note obtenue est d’une importance essentielle pour la carrière de l’enseignant, car sa valeur influe sur sa titularisation et son avancement, et par conséquent, sur son traitement. Cette note est en principe assez basse en début de carrière, elle peut même être sous la moyenne. Au fur et à mesure des inspections, elle augmente souvent d’un demi-point ou d’un point. Si le rapport d’inspection est défavorable, la note peut baisser ou stagner. L’enseignant peut aussi contester le rapport pour raisons valables.
Actuellement, l’inspecteur annonce le plus souvent son passage dans la classe sur une période de plusieurs jours pour laisser à l’enseignant le loisir de préparer l’inspection.
Vers la fin de l’année scolaire, je fus convoqué à Rohrbach-lès-Bitche, comme beaucoup de collègues, en tant que correcteur au certificat d’études pour la dictée et les questions qui s’y rapportaient. Pour y aller, je n’avais guère le choix : il me fallait gagner Sarreguemines à vélo, le laisser à la consigne de la gare et prendre le train.
Toute la journée, l’inspecteur faisait la chasse aux instituteurs qui voulaient obtenir de leurs collègues, en avant-première, les notes obtenues par leurs élèves. Le soir arriva, les corrections étaient terminées, mais les résultats non encore publiés. Tous mes collègues étaient partis après 18 heures, dès la publication des résultats, mais les diplômes n’étaient pas encore rédigés. A 22 heures, j’eus fini avec ce travail fastidieux. La meilleure, c’était qu’il n’y avait plus de train pour rentrer ! Voyant mon désarroi, l’inspecteur proposa de me ramener à la maison. Oui, mais j’avais laissé mon vélo à la gare de Sarreguemines et je voulais le récupérer ! Je lui demandai alors de me ramener à Sarreguemines. Malheureusement, la consigne était fermée à cette heure et je dus rentrer à pied à Neufgrange où je débarquai vers minuit passé, le ventre creux depuis midi. Mon épouse, bien sûr, me réchauffa les restes du dîner.
Nous avions trois poules qui, en hiver, se plaçaient l’une derrière l’autre sur les perchoirs jouxtant le four du boulanger, notre voisin. Elles venaient pendant la récréation picorer les miettes tombées des goûters des élèves, et parfois bien plus ! Nous disposions ainsi d’œufs toujours frais.
A mon arrivée, j’eus droit de la part de la commune à trois stères de bois gratuits, livrés à domicile et déjà sciés (20). C’était du charme, bois très dur et au pouvoir calorifique élevé. Il était bien sec, car stocké à l’abri depuis deux ans déjà. Je commençai à le fendre avec une petite hache dont le manche se cassa rapidement. Un voisin me prêta alors une hache plus adaptée à ce travail, en me faisant remarquer que ce travail était plutôt réservé à de grands élèves. Je lui répondis que la législation scolaire interdisait aux scolaires ce genre d’activité. Mais je fis quand même appel à mes élèves pour monter le bois au grenier et je les récompensai avec du chewing-gum qu’ils apprécièrent immédiatement. A l’époque, ils n’étaient pas gâtés comme de nos jours.
______________
20) Les instituteurs de certaines communes avaient droit à des avantages en nature que personne ne leur contestait et qui étaient les survivances d’une époque où ils ne touchaient pas de traitement, mais étaient rétribués par les communes et les familles en biens de consommation. Les communes forestières leur livraient souvent du bois issu des forêts communales. Cette pratique a disparu de nos jours.
A l’époque, l’instituteur et le curé étaient considérés, à cause de leur savoir, comme les personnalités du village. L’instituteur remplissait souvent la fonction de secrétaire de mairie et était titulaire de l’orgue, à l’église paroissiale. Une ancienne coutume voulait aussi que l’instituteur et le curé reçoivent des biens de consommation de la part des paroissiens, surtout des cultivateurs (un morceau de viande lors du tuage du cochon et une certaine quantité de pommes de terre en automne). Les sœurs enseignantes ou infirmières profitaient aussi de cet usage.
Au printemps, j’entamai le bêchage du jardin. Là aussi, le voisin me fit remarquer que cela avait toujours été le travail des grands élèves. Il trouvait aussi normal qu’ils aillent remplir les seaux d’eau à la fontaine et nous les ramènent, dans notre logement, au 1er étage. Et quand il apprit que mon épouse était enceinte, il exigea des enfants qu’ils fassent tout ce qui pourrait être trop dur pour elle. Son refrain était :
"Les enfants doivent aide et soutien aux parents, au curé et à l’instituteur". Excellente éducation morale pratique ! (21)
______________
21) Les enfants des écoles étaient mis à contribution non seulement pour le "service" de la classe (nettoyage des tableaux, changement de l’eau du seau, approvisionnement du poêle à bois ou à charbon…), mais aussi pour les besoins plus personnels de l’enseignant (approvisionnement en eau pour le ménage, bêchage du jardin, stockage du bois fendu au grenier…) Ces "corvées", bien qu’illégales, étaient consenties de bon cœur par les enfants, car elles se faisaient pendant l’horaire scolaire et donnaient toujours lieu à de petites récompenses. Aucun parent d’élève n’aurait pensé s’opposer à de telles pratiques, bien sûr révolues actuellement. Je me rappelle d’un enseignant qui faisait bêcher son jardin par les deux "cancres" du cours de fin d’études, alors que les autres élèves étaient en cours.
A la rentrée de janvier 1955, je fis part aux enfants de la naissance de notre premier enfant, Chantal. Ils me posèrent plein de questions sur elle et je ne m’attendais pas à un tel intérêt pour le bébé. Toute la classe se cotisa pour acheter un cadeau pour elle. D’ailleurs, cette affection ne s’arrêta pas à ce geste. Au printemps, quand le bébé apparut dans les bras de sa mère, ils l’entouraient, le cajolaient. Cela dura jusqu’à notre départ pour Rech.
En janvier, il faisait tellement froid (- 30°) que je fus obligé de rapatrier mon épouse et le bébé à Salzbronn, chez les beaux-parents. Moi, je "crevais" de chaleur dans la classe, mais je frissonnais de froid dans le logement. Notre séparation dura une quinzaine de jours.
Un jour, un élève peu doué me présenta un texte libre (22). J’en fus un peu surpris. Sa lecture me fut assez difficile, car l’orthographe était parfois des plus fantaisistes. Il avait écrit, par exemple, "wécer", pour les toilettes. Le même élève m’affirma une autre fois, qu’un avion était tombé la nuit dernière dans la forêt, entre Neufgrange et Siltzheim. Je décidai d’aller faire une petite exploration avec la classe, dans le but de rédiger un article pour le journal scolaire vendu dans le village au profit de la coopérative scolaire. Mais malgré nos recherches, nous ne trouvâmes aucune trace d’un accident d’avion. Notre garçon avait dû rêver ou bien il n’avait pas eu envie de travailler en classe. En tout cas, la séance de football du mercredi après-midi fut supprimée pour rattraper les heures perdues.
__________________
22) Selon la méthode Freinet, chaque élève pouvait produire un texte, sur le sujet de son choix. Le texte libre peut être produit à des moments bien définis de l’emploi du temps, mais le moment d’écriture et le lieu d’écriture peuvent aussi être libres.
Année 1956-1957
J’obtins, sur ma demande, le poste de directeur d’école, à Rech où fonctionnaient deux classes. Le logement scolaire était mal agencé : la chambre à coucher se trouvait au 1er étage, alors que la cuisine et le salon étaient au rez-de-chaussée. Chantal, qui marchait maintenant, connut un grand succès auprès des filles de ma classe.
Le 6 juin 1957, à six heures du matin, naquit Damien (23). Il lui fallut du temps pour émettre le premier cri ! Mais il se rattrapa bien vite et largement ! Il pleurait continuellement et mon épouse était à bout. Pour la soulager, je le prenais avec moi, dans la chambre à coucher, pour les nuits du mercredi au jeudi et du samedi au dimanche. Ainsi, "ces dames" pouvaient dormir confortablement dans une autre chambre.
Quand mon épouse allait faire ses courses à mobylette, à Sarralbe, je corrigeais mes cahiers, tout en berçant Damien de la main gauche. C’était facile à dire, mais combien difficile pour la synchronisation des deux activités. Mon collègue et son épouse s’étonnaient de ces pleurs continus, mais aucune raison médicale ne put être avancée.
Dans une armoire qui renfermait nombre d’outils (mon prédécesseur était bricoleur), je trouvai un jour, un outil que je ne connaissais pas du tout. Mon beau-père, par contre, sut trouver son nom et m’expliquer son utilité : c’était un redresseur de dents de scie (24).
_________________
23) D’autres enfants viendront encore égayer le foyer : Dominique en 1958, Gisèle en 1962, Jacques en 1965 et enfin Nathalie en 1967.
24) René traduit le nom dialectal "Zòhnrìschder" par la définition "redresseur de dents de scie". Il s’agit en réalité d’un outil à avoyer ou d’une pince à avoyer. Les dents d’une lame de scie doivent être inclinées alternativement à droite, puis à gauche, pour que le trait de coupe soit plus large que la lame. Ainsi la lame d’une scie avoyée ne coince pas. L’avoyage doit se faire périodiquement. Parfois, les anciens frottaient la lame de scie avec une couenne de lard, le gras devant aider la lame à mieux glisser. C’est parfaitement inutile, si la scie est bien avoyée.
 |
 |
Outils à avoyer.
Dès le début de notre installation à Rech, l’abbé Goldschmitt, personnage très connu dans la région, m’invita, malgré mon manque de temps, à participer gratuitement à une sortie qu’il organisait pour assister à une opérette à Sarrebruck. Pour moi, qui avais entendu des fragments de cette opérette présentée par mon ancien professeur de musique Breuer du lycée de Sarreguemines, ce fut un spectacle délicieux et émouvant. Je remerciai bien sincèrement l’abbé Goldschmitt pour son invitation, mais j’ai complètement oublié le nom de l’opérette et celui de son compositeur (24).
_____________
24) Reproduction de l’article paru dans le Républicain Lorrain en août 2016.
François Golschmitt naît à Morsbach le 28 janvier 1881. Sorti de l’école primaire à 14 ans, il travaille quelque temps aux houillères puis entre en 1901 au collège Saint-Augustin de Bitche. Formé au grand séminaire de Metz, il est ordonné prêtre le 17 juillet 1910, à la cathédrale de Metz. En 1919, il est nommé curé de Rech. Il y officie jusqu’à sa mort en 1966.
Un érudit
L’abbé Goldschmitt a des connaissances en médecine et préconise l’usage des médicaments de Sébastien Kneip, homéopathe et prêtre bavarois. Pour les consultations, il envoie ses paroissiens à Sarrebruck, auprès du curé-homéopathe Wagner. Il lit beaucoup, y compris la mécanique. Il est trilingue : allemand, français et latin. Le curé Goldschmitt est aussi historien passionné par le passé de la Lorraine dialectophone. Les documents rapportant la vie de ce célèbre curé de Rech, évoquent "un excellent orateur populaire", "un homme d’une vivacité déconcertante". François Goldschmitt reconnaît lui-même qu’il est "trop bavard" mais ce "défaut" le rend très populaire. Il aime rire, plaisanter. Réfugié avec ses paroissiens en Charente, le curé de Rech se démène pour eux et favorise les contacts avec les accueillants. Petite anecdote : avant de partir sur les chemins de l’exode, François Goldschmitt laisse un petit mot aux Allemands. Ils peuvent vider le presbytère… mais ne doivent pas toucher à sa bibliothèque.
On apprend dans les archives que le curé avait "des opinions versatiles, sauf en matière de religion ou dans la lutte contre les ennemis de la religion et de la Lorraine. Paraissant tantôt pro-allemand, tantôt pro-français, tantôt favorable, tantôt défavorable aux autonomistes entre 1919 et 1940, le curé Goldschmitt affichera une attitude nettement francophile ce qui provoquera son arrestation par les Allemands et son envoi au camp de Dachau". Rescapé de la déportation, le curé Goldschmitt devient conseiller général divers droite en 1945 et le demeure jusqu’en 1956. Outre son activité politique, le curé rédige des fascicules sur les déportés et les internés. Il imprime lui-même ses ouvrages dans son imprimerie fondée dans les années 20, "le Colportage catholique".
De plus en plus myope, à partir des années soixante, pour ménager sa santé, le curé suspend son travail après le déjeuner pour se reposer pendant une heure. Le curé Goldschmitt s’éteint en 1966 à l’âge de 85 ans.
En octobre, je demandai ma mutation à Sarralbe, où un poste était libre à l’école de garçons. J’eus la chance de l’obtenir rapidement et facilement, mais je compris tout de suite pourquoi : c’était une classe de cours moyen 2 et de fin d’études. Ce dernier cours était principalement composé d’élèves avec un quotient intellectuel largement sous la moyenne et d’éléments au comportement agressif. Personne n’avait voulu de cette classe !
Ma salle de classe était installée au fond du couloir, sur la droite du préau. A l’entrée du couloir était fixée une gravure représentant des lions et j’exerçais mon métier dans "l’antre des fauves", comme me le fit remarquer un jour le directeur d’école.
Ce fut une période difficile, car j’avais hérité de grands gaillards très récalcitrants à l’effort. Lorsque je tombais malade, mon remplaçant en voyait de toutes les couleurs : il n’était pas "leur" maître et ils se permettaient beaucoup.
A partir du mois de mars, les élèves sélectionnés pour passer l’examen d’entrée en 6° et le certificat d’études restaient en classe jusqu’à 18 heures pour se préparer aux examens. Je leur faisais des dictées avec questions, des problèmes, du calcul mental, mais sans beaucoup de réussite. Ces cours supplémentaires n’étaient pas rétribués. Lors du certificat d’études, je piquai, devant l’inspecteur, une crise de nerfs à cause des résultats catastrophiques de mes élèves, mais il me consola, car il connaissait le niveau de la classe et les misères faites à mes prédécesseurs.
En plus, je devais, le jeudi, de 14 heures à 16 heures, donner des cours professionnels à des apprentis travaillant sur des métaux (cours de calculs professionnels et technologie). Ce travail supplémentaire me laissait peu de temps libre. Le jeudi matin, je corrigeais les rédactions, la plupart du temps, vides de sens et bourrées de fautes. C’était pour moi un travail fastidieux, une corvée, de devoir corriger toutes ces âneries débitées et cela me prenait plus de trois heures ! Cette correction, je l’abhorrais le plus !
Mais j’arrivais à mater la petite bande de futurs "truands", car, si leur conduite laissait à désirer, les matchs de football du mercredi après-midi étaient purement et simplement supprimés. A cette époque, le terrain se situait sur l’actuel site de Solvay (devenu Inéos).
Un jour, une circulaire du ministre de l’Education Nationale interdit de bloquer les heures d’éducation physique sur une demi-journée. Après mûres réflexions, je décidai de ne pas en tenir compte. Bien sûr, le directeur me contacta à ce sujet, mais je persistai dans mon refus, pour trois raisons :
- Primo, nous ne disposions pas de place suffisante pour jouer au foot dans la cour ou au gymnase.
- Secundo, le foot était le seul moyen que j’avais pour maintenir la discipline.
- Tertio, je voulais former ces jeunes à la pratique d’un sport collectif.
Suite au départ à la retraite d’un collègue, j’obtins, sur ma demande, une classe de cours élémentaire 2 et cours moyen 1, mais dans une baraque métallique située en pleine cour. En hiver, il y faisait si froid que l’encre était gelée le matin dans les encriers. En été, au contraire, il y faisait très chaud et je n’avais pas souvent la possibilité d’ouvrir les fenêtres, car les élèves du Collège d’Enseignement Général arrivaient dans la cour pour 14 heures et de plus, les heures d’éducation physique se pratiquaient aussi dans la cour, faute de place au gymnase. Ce calvaire dura un an et je fus le premier à déménager dans le nouveau bâtiment.
L’année suivante, j’eus la chance de ne plus avoir à charge qu’un seul cours, le cours élémentaire 1 et je m’installai au rez-de-chaussée. Mais des voyous s’amusaient à crier dans les grilles d’aération pour dissiper les enfants ou, pire, à faire éclater des pétards. Je gardai cette classe jusque quatre années avant mon départ à la retraite.
En 1979, je passai l’examen de directeur d’école qui consistait en un entretien avec une commission formée par des inspecteurs et des collègues directeurs.
Aucun programme précis n’était proposé. L’entretien pouvait porter sur la pédagogie, les lois scolaires, les programmes et le rôle du directeur en tant qu’animateur de la vie de l’école. Cet examen se passait au rectorat de Nancy.
Le jour de ma convocation, deux commissions siégeaient et nous étions une dizaine de candidats à attendre notre appel à comparution devant l’une des deux commissions. Pendant notre attente, une collègue sortit en pleurs de la salle. Que s’était-il passé ? Un membre de la commission lui avait posé la question suivante :
« Si je vous dis « dix », à quoi pensez-vous ? » Cette pauvre candidate n’avait pas pensé au système décimal et aux mathématiques modernes où l’on comptait en base 2, 3, 4 …et 10.
Quand mon tour arriva, j’entrai dans la salle et je fus immédiatement frappé par la grande table en forme de U qui trônait dans cette pièce immense. Autour de la table avaient pris place, sur les trois côtés, au moins quinze personnes des deux sexes. Je saluai bien poliment toutes ces personnes tout en m’excusant de ne pas pouvoir les nommer par leur titre, vu que le l’ignorais. Je fus prié de prendre place sur le fauteuil pivotant qui se trouvait au milieu du grand côté libre de la table. Et le départ fut donné !
« Quels droits vous acquiert la nomination de directeur ?
- Le droit de choisir la classe que je veux et celui de participer au mouvement de demande de poste dans tout le royaume de France et de Navarre.
- Bien. Vous exercez à Sarralbe. Dans cette école existe une cantine scolaire.
- Pardon, ce n’est pas une cantine, mais un restaurant scolaire.
- D’accord. Supposons que vous obtenez un poste de direction dans la banlieue de Nancy…
- Je n’en ai nullement l’intention, car j’ai construit à Sarralbe et j’y resterai jusqu’à la fin de ma carrière.
- Bon. Mais supposons quand même que cela soit. Vous voulez créer une cantine…
- Pas une cantine, mais un restaurant scolaire… (On cherchait à m’enfoncer !)
- Oui, mais le maire, arguant du manque de temps, vous charge de présenter un dossier d’études préliminaires. Comment concevez-vous
ce travail ?
- Tout d’abord, il faudra lancer une enquête auprès des parents d’élèves souhaitant bénéficier d’un tel équipement, faire participer le comité
des parents élus au conseil d’école, réunir le conseil d’école, penser aux locaux nécessaires, prévoir l’équipement, le nombre de personnes
à embaucher, les dépenses…
- Bon. A combien chiffrez-vous un tel investissement ?
- 10 000 francs. (Mais déjà, je fus interrompu.)
- Je ne vous souhaite pas devoir mettre le reste de votre poche.
- Mais je commence seulement à estimer le coût des casseroles ! Je n’ai pas fini de réfléchir et de toute façon, il est difficile de répondre immédiatement à votre question sans disposer de toute la documentation nécessaire. Il faut des catalogues… »
Puis d’autres questions fusèrent de tous bords. Je répondais calmement…et en fin de compte, je fus admis (25).
________________
25) Le rôle du directeur d’école est triple. Il a tout d’abord un rôle pédagogique (il veille à la diffusion des instructions et des programmes, il suscite des initiatives aptes à améliorer l’efficacité de l’enseignement, il met en œuvre le projet d’école, il organise et préside le conseil d’école…)
Ensuite, il a un rôle administratif (il veille à la bonne marche de l’école et au respect de la règlementation, il tient à jour les registres et l’inventaire, il transmet les documents administratifs et les dossiers…)
Enfin, il a un rôle relationnel (il anime l’équipe pédagogique, il veille aux bonnes relations avec les familles, il représente l’école auprès de la commune…)
Pour la rentrée 1979-1980, je fus donc nommé directeur de l’Ecole Mixte 1 de Sarralbe composée de 9 classes, dont 1 classe de perfectionnement, soit
211 élèves (26).
________________
26) Les classes de perfectionnement, créées en 1909, ont été remplacées en 1991 par les CLIS (classes d’intégration scolaire). Elles accueillaient des enfants atteints d’un handicap mental.
Le jour de la rentrée, le travail ne manquait pas : enquêtes et statistiques complexes à dresser. Dès le début, je trébuchai sur un sigle qui m’était inconnu (RPI). Et le téléphone de sonner : « Geisler, connais-tu ce sigle ? - Hélas, non ». C’était Schmitz, principal adjoint du CES, il l’ignorait aussi. Dans l’après-midi, il me téléphona et m’expliqua que cela signifiait : Regroupement Pédagogique Intercommunal.
En tant que directeur, je me fixai comme priorité la mise à jour de l’inventaire de tout le matériel scolaire de l’école. Ce fut un travail harassant qui occupa toutes mes vacances de Noël. Ensuite, je décidai de tout mettre en œuvre pour éviter les conflits parents d’élèves-enseignants, mais aussi entre les collègues eux-mêmes. Pour ce faire, j’assistais à toutes les réunions du comité des parents, puis je réunissais tous les collègues de l’école et je leur exposais les désirs des parents ou les problèmes soulevés. Je réunissais alors de nouveau le comité des parents pour leur exposer le point de vue des enseignants. Chaque réunion donnait lieu à un compte-rendu transmis respectivement à l’inspection, à la mairie et aux collègues et, bien sûr archivé.
Ensuite, j’élaborai différents règlements
- pour la surveillance (dans le but de sensibiliser les collègues sur leurs responsabilités en cas d’accident dans la cour)
- pour les sorties scolaires (à signaler obligatoirement au directeur, avec mention des mesures prises pour l’accompagnement et la sécurité)
- pour la pratique de l’éducation physique (dans le but d’éviter les accidents)
Avec le collègue de la classe unique d’Eich et la directrice de l’Ecole mixte 2, sous la direction du conseiller pédagogique en Education Physique et Sportive de Sarreguemines, j’organisai, pour toutes les écoles du canton, les manifestations sportives de l’année : course d’endurance au 1er trimestre, athlétisme au second trimestre et natation au 3ème. Cela demandait un travail conséquent pour l’organisation des séances, les comptes-rendus, les résultats et les classements, le tout sous le contrôle de l’inspection.
Il fallut aussi organiser les classes de découvertes (classes vertes ou classes de neige), suite aux demandes des parents d’élèves (27). Il fallait se soumettre aux dispositions légales très strictes en matière d’encadrement, de surveillance et d’objectif et toujours rendre compte à l’inspection. Je devais contacter le maire et son conseil municipal pour obtenir une subvention pour le séjour, mais aussi l’œuvre des pupilles dans le but d’avoir une aide pour les familles les plus indigentes (28). Ce n’était pas tout, les familles récalcitrantes, principalement les familles musulmanes qui ne concevaient pas la mixité, devaient être convaincues du bien-fondé des séjours. Au retour de la classe de découverte, il fallait aussi rendre compte aux parents par une exposition de photos, de dessins et d’articles écrits par les élèves.
__________________
27) La classe verte ou classe nature est un séjour de plusieurs jours ou plusieurs semaines à la campagne. Elle est surtout destinée aux écoles urbaines. Les enfants suivent le matin les cours traditionnels et découvrent l’après-midi le milieu, en participant à des activités de plein-air (équitation, randonnée, escalade, spéléologie, visites d’artisans et de fermes…)
La classe de neige est un séjour à la montagne. Les après-midis sont consacrés à la découverte du milieu et à la pratique du ski.
_____________
28) L’œuvre des pupilles de l’enseignement public (PEP) vient en aides aux familles en difficulté dans les domaines de la petite enfance, de l’éducation, des loisirs, du social et du sanitaire.
Que de démarches et de travail, souvent effectués en dehors des heures de classe pour arriver à ce que toute la classe participe, sans exception, à de tels séjours, ce qui était la condition obligatoire, selon les dispositions légales!
Pour les autres classes, j’organisai des sorties éducatives à but pédagogique, souvent d’une journée, ce qu’on appelait plus couramment des excursions. Incroyable aussi les contraintes inhérentes à ces sorties : encadrement des élèves selon leur âge et leur nombre, précision sur les buts pédagogiques recherchés, financement par des sources diverses…
Le dernier jour de classe, je poussai un immense ouf de soulagement, bien content qu’il n’y ait pas eu de problème durant l’année scolaire et plus particulièrement lors des classes transplantées et des sorties.
J’eus pourtant à déplorer un accident survenu à un enfant arrivé récemment de Turquie. Il s’était cassé la jambe pendant la récréation. Je fis appel à un médecin qui confirma mon soupçon de fracture, puis téléphonai aux pompiers pour le transport à l’hôpital. Il me fallut encore avertir les parents, mais je n’arrivais pas à les joindre. Je demandai alors à de grands élèves habitant dans le voisinage de la famille turque, de les avertir dès la fin des cours. Je décidai de confier la surveillance de ma classe au collègue de la classe voisine et accompagnai l’ambulance avec en main la fiche de renseignements fournie au début d’année scolaire par les parents. Je me devais de fournir aux urgences de l’hôpital toutes les coordonnées concernant le blessé et surtout d’avertir le service que l’enfant ne parlait, ni ne comprenait le français.
En 1984, je décidai de prendre ma retraite, même si je n’avais pas encore atteint l’ancienneté nécessaire pour une retraite à taux complet. Mais, avec six enfants, je pouvais bénéficier d’une certaine augmentation, ce qui compensait les années manquantes. Il y a un temps pour tout et il faut savoir s’arrêter. Je pensais qu’un collègue de l’école allait postuler pour la direction, mais comme il avait déjà goûté aux "joies de la direction", pendant mes absences dues à la maladie, il savait ce qui l’attendait et n’a plus eu envie de me remplacer. Ce fut une institutrice de Puttelange qui prit ma succession.
Je veux terminer ma biographie par une courte conclusion en forme de réflexion, à destination de mes petits-enfants. Dans tous les métiers, vous vous trouverez confrontés à des situations que l’école, le collège ou le lycée ne vous auront pas appris à résoudre. Les connaissances acquises pendant la scolarité ne sont que la base de votre future profession. Le savoir évolue rapidement et vous serez constamment amenés à vous recycler, à vous remettre en question, et cela de plus en plus dans notre monde actuel. Dans tout métier, ne s’épanouissent et ne réussissent que ceux qui vont de l’avant, qui ne se reposent pas sur leurs lauriers. Donc, comme le dit la fable, "Travaillez, prenez de la peine ! " et soyez prêts à le faire durant toute votre vie (29).
__________________
29) René s’est éteint le 20 avril 2014, à l’âge de 86 ans.

Avec ma nièce Nathalie.
Quelques photos encore…
 Ma mère et Yvette Mon frère Armand |

Photo de famille à l’occasion de la grande communion d’Yvette, en 1947.
Ma mère est à l’extrême droite.

Ma mère met de l’ambiance au restaurant.

Yvette et moi, entourant notre mère.

Photo de famille devant la maison de Hutting.
Juin 2018. Gérard Kuffler