La boucherie de Kalhausen
Un peu d’histoire
L’histoire de la boucherie commence avec Jean Nicolas Muller, boucher, laboureur, né le 2 février 1799 à Achen. Il épouse, le 22 novembre 1830, Anne Freiss de Kalhausen (13 septembre 1803-26 février 1875). Jean Nicolas décède le 22 octobre 1884 à Kalhausen. C’est peut-être lui qui exerce son commerce à la "Rùtsch", dans l’ancienne maison Nicolas Pefferkorn. C’est de là que vient le nom de maison "Rùtschersch", qui se transmettra à sa descendance.

L’ancienne maison Muller, puis Nicolas Pefferkorn, de rood Nìggel, actuellement Joseph Ferner.
Des carrières de pierres calcaires sont exploitées à Etting, au niveau du val d’Achen et de nombreux attelages passent devant la maison qui a été construite précisément là. Les charretiers s’arrêtent un moment pour boire un coup et Jean Nicolas fait ainsi office de cabaretier.
Mais la maison est isolée, loin du village et son implantation n’est pas idéale. Les Muller décident alors de faire construire une nouvelle maison en 1867, dans la rue des jardins, "ìm Hohléck", à une centaine de mètres du centre-village.
C’est le fils de Jean Nicolas, Florian Muller (21 août 1838-2 novembre 1892) qui s’y installe. Il y développe une activité de boucherie, mais aussi de restauration.
 |
 |

Etat actuel de la maison acquise par Joseph List et Odile Simonin,
propriété de leur petit-fils Stéphane.
Florian a un frère plus âgé, Nicolas Jean, né en 1833, qui épouse Anne Marguerite Muller, née en 1843. Ils ont 11 enfants, ce sont les artistes verriers réputés, appelés couramment les frères Muller, qui ont exercé leur activité à Croismare, près de Lunéville.
 Les frères Muller avec leurs parents. |
 Les frères Muller au travail. |
 |
 |
 |
Quelques unes de leurs réalisations.
Le fils de Florian, Nicolas Muller (24 mars 1879-25 août 1951) épouse Anne Catherine Fabing (26 février 1885-14 novembre 1961), la fille du boulanger de Kalhausen, Nicolas Fabing, appelé de Bägger Nìggel.

22 avril 1907.
C’est lui qui fait construire, rue de la gare, de l’autre côté du ravin de la "Kluus", une boucherie plus spacieuse combinée à une partie exploitation agricole et qui donnera à l’affaire un élan certain. Il y vivra avec son frère Jean, également boucher et homme à tout faire de la maison
(19 mai 1875-7 novembre 1950). Le couple aura 9 enfants, dont 4 filles survivront.

Au premier plan, le parapet du pont privé sur le ravin de la Kluus.

Nicolas Muller.

Les filles Muller, Catherine Fabing, Jean et Nicolas Muller,
Charles Demmerlé (de Eddinger Kàrl) et le petit René Laluet.

Nicolas et Catherine, avec leurs filles.
L’aînée des filles Muller, Anne (30 mars 1909-11 juin 1988), épouse le 3 septembre 1934, Jacques Laluet, chauffeur, originaire d’Etting
(23 mars 1904-3 janvier 1945).

Deux autres filles épousent aussi chacune un boucher : Marie, prend pour époux Charles Schaeffer, de Sarreguemines, et Denise s’unit avec Emile Lenhard, de Kalhausen.
Jacques Laluet est chauffeur de métier, il va apprendre maintenant le métier de boucher et investir dans des moyens de transport modernes : une voiture familiale et une bétaillère.
Il connaît malheureusement une fin tragique au mois de janvier 1945, tué par un éclat d’obus pendant l’offensive Nordwind déclenchée par les Allemands, laissant une jeune veuve de 35 ans et trois enfants âgés de 9 ans, 7 ans et 3 mois.
 |
 Croix érigée rue des jardins en souvenir de Jacques Laluet. |

Jacques Laluet, ses beaux-parents et les filles Muller.
La Renault Vivaquatre familiale de Jacques Laluet est la première voiture automobile du village. Cette voiture rendra de grands services pendant l’évacuation de septembre 1939 en transportant les personnes impotentes du village au lieu d’embarquement dans le train à Réchicourt-le-Château.
De retour à la maison, Jacques Laluet la remisera dans la grange, derrière un grand tas de bois, dans l’espoir de la retrouver au retour de l’évacuation.
Anne Laluet, jeune veuve, épouse en secondes noces, le 14 septembre 1948, Joseph Meichel, boucher, né le 28 mars 1908 à Rech-lès-Sarralbe. Ce dernier lui donnera encore un enfant, Bernard, né le 20 août 1949. Mais Joseph décède prématurément le 12 août 1953. Bernard apprendra aussi le métier de boucher et travaillera un moment à la boucherie familiale.
Après le décès de son premier mari, Aloyse Taesch, originaire de Kalhausen, seconde, pendant de nombreuses années, la malheureuse Anne.

Sur le banc, Anne et Joseph Meichel. Aloyse Taesch est à droite.

Le petit Gaston Laluet avec son père.
Derrière la génisse, Paul Kihl, contrôleur de viande (Flèèschbeschauer).
Tout à droite Nicolas Muller.
Le second fils de Jacques Laluet, Gaston, né le 21 juillet 1938, reprend la boucherie en 1969 avec son épouse Marie Thérèse Kimmel d’Etting.

En 1999, la boucherie Laluet se transforme en Sàrl, Société à responsabilité limitée Laluet et fils. Le fils cadet, Jean Jacques, né en 1975, en prend la gérance. Un nouvel essor est donné à l’affaire et bientôt la place commence à manquer, d’autant plus qu’une activité "Traiteur" s’est rajoutée à celle de la boucherie.
 |
 |

Trois vues de l’ancien laboratoire de production.
Le commerce de bêtes s’est arrêté depuis longtemps, la vente au détail s’effectue toujours dans l’ancien magasin et les trois camionnettes aménagées font leur tournée, deux fois par semaine.
Les tournées bihebdomadaires sont les suivantes :
- mardi et vendredi : Herbitzheim et Keskastel - Dieding et Wittring – Montbronn
- mercredi et samedi : Etting – Achen - Voellerdingen, Oermingen et Schmittviller
Mais l’activité "Traiteur" est à l’étroit. Les deux chambres froides sont trop petites, il faut moderniser, aggrandir.
 |
 |
 |
 |
Quatre vues de l’ancien magasin de vente.

Vue d’ensemble de la boucherie avant les transformations.
La société Laluet et fils décide de tout chambouler et d’entreprendre de grands travaux de transformation.
Une nouvelle boucherie, moderne, fonctionnelle et pratique, avec rail de déchargement, comprenant un espace « Traiteur », voit le jour en 2011-2012.
Les anciens bâtiments, rue de la gare
La boucherie Muller, a été construite en 1925 sur un terrain s’étendant de part et d’autre de la rue de la Gare et coupé par le ravin de la Kluus. La maison, bâtie sur la rive droite du ravin, a nécessité la construction d’un pont privé, directement à côté du lavoir. Sur la rive gauche, en face de la boucherie, s’étend un petit verger, qui fait aussi partie de la propriété.
La maison présentait à l’origine la disposition traditionnelle de la maison de laboureur : travée habitation à droite (magasin de vente, cuisine, chambres), travée agricole à gauche (deux étables entourant la grange, et le fenil). A l’arrière de la grange se trouvaient l’abattoir, le laboratoire et le fumoir. Une petite chambre froide tardive, accolée au pignon droit et partagée en deux parties, abritait à l’avant les produits de charcuterie et à l’arrière la viande.
Les éléments qui différenciaient la boucherie de la maison paysanne traditionnelle étaient la grande vitrine du magasin de vente et surtout le balcon en béton sur piliers qui surplombait l’escalier de la porte d’entrée et qui donnait au bâtiment un air bourgeois.
Une élégante frise festonnée en bois remplaçait la corniche sous toiture et des aérateurs aux formes originales égayaient la partie agricole.
Le chien assis du toit est tardif et correspond à la salle de bain aménagée dans les combles.

Années 1970. Les étables ont déjà été transformées. Un petit jardin d’agrément
s’étend devant la boucherie. La chambre froide est visible contre le pignon.
Une élégante gloriette en fer ornait le jardin de fleurs devant la maison et permettait de trouver un peu d’ombre en été.

L’activité de la boucherie ne se limitait pas au commerce de la viande, mais englobait également une activité agricole d’élevage et un commerce de bestiaux. D’où la présence des étables et du fenil.
Chaque lundi avait lieu dans la cave la grande lessive effectuée par 5 à 6 personnes, dont entre autres l’aide ménagère Catherine Semré et Elisabeth Demmerlé, appelée Hènnrische Lissa, plus tard Monique Philipp et Angèle Schmitt. Ce sont surtout les tabliers des bouchers qu’il fallait laver, avec également le linge de toute la famille. On faisait tremper le linge sale dès le samedi dans une bassine et puis on chauffait le tout le lundi dans une lessiveuse à foyer au bois. Ensuite il fallait frotter pour enlever les taches de sang. L’eau de rinçage était pompée depuis le lavoir tout proche dans un bac en béton spécialement aménagé. Le linge essoré était enfin accroché aux fils dans le verger en face de la boucherie.

Le bac de lavage.
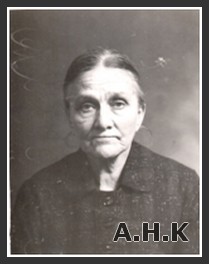
Catherine Semré, de Gòòdo, était née le 19 novembre 1874 à Schmittviller.
Elle avait été engagée par Nicolas Muller et faisait quasiment partie de la famille jusqu’à sa mort après la guerre.

Monique Philipp (1932-2004) fut d’abord aide ménagère à la boucherie
avant d’épouser en 1959 l’aîné des fils Laluet, René.
Des transformations sont intervenues au fil du temps suite à l’évolution de l’activité bouchère.
L’étable de droite a été transformée en laboratoire, l’autre sert de garage, tout comme la grange. Un appentis servant aussi de garage a été rajouté sur la partie gauche de la maison, pour les camionnettes de tournée. Une seconde chambre froide a été rajoutée à l’arrière de la grange. Le chaînage d’angle en grès a disparu sous le crépi.

Travée habitation avec la vitrine du magasin au fond.

Travée agricole réaménagée en laboratoire et garages.
A l’étage, fenil inutilisé.
L’activité agricole au lendemain de la guerre
Elle est forcément réduite et se limite à l’élevage de trois vaches, dont le lait est consommé dans la famille, changé en fromage blanc et transformé en crème au moyen d’une écrémeuse.
Un hectare de prairies est consacré à la production de foin et de regain pour les bêtes. Une vingtaine d’ares est vouée aux betteraves fourragères et aux pommes de terre.
Comme la boucherie ne dispose pas d’animaux de trait, c’est un agriculteur du village, Joseph Greff, qui effectue avec ses chevaux tous les travaux culturaux comme le labour, le fauchage et les transports. En contrepartie, il a droit à la moitié de la récolte.

Joseph Greff (1902-1990).
Deux petites parcelles de vergers sont encore disponibles dans les cantons Rosengarten et Freygarten. Le bétail loge dans l’étable de droite. Une déchargeuse à griffe sera installée plus tard au fenil pour faciliter le déchargement de la récolte de foin.
L’activité bouchère après la guerre
La vente de viande de boucherie était limitée, car de très nombreux foyers élevaient, pour leur consommation personnelle, un ou deux porcs dans l’année. C’est surtout la viande bovine qui était proposée au débit, on en consommait principalement le dimanche et surtout le jour de la Kirb.
De nombreux élevages de petits animaux existaient encore au village, également pour la consommation personnelle : caprins, lapins et volailles.
La saucisse la plus couramment vendue et aussi la plus souvent cuisinée par les mères de famille avec les légumes était la saucisse à cuire, le Kochwùrscht.
Pour les bouchers, la répartition du travail hebdomadaire était toujours la même. Le lundi, on allait chez les éleveurs au moyen de la bétaillère et on rapatriait à la boucherie les bovins destinés à être tués, puis on les sacrifiait dans l’abattoir de la boucherie.
Le mardi, on découpait les carcasses et on fabriquait la saucisse.
Le mercredi, on effectuait les tournées dans les villages environnants.
Le jeudi, on finissait de découper les carcasses conservées dans la chambre froide.
Le vendredi, on refaisait de la saucisse et le samedi une seconde tournée était effectuée dans les mêmes villages.
En automne, au moment de la Kirb, et pendant tout l’hiver, un travail supplémentaire se rajoutait au travail normal : l’abattage à domicile des cochons pour les particuliers. Certaines familles faisaient tuer jusqu’à 3 ou 4 porcs par saison. L’abattage proprement dit commençait vers les 7-8 heures et se poursuivait jusque vers 17 heures. Ensuite commençait la découpe de la viande, le tout arrosé par maint verre de Schnàps.
Les journées étaient longues et il fallait avoir de l’endurance dans le travail et la consommation d’alcool. Il était très impoli de refuser le verre proposé par l’éleveur. Ce travail se faisait le plus souvent à deux : Aloyse Taesch, engagé comme boucher après le décès tragique de Jacques Laluet en janvier 1945, et le jeune Gaston Laluet.
Les bêtes sacrifiées provenaient des élevages familiaux du village même et des villages environnants. Les petites bêtes, porcs et veaux, étaient pesées sur la bascule, une fois arrivées à la boucherie. On plaçait les porcs sur la bascule, dans une cage ajourée faite de lattes de bois. Les veaux étaient placés, sur la bascule, dans une grande corbeille en osier, "e Schbrìerekòrb", ou directement sur le plateau de la bascule, s’ils étaient plus grands, mais on leur liait les pattes pour qu’ils ne bougent pas.
Les grandes bêtes comme les bovins étaient achetées après une estimation sur pied. Le boucher n’avait pas intérêt à se tromper de beaucoup dans l’estimation du poids de la bête, par rapport au prix qu’il proposait. Cet exercice s’apprenait sur le tas, par la pratique, et Aloyse Taesch en était un spécialiste.
Les veaux étaient vendus au boucher assez rapidement et leur poids vif pouvait aller de 65 à 90 kg. Actuellement ils sont gardés plus longtemps sous la mère et leur poids est plus conséquent.
Pour une bête de 100 kg de poids vif, la proportion de viande de boucherie est de 60 kg (60%), le restant, 40 kg représente la peau, les viscères et les os (40%).
L’abattage s’effectuait à la boucherie jusqu’en 1970, soit à peu près à la période où Gaston Laluet et Marie Thérèse Kimmel ont repris l’activité (1969).
Un treuil à manivelle permettait de soulever la carcasse pour finir la découpe de la viande.
Une partie des os était emmenée en tournée et distribuée gratuitement pour les chiens de certains clients. Le reste était conservé dans une caisse en bois placée contre le pignon de l’appentis, jusqu’à ce qu’on vienne les chercher. Cela pouvait durer une semaine ou deux et provoquait souvent de fortes odeurs, surtout par temps chaud.
Les peaux des bovins étaient salées et récupérées ensuite par une entreprise de Haguenau.
Les viscères étaient enfouis dans le tas de fumier situé à gauche de la boucherie et pourrissaient sur place, à moins qu’un chien errant du village ne vienne les déterrer et s’en régaler, ce qui arrivait fréquemment.
Le résidu de sang, après la fabrication de boudin, était déversé directement, et personne ne disait rien, dans le petit ruisseau qui coulait dans le ravin de la Kluus passant devant la boucherie.
Pendant la guerre, les Allemands utilisaient la boucherie deux jours par semaine pour leurs besoins personnels. Ils avaient parqué un certain nombre de bovins dans un pré de la rue de la gare et tuaient chaque lundi 3 à 4 bêtes. Le jeudi, ils faisaient de la saucisse.
Les chevreaux étaient tués dans le village par Nicolas Dier, de Schääffer Nìggel, berger de métier, qui rentrait le samedi pour repartir le dimanche.
Les tournées
La bétaillère Citroën U 23 servait à transporter les bêtes, mais aussi à effectuer les tournées.

La bétaillère de la boucherie avait les ailes avant aplaties.
Les tournées s’effectuaient dans les villages voisins dépourvus de boucherie, comme Achen, Etting, Schmittviller et Wittring.
A cet effet, il existait des dépôts chez les particuliers. C’était une simple pièce louée et qui servait de boucherie-dépôt de vente, deux fois par semaine. Ces dépôts étaient approvisionnés par bétaillère. On plaçait les morceaux de viande, pour la manutention et le transport, dans des corbeilles en osier garnies d’une serviette à carreaux. On embarquait aussi une balance d’épicier qui servait pour les transactions.
Sur le chemin vers les dépôts, des haltes étaient prévues pour servir certains clients. Le service se faisait alors par la petite porte latérale de la bétaillère.
Dans les dépôts se trouvaient une simple table pour y poser la balance et un "tripier", une sorte d’étagère à barres où on pouvait accrocher les morceaux de viande pour les mettre en évidence et supprimer la superposition dans les paniers.
La saucisse à cuire devait être livrée dès le mardi dans les épiceries des villages approvisionnés : chez Schoonasch à Etting, à l’épicerie Jung d’Achen, à l’épicerie Niederlender de Wittring. Il fallait donc que quelqu’un se déplace spécialement dans ces villages pour y déposer la fameuse saucisse. Ce travail revenait à un jeune ; le plus souvent c’était Gaston qui s’y collait, à vélo et le sac à dos bourré de saucisses. Cela pouvait aussi être Adolphe Lenhard qui travaillait à la boucherie.
Les dépôts se trouvaient
- à Wittring, dans la rue principale, chez "Finnsche", plus tard à l’épicerie Niederlender
- à Achen, chez Gunther- Jung Stanis
- à Etting, chez Anne Seltzer (’s Sàdler Ònna), plus tard à l’épicerie Schoonasch et chez Joséphine Rimlinger (Schwàrz Nìggels Schossfinn)
Quand des camionnettes de tournée furent utilisées plus tard, ce système des dépôts fut aboli et des haltes furent instituées tout au long du parcours.
La boucherie disposait aussi d’un grand traîneau à cheval, "e Schlìdde", qu’elle utilisait en hiver sur les routes enneigées pour ravitailler les villages voisins.
Plus tard une camionnette 1000 kg Renault Galion, aménagée avec un volet latéral ouvrant, servira pour les tournées. Elle sera remplacée ensuite par une Citroën de type H, appelée à tort "Tub".

Camionnette Renault Galion.

Citroën Tub.
Le commerce de bêtes après la guerre
Le dernier volet de l’activité de la boucherie était l’achat de bêtes chez les particuliers et la revente à des abattoirs situés, soit à Sarrebruck (viandes en gros Michaeli), soit à Strasbourg (Moschel). Parfois l’on allait aussi à Metz, pour les porcs trop gros.
Le transport sur Sarrebruck se faisait par wagons, avec embarquement des bêtes à la gare de Kalhausen. Les autres transports s’effectuaient par bétaillère.
En général, le lundi était réservé au rassemblement des bêtes, elles étaient déchargées dans l’étable de droite, nourries et abreuvées.
Le lendemain matin, très tôt, il fallait les charger dans la bétaillère, en vue du transport. On y mettait pêle-mêle 25 à 26 porcs, 4 ou 5 veaux et parfois aussi des vaches, selon la place disponible. Les bêtes étaient serrées, secouées et tombaient souvent. Il fallait s’arrêter plusieurs fois en route pour contrôler l’état du chargement et voir si aucune bête n’était en danger de mourir étouffée sous les autres. Souvent les veaux étaient couchés sous plusieurs porcs qui les écrasaient.
Les arrêts se faisaient à Sarre-Union et plus loin, à Saverne, après la descente du col et ses nombreux virages.
La nouvelle boucherie construite en 2011-2012

A gauche, le garage et la porte "Traiteur". L’ancien magasin de vente a été transformé en salon.
La boucherie Laluet est actuellement à la 6° génération.
Les bovins sont achetés chez les éleveurs de la région et mis dans un parc, pendant plusieurs mois, dans l’attente de leur conduite à l’abattoir. C’est l’un des fils, Denis, né en 1970, qui s’occupe de la partie "Elevage" : soins aux bêtes, fenaison, vêlage...

Les hangars destinés à abriter la récolte de foin, les bêtes en hiver et les machines.

Denis, Gaston, Jean-Jacques et son épouse Marie-Noëlle.
Cette activité d’élevage s’arrête avec le décès de Denis en 2017. Désormais les bêtes sont directement chargées chez les éleveurs et menées à l’abattoir, chaque semaine.

(Photo Google maps)
La nouvelle boucherie dispose désormais de locaux vraiment fonctionnels et vastes, d’un laboratoire bien aménagé où travaillent cinq bouchers, d’un ensemble de pièces annexes réfrigérées destinées au stockage de la viande et des produits fumés, d’une plonge, d’une grande pièce de congélation, d’un fumoir, etc.
Récemment, avec l’épidémie de la Covid, comme les clients doivent attendre leur tour à l’extérieur du magasin, une grande tente a été installée dans la cour pour permettre de patienter à l’abri des intempéries.


De gauche à droite, la porte "Traiteur ",
la porte du local des poubelles et celle de déchargement
de la viande avec le début du rail de transport.
 |
 |
Deux des camionnettes de tournée.
Le magasin de vente




Vincent, Laetitia et Marie-Noëlle.
Le nouveau magasin de vente est bien plus spacieux que l’ancien, beaucoup plus achalandé et surtout accessible de plein pied.

Les anciens, Marie-Thérèse et Gaston.

Marie-Thérèse avec sa fille Laurence et sa belle-fille Marie-Noëlle.
Le laboratoire



Le nouveau laboratoire est aussi plus spacieux que l’ancien et surtout plus fonctionnel, avec le rail de transport.
La partie traiteur

Le marbre et la machine à mettre sous vide.

La gazinière, la braisière, les friteuses et le four-vapeur.

Le four-vapeur et les deux fours électriques.

Gérard Kuffler
Avril 2022
Un grand merci à Gaston Laluet, pour ses nombreux renseignements.
+ Gaston Laluet est décédé le 7 octobre 2023 à l'âge de 85 ans.