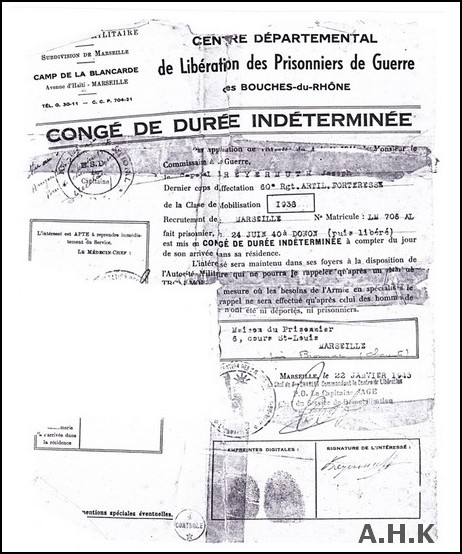Joseph FREYERMUTH
LA VIE d’un PATRIOTE

Joseph Charles FREYERMUTH, né à ACHEN le 09 mai 1918, fils de Jean FREYERMUTH et de Madeleine DEHLINGER, était le 6e enfant d’une fratrie de 9.

Les époux Jean FREYERMUTH - Madeleine DEHLINGER et leurs enfants.
Joseph est au second rang entre les parents.
Joseph est au second rang entre les parents.
Joseph a été scolarisé à l’école communale d’ACHEN de 1924 à 1932 et dès son enfance était passionné d’agriculture.
A la fin de sa scolarité, en juin 1932, Joseph trouva tout naturellement à s’occuper dans l’exploitation familiale de ses parents et le voilà donc plongé dans les travaux agricoles. Les hivers 1932/1933 et 1933/1934, il les a passés à l'école d'agriculture de SARREGUEMINES, où il devait se rendre tous les jours en train après avoir rejoint la gare de KALHAUSEN à vélo.
L’ENTREE DANS LA VIE ACTIVE
1934 sera une année charnière pour lui, il va entrer dans la vie active, affronter la dure réalité du monde des adultes.
Laissons maintenant Joseph nous raconter la suite :
« C’est durant cette année que notre maison familiale fut agrandie. Mon père, artisan maçon, et son co-équipier "SCHÒNG" de SINGLING se mirent à l’ouvrage pour rehausser la bâtisse en construisant le 1er étage.
Avec mes 16 ans, j’ai participé activement à ces travaux, j’ai monté une bonne partie du mortier, grimpant sur l’échelle avec sur mes épaules, un "Schbàtz " contenant 5 à 6 pelles de mortier (Cet outil de maçon, appelé "oiseau" est constitué de planches assemblées à angle droit. Deux manches permettaient de le porter sur les épaules).

Oiseau de maçon
(Photo internet)
En automne, l’heure a sonné pour mes débuts sur les chantiers de la ligne Maginot. Le 1er octobre 1934, je fus embauché par l’entreprise SAINT RAPP et BRISE et affecté comme commissionnaire à ROHRBACH. Je m’y rendais à vélo.
De par mes diverses tâches, je me rendais sur les différents sites des grandes casemates du coin, d'ACHEN jusqu’à GUISING. Or, un jour, au Bloc 10 du "Rohrbacher-Kopp", dans la pénombre du couloir, je n’ai pas vu que le trou destiné au monte-charge n’avait pas été recouvert de planches. J’y suis tombé, me retrouvant du coup 3m50 plus bas, étalé sur les planches de coffrage d’où pointaient plein de clous. Par chance, je me suis relevé avec uniquement une égratignure au menton.
Je gagnais 1,50 F de l’heure alors qu’un ouvrier avait 2 à 2,50 F. Cependant, en fin de mois, la différence était minime. L’entreprise avait plusieurs chantiers, ainsi qu’un dépôt à ACHEN dans la "Fréschgàss" (actuellement maison Raymond JUNG) et moi, je pouvais prétendre à pas mal d’heures supplémentaires car je m’arrangeais pour qu’au retour, le soir, et à l’aller le matin, je sois chargé de commissions pour le dépôt d’ACHEN, ainsi mes temps de trajet étaient également payés.
Cependant, cela ne dura pas, car un certain DAHLEM de ROHRBACH occupant le même emploi que moi et ne gagnant qu’un franc de l’heure eut vent de mon salaire horaire et alla réclamer. Au lieu d’augmenter ce dernier, la direction décida de m’aligner sur le DAHLEM. Je n’ai pas accepté cette baisse et j'ai donné ma démission le 07 juin 1936.
L’arrivée au pouvoir du Front Populaire provoqua une grève générale, qui dura de juin à fin septembre 1936. Il n’y avait pas d’activité salariale durant cette période, mais j’ai participé aux travaux agricoles familiaux.
Après ce mouvement de grève, les salaires ayant été quelque peu augmentés, j’ai trouvé du boulot auprès d’une autre entreprise (dont je ne me rappelle plus le nom) et du 01 octobre 1936 au 31 octobre 1936, j’ai aidé à mettre en place une pompe dans un des puits du casernement du Val d’ACHEN.
Cette même entreprise m’employa comme aide-soudeur. En effet, les casemates ont été équipées de citernes à fioul. De grands panneaux de 2,50 x 2,80 m étaient livrés et il fallait les assembler et les souder sur place, dans les casemates. Je donnais un coup de main pour la manipulation et le maintien des panneaux au moment de l’assemblage. Cela dura du 1er novembre 1936 au 30 décembre 1936.
Durant cette période, cette entreprise avait installé, dans l’ouvrage du "Haut Poirier", trois citernes qui n’étaient pas encore peintes à l’intérieur ni en dessous. L’entreprise avait des délais à respecter et le 24 décembre, un responsable me demanda si je voulais bien accepter le travail de mise en peinture, il me paierait 10 F pour cette intervention à condition de l’effectuer encore le jour-même.
Après avoir terminé mon poste à ROHRBACH, je suis rentré dîner, puis je me suis rendu au "Haut Poirier" avec une "Kabbittlòmp" (lampe à acétylène). Je me suis glissé successivement par la petite ouverture à l’intérieur de ces trois citernes. Je n’étais pas tellement rassuré, puisque j’étais seul dans cet ouvrage. A 23 heures, le travail était accompli, j’ai eu juste le temps de rentrer pour me laver, me changer et rejoindre l’église pour la messe de minuit.
En janvier 1937, je rejoins l’entreprise LEFEVRE spécialisée dans le forage de puits. Durant trois mois, j’étais affairé au forage d’un puits d’une profondeur de 175 m au "Héwelsfeld Bloc 7" (vers WIESVILLER). La méthode employée était le forage à sec.
Le 16 avril 1937 et pour une durée de cinq mois, j’ai intégré l’entreprise TREFORT. Nous avons creusé au Bloc 9 de la "Helchewies" (vers SINGLING) un puits de 225 m de profond par la méthode de forage avec eau. Une tourelle de forage de 20 à 25 m de haut avait été érigée et tous les jours, je devais grimper au sommet pour huiler la roue du treuil.
Au bout de deux heures de forage, nous avions creusé environ 50 cm, il fallait donc sortir le trépan à l’aide du treuil pour l’affûter. En même temps était prélevé un échantillon de terre aux fins d’analyses. Cette opération durait à nouveau deux heures en fonction de la profondeur. Le poids des tiges et du trépan était d’à peu près 500 kg, le trépan seul pesait 125 kg. Puis, il fallait chauffer pendant une heure le trépan, sur une forge mobile, jusqu’à ce qu’il soit rougi. Ensuite le forgeron le plaçait sur une enclume et deux ouvriers dont moi, donnaient en un quart d’heure 80 coups de masse afin de rendre au trépan son tranchant.
Puis venait l’opération inverse : la remise en place du trépan et des tiges qui durait aussi près de deux heures.
Nous étions alors repartis pour creuser 50 nouveaux centimètres, tout en accompagnant chaque tour de forage en maintenant une barre horizontale, pour guider le trépan.
Les incidents étaient fréquents : un jour, le trépan était resté bloqué et il nous a fallu deux jours pour l’extraire. Les puits avaient en surface 40 cm de diamètre alors qu’au fond, ils rétrécissaient à 20 ou 25 cm.
Durant ces huit mois, j’effectuais les 3 x 8, je travaillais donc par postes, car ces forages se poursuivaient jour et nuit.
Je me rappelle un autre incident sur un des puits du secteur situé à la "Ferscht" : il y avait une faille dans le puits et pour la colmater 800 sacs de ciment ont été nécessaires.
Alors que j’étais employé au puits de la "Helchewies", un alsacien du nom de Joseph KAPFER, de plusieurs années mon aîné, y travaillait aussi. Il me demanda un jour de jouer le rôle d’entremetteur pour qu’il puisse fréquenter une fille du village, Anna MULLER, qu’il épousa par la suite.
Du 16 septembre 1937 au 15 octobre 1937, je travaillais pour la société CABLE PARISIENNE. Il fallait creuser des tranchées pour l’enfouissement de câbles téléphoniques et chaque ouvrier devait, par jour, réaliser une tranchée de 3,10 m de long et 2,10 m de profond. Il arrivait que compte tenu de la configuration du terrain, l’on puisse creuser un peu plus et ainsi avoir une avance pour le lendemain.
Alors que j’étais affairé près du Haut Poirier, le vendredi après-midi, et que j’avais pris une avance pour le lundi, le contremaître passa avant la fin du poste et pour assouvir son autorité me dit : « Il faudra terminer ce trou et en creuser un autre avant lundi soir, sinon tu seras viré ! »
Vexé, blessé dans mon amour propre puisque j’avais même fait plus que ce qui était prescrit, je lui répondis : « Je n’attendrai pas lundi, prépare-moi mon compte de suite, je démissionne ! ». Se rendant compte qu’il avait dépassé les limites, le contremaître tenta de me retenir, mais rien n’y fit.
Pour éviter une trop grande mobilité du personnel entre les différentes entreprises de construction des fortifications, celles-ci avaient conclu un accord, celui de ne pas reprendre un ouvrier qui avait démissionné de l’une des entreprises avant un délai de trois mois.
Mon frère Paul étant contremaître dans la firme HENRY, arrangea le coup et après 15 jours, le 01 novembre 1937, je pus commencer dans cette société.
J’y suis resté jusqu’au 15 août 1938, juste quelques jours avant mon départ pour l’armée. Je travaillais en régie, à faire des travaux de finition, il n’était donc pas question de rendement. Mon lieu d’activité principale était le petit ouvrage de ROHRBACH (appelé aujourd’hui Fort CASSO).
Je me souviens qu’un des responsables du Génie, le capitaine RICHARD, accompagné de son grand chien, fit un jour une tournée d’inspection, et moi j’étais occupé avec un marteau-piqueur à creuser une niche de 30 cm de profondeur dans un mur d'une casemate. Il trouvait que je ne progressais pas assez vite. Je lui prêtai alors le marteau-piqueur, il fit un essai, se rendit compte de la résistance du béton et me repassa l’outil. Il ne revint plus jamais.
Mon frère Paul vint aussi une fois me demander de l’aider à ramener depuis la route et jusqu’au monte-charge de l’ouvrage, un moteur d’environ 2,5 tonnes. Plusieurs ouvriers avaient tenté en vain de faire bouger ce bloc, mais nous deux, nous l’avons ramené à bon port en une après-midi.
Durant ces trois ans et demi de travail effectif, j’eus six employeurs différents et j’étais occupé sur sept chantiers. Il ne faut pas oublier que j’ai continué pendant toute cette période à assumer l’exploitation agricole.
En 1935, conjointement avec les fortifications, avaient été construites les casernes du VAL d’ACHEN.
LA CONSCRIPTION
C’est en 1937 qu’eut lieu à ROHRBACH, la conscription "MUSTERRUNG". Nous étions sept conscrits. Comme il était de tradition, les conscrits faisaient la fête, mais Charles KIMMEL, empêché par sa marâtre, n’a pas pu participer aux festivités. Notre classe n’a pas manqué d’honorer cette coutume, nous avons tenu trois jours sans voir un lit. Nous avons défilé dans les rues du village, accompagnés de trois musiciens (un de WITTRING et deux de GROS-REDERCHING). Le premier soir, nous avons organisé un bal chez les "Hupperts" et le deuxième soir chez "Wickels".
Le troisième soir, après avoir ramassé des œufs dans le village, nous avons fait des omelettes au restaurant et le quatrième soir, le groupe se dispersa peu à peu. Vers 4 heures du matin, n’étant plus que deux ou trois, nous avons décidé de mettre un terme à la fête et d’aller nous coucher.

Les conscrits de 1937 : au premier plan, les musiciens et debout de gauche à droite :
Joseph ROHR (d’un an plus jeune, il n’a été que le porte-drapeau), moi, Stanislas JUNG,
Jacques WIEDEMANN, le maire, Jean RIMLINGER, Joseph MULLER (Fròòsisse),
Charles BIRKENSTOCK (de Wèlschell) et Clément MULLER.
LE SERVICE MILITAIRE
Fin août 1938, j’ai eu mon avis d’incorporation pour le 59e Régiment d’Artillerie Motorisée à SARREBOURG. La durée légale du service militaire était de deux ans.
Juste avant mon départ, avec mes copains, nous avons organisé une petite fête au restaurant BIRCKENSTOCK, tenu à l’époque par un sympathique gérant originaire de SARREGUEMINES, lequel nous a concédé toute cette soirée gratuitement.
Le 1er septembre 1938, je me suis donc rendu dans mon régiment. J’étais affecté à la 4e Compagnie. Il m’a été attribué sept tenues :
• 2 treillis bleu gris
• 1 tenue de sortie kaki
• et 4 autres tenues de travail
Il fallait les empiler sur des étagères et les affaires de toilette étaient rangées dans un coffret en bois avec cadenas que j’avais ramené de la maison.
Je faisais mon service de façon convenable et donnais entière satisfaction.

Me voici à gauche en tenue de sortie et à droite en tenue d’apparat
Pendant la période d’instruction, sans véritable équipement, j’ai dû faire un tour de garde à LA FORGE, près d’un dépôt d’essence installé en pleine forêt. On y avait une impression d’insécurité. Quelques jours après, je devais y retourner, mais j’ai refusé en disant : « J’entretiens la chambre d’un des brigadiers, mais je ne veux plus faire de garde ». C’est ainsi que j’en fus dispensé jusqu’au début de la guerre.
Un matin, à 11 heures, au retour du service, mon paquetage était parterre dans la chambre. Vexé, car l’ayant toujours bien rangé, je le laisse tel quel, je prends mon quart et me rends au réfectoire, puis à la cantine. Je ne reviens à la chambre qu’à 13 heures moins cinq. Le brigadier de service m’y attendait et me demande d’où je viens. « De la cantine », lui répondis-je.
Il voulait savoir pourquoi je n’avais pas encore rangé mes affaires. J’ai alors haussé le ton et lui ai rétorqué :
« Je voulais d’abord savoir qui l’avait jeté à terre, parce que tout était parfaitement rangé. Ainsi tu voulais me jouer un sale tour ! Que je ne t’y reprenne plus, sinon tu vois ces grosses chaussures, je t’assommerai avec, si tu oses me refaire cela ! ».
Après cet épisode, je n’ai plus eu de problèmes durant le reste de mon service.
Début novembre, mon camarade de classe, Charles KIMMEL, a été incorporé dans le même régiment que moi, mais à la 8e Compagnie.
Tous les jours, je me rendais à la cantine boire un café avec lui et Alphonse HOFFMANN, originaire d’ETTING.
Les soirs, il nous arrivait de temps en temps d’aller faire un tour dans SARREBOURG, qui à l’époque comptait 49 bistrots.

Me voici en tenue de sport
Pendant les premiers week-ends, je me rendais chez une amie intime prénommée Anna et qui habitait à GOETZENBRUCK. Or, en revenant à la caserne, un dimanche soir après une perme, j’ai trouvé dans une poche de ma veste un billet de 50 F. C’était Anna qui l’y avait glissé. Je n’ai pas accepté cela. En ces temps, il était impensable qu’une fille entretienne un jeune homme. Blessé dans mon orgueil, j’ai rompu notre liaison.
Par la suite, les week-ends, je les passais pratiquement tous à la maison. Tantôt je rentrais en train, tantôt j’empruntais un vélo à raison de 5 F et parcourais ces 42 km en un plus d’une heure.
Tout mon linge a été lavé à la maison, de même l’ordinaire, je l’améliorais par les provisions ramenées de chez mes parents. Il m’arrivait aussi, de temps à autre, de passer un week-end à DIEUZE chez un copain de chambrée, et lui, venait parfois avec moi à ACHEN.

J’ai été nommé pointeur chef auprès d’une pièce de 75 (canon de 75) d’une portée précise sur 10 km.
Lors de manœuvres d’une durée de 15 jours à BITCHE-CAMP, aux exercices de tirs au canon, notre pièce a atteint la cible avec 7 coups sur les 12 tirés et nous nous sommes classés premiers.
J’ai été cité devant le régiment, avec une conclusion du Commandant en ces termes : « Nous n’avons rien à craindre puisque nous avons parmi nous,
le meilleur tireur ! ».
J’ai reçu une distinction avec insigne et une prime de 50 F de la part du capitaine, plus les apports du commandant et des lieutenants, en tout : 240 F.
Mes camarades et moi, nous avons obtenu une perme. Au retour sur BITCHE, nous avons ramassé des champignons que nous avons fait préparer dans un restaurant de la ville où nous avons fait la fête.
Depuis la caserne, nous nous rendions souvent en camion à STOCKBRONN, près d’EGUELSHARDT pour la construction d’abris et de positions.
Je supportais mal ces trajets de SARREBOURG à BITCHE (mal de transport) et à la sortie de REDING, je me sentais déjà mal.
Un jour, alors que j’étais chef de voiture, nous avons fait un détour par ACHEN avec le camion et 8 à 10 hommes à bord pour manger un bon casse-croûte, arrosé d’un peu de schnaps. A notre arrivée à STOCKBRONN, le capitaine, un peu inquiet, me demanda de justifier ce retard d’une heure. Comme excuse, je lui expliquai que j’avais besoin d’un marteau de maçon correct pour les travaux à effectuer. Il avait bien compris notre stratégie et
ne mit pas en doute l’excuse du marteau. Il nous arrivait aussi d’aller faire casse-croûte au restaurant à EGUELSHARDT.
L’adjudant de service m’avait une fois désigné de garde pour la matinée. Donc je ne me suis pas rendu à l’appel de ceux qui partaient pour BITCHE et qui se levaient plus tôt que les autres.
Le capitaine, ne me voyant pas dans les rangs, demanda des explications à l’adjudant qui s’est fait passer un savon. Il est venu me réveiller en douceur, mais moi, je me suis préparé sans me presser et toute la section a dû m’attendre. Je n’ai plus jamais été inscrit sur un tableau de garde.
Nous avions à peine terminé les positions et profité de quelques jours de perme que la préparation de la guerre s’activa.
DEBUT DE LA PERIODE DU CONFLIT ARME
Le 27 août 1939, alors que les réservistes avaient été rappelés, notre régiment fut scindé en trois régiments : le 59 e, le 60 e et le 68 e.
Je fus affecté au 60 e Régiment d’active d’Artillerie 4 e batterie (une batterie était composée de 5 canons). Nous avons gagné nos positions près d’EGUELSHARDT, emmenant tout le paquetage.
Toute notre nouvelle hiérarchie était composée de réservistes :
• le Commandant DE MONTENON (il avait le titre de noblesse, mais sa femme détenait la fortune)
• le Capitaine LE COMTE (prêtre qui nous lisait la messe tous les matins)
• le Lieutenant DOULCET (brave homme qui communiait tous les matins)
• le Lieutenant BRUZOLOWSKI (qui dépeignait un peu du lot)
• et un autre Lieutenant dont j’ai oublié le nom, un chic type, d’ailleurs. Sa fille de 12 ans fut ma marraine de guerre et m’envoya plusieurs colis avec des sous-vêtements chauds et d’autres affaires ainsi que des victuailles.
Je ne sus que plus tard qui avait été ma marraine de guerre, beaucoup d’appelés avaient une telle marraine mais n’en connaissaient que rarement l’identité.
Le 1er septembre 1939, la guerre fut déclarée. J’étais en position à STOCKBRONN lorsque sont passés des flots de réfugiés qui devaient évacuer les villages de la première zone.

Le capitaine
LECOMTE
Du 07 au 14 septembre, certaines unités ont fait une percée en territoire allemand, (opération Sarre) mais ont eu ordre de rebrousser chemin. Des tirailleurs marocains revenus de cette expédition sont passés près de notre position, exhibant des musettes pleines de nez et d’oreilles qu’ils avaient coupés aux adversaires.
Au bout de quelques jours, nous avons été mutés à NIEDERBRONN où nous avons construit des positions de fortune et logé dans les maisons évacuées.
Je m’en souviens bien, j’ai logé dans la dernière maison à droite de l’époque, dans la partie de NIEDERBRONN vers JAEGERTHAL.
Le 16 septembre 1939, j’ai été nommé brigadier-pointeur. Commençait le "SITZKRIEG", guerre de position et d’observation appelée aussi "drôle de guerre"
Un garde-forestier habitait encore un moment près de notre position et avant qu’il n’évacue les lieux, je lui rendis visite. Il me confia son chien et un fusil de chasse. C’était une aubaine, puisque du gibier, il y avait en abondance !
Les DE DIETRICH, adjudicataires de la chasse, n’avaient pas tiré un coup de fusil depuis des années et bravant l’interdiction, nous avons amélioré l’ordinaire.
J’ai offert un gigot de chevreuil au capitaine, qui tout en faisant l’étonné sur cette provenance, se proposa de suite pour me fournir en munitions.
Les lapins de garenne, on les tuait à coups de bâtons, on encerclait une haie, on y lâchait le chien et il en sortait 7 ou 8.
Dans ces nouvelles unités, il n’y avait plus assez de gradés et le capitaine m’a inscrit pour le peloton de Maréchal des Logis (grade qui vaut celui de sergent).
Le premier jour, je ne me suis pas rendu à l'instruction. Le capitaine m’a alors appelé et sermonné. Résigné, j’ai participé à trois semaines de préparation et à l’examen final, j’ai été reçu deuxième sur 42 participants. Mais j’ai refusé ma nomination en tant que maréchal des logis. Pour la solde, cela aurait été intéressant, car elle doublait (de 50 centimes à 1 F par jour), mais la plupart des sous-officiers étant des rappelés, continuaient à percevoir leur salaire civil et dépensaient des sommes folles en apéritifs, repas, fêtes, etc. Moi, avec ma maigre solde et des parents évacués en Charente dont je ne pouvais attendre aucun soutien financier, je ne pouvais me hisser à leur rang, d’ailleurs le capitaine comprit mon choix.
Durant ce "SITZGRIEG", d’automne 1939 au printemps 1940, j’ai eu deux permissions pour me rendre en Charente auprès de ma famille évacuée : la première d’une durée de dix jours et la deuxième de même durée. Malheureusement, le dernier jour, je suis tombé malade : céphalées et rhumatismes articulaires. Le médecin appelé à mon chevet me fit hospitaliser à CONFOLENS pendant dix jours. A peine rétabli, j’ai dû rejoindre mon régiment.
Durant ces deux permes, j’ai sillonné la Charente, à pied, à vélo, rendant visite à toutes les connaissances, en profitant aussi pour visiter la région.
Au printemps 1940, vint un ordre de repli vers le REHTHAL, où début mai, nous avons eu le premier contact avec l’ennemi. Il y eut un échange d’environs 10 coups de canon et un incident me marquera à jamais.
A la tombée de la nuit, nous avions pointé sur une ferme investie par les Allemands et j’avais recouvert l’appareil de pointage avec sa housse, en attendant l’ordre pour le premier tir. Il y eut un moment de relâchement, puis fut donné l’ordre de rejoindre les postes. Je voulus enlever la housse, or les Allemands s’étaient mis à nous tirer dessus. Dans la confusion, le capitaine s’embrouilla, inversa le rang des ordres et commanda brusquement, sans autre préparation, l’ordre de feu. Je me trouvais donc à côté du canon au moment de la mise à feu. La déflagration fut terrible et le souffle m’envoya à la renverse à quelques mètres du canon. Je me suis relevé, abasourdi, chancelant, ne présentant pas de blessures sur le moment. Je pus encore constater qu’un de nos hommes venait d’être tué par l’ennemi. Or, comme je n’avais pas de protection contre le bruit au moment de la déflagration, cela a détraqué mon ouïe. La perte d’audition n’était pas trop importante sur le moment, mais elle n’a cessé de s’amplifier au fil du temps.
Peu après, nous avons fait une petite progression de 5 - 6 km jusqu’à DAMBACH et là, le 09 mai 1940, j’ai grimpé sur un arbre pour faire le guet. Malheureusement une branche s’est cassée et, ne pouvant me retenir, j’ai glissé le long du tronc sur 6 à 7 mètres.
Je m’étais fait quelques éraflures aux jambes et éprouvais des difficultés à me déplacer pendant quelques jours. Si cette date m’est restée en mémoire, c’est parce que ce même jour, j’ai reçu un courrier de mon frère François. Une carte m’annonçait la naissance de son fils Roger et qu’il m’avait choisi pour en être le parrain. Malheureusement, suite à ma chute, je ne pus me déplacer à PONT-A-MOUSSON pour assister au baptême.
Vint l’ordre du repli stratégique vers SARREBOURG qui nous mènera en fait jusqu’au DONON. Au début du repli, nous étions même pendant huit jours encerclés par les Allemands. Le ravitaillement ne pouvait plus être assuré, nous avons récolté des topinambours dans un champ et fait cuire les vieilles lentilles qui traînaient depuis longtemps dans un camion. La cuisson terminée, dans les marmites, surnageaient plein d’insectes.
A ABRESCHVILLER, nous avons tiré sur nos propres troupes suite aux ordres d’un officier supérieur, peureux, qui avait cru voir l’ennemi. Deux canons avaient été mis en action, mais l’erreur fut vite rectifiée et l’arrêt des tirs ordonné par nos officiers qui grâce à leurs jumelles, s’étaient rendu compte de
la méprise.
Arrivés au DONON, nous avons attendu huit jours l’ordre de nous rendre, sans plus jamais tirer un seul coup de canon.
L’armistice a été signé le 22 juin 1940. Le commandant fit un petit discours en citant une phrase célèbre du Général DE GAULLE: « Nous avons perdu
une bataille, mais pas la guerre » et le 24 juin 1940, nous avons été faits "prisonniers d’honneur ".
Nous voici aux mains des Allemands. Autour de nous régnait un spectacle de désolation, les chevaux d’autres régiments étaient là, attachés aux arbres, sans nourriture, mangeant l’écorce et même entamant le tronc. La majorité mourut sur place.

Des positions servant à abriter nos canons
CITATION
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)
Le 27 juin, encadrés par les Allemands, nous sommes partis à pied en direction de STRASBOURG, avec un peu de paquetage sur le dos.
Sur notre passage, des Alsaciens au bord de la route voulaient nous ravitailler en vivres et en boissons, mais ils se sont fait violemment repousser par
les Allemands. Notre capitaine sanglotait : « Ces Alsaciens si accueillants ! ».
Le 29 juin, nous avons été internés dans une caserne près de STRASBOURG, au quartier LIZE de NEUHOF.
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)
Dix jours après, les Allemands procédèrent à la libération, par groupes, des Alsaciens et des Mosellans (moins les Juifs).
Le 11 juillet, je fus libéré en même temps que Charles KIMMEL. Nous avons rejoint les abattoirs de STRASBOURG où travaillait un oncle de Charles,
lequel nous offrit couvert et gîte pour la nuit.
En sortant du camp de prisonniers, une jeune fille originaire de GRIESBACH nous avait accosté et demandé des nouvelles de son fiancé et la date de sa libération. Pour seule consolation, nous n’avons pu que lui dire que cela ne saurait tarder.
Le lendemain matin, 12 juillet, nous avons entamé à pied le chemin du retour avec nos quelques affaires. En cours de route, nous avons trouvé une petite charrette à quatre roues "e Wäänel", mais dont il manquait une roue. Afin de compenser ce manque, nous avons passé une ceinture par-dessus l’épaule et l’avons fixée à l’essieu. Nous nous sommes relayés, tantôt tirant la charrette où nous avions fourgué nos affaires, tantôt compensant la quatrième roue, et cela jusqu’à ACHEN.
Nous étions deux jours en route. Le premier soir, nous avons fait halte à GRIESBACH d’où était originaire la jeune fille qui nous avait accostés et dont nous avions retenu le nom du fiancé. Nous étant renseignés, nous avons retrouvé cette jeune fille dont le fiancé n’était pas encore libéré.
Elle fut tout étonnée de nous revoir, et très amicalement, elle et ses parents nous ont invités à dîner et à passer la nuit.
Au petit matin, après un bon petit-déjeuner, nous avons repris la route avec notre fameuse charrette. A LEMBERG, nous avons fait une halte chez notre ancien curé, l’abbé SAUTER qui nous a remis quelques provisions et à PETIT-REDERCHING, nous avons bu un pot chez Joseph VOGEL ; puis, ce fut l’ultime étape jusqu’à ACHEN.
Le village était vidé de ses habitants qui avaient été évacués vers la Charente. A mon domicile, il n’y avait plus rien qu’un vieux matelas, tout avait été pillé, alors que ma famille au moment de l’évacuation n’avait emmené que le strict nécessaire.
En passant à travers le village, la première personne que nous avons rencontrée fut Joseph BIRCKENSTOCK, puis trois autres camarades de mon âge qui venaient également d’être libérés de camps de prisonniers : Charles FREYERMUTH, appelé "Bèhrer Krùmmer", Paul SPAETH et Henri ROSNER. Tous les cinq, nous nous sommes regroupés dans un premier temps, et tant bien que mal, nous avons organisé notre survie en récupérant des ustensiles de cuisine dans les maisons du village.
Au point de vue nourriture, il ne restait pratiquement plus rien, nous avons même déniché cinq jeunes hiboux dans le clocher et les avons préparés en un mets succulent. Quelques jours après, mon frère Paul revint aussi au domicile.
Avant le conflit, Paul avait été stationné avec son unité à RATZWILLER où il avait tissé des liens avec la famille Emile MULLER. Il m’emmena dans cette famille puisque ce village n’avait pas été évacué. Nous avons trouvé bon accueil, y avons logé et travaillé, mais petit à petit, je revins de plus en plus souvent à ACHEN, essentiellement la journée, et commençais à m’organiser. J’ai retrouvé sur un coin de ban, notre ancienne faucheuse, mais elle nécessitait une sérieuse remise en état. Quelques Allemands s’étaient installés entre temps à ACHEN et une quinzaine d’autres jeunes libérés des camps de prisonniers a rejoint le village.
LA VIE SOUS L’OCCUPATION ALLEMANDE
Par la suite, pour récupérer des chevaux, j’ai dû me rendre à l’ORTSKOMMANDANTUR d’ ACHEN, où m’a été délivrée une attestation nécessaire pour la suite des démarches.
La prochaine étape a été la KOMMANDANTUR de SARREBOURG où je me suis rendu en compagnie de Charles FREYERMUTH. Le responsable de cette KOMMANDANTUR, le Reichsbahn-Inspektor BAUMANN (avocat originaire de SARREBOURG), m’a cherché des noises, mais j’ai quand-même réussi par avoir les pièces nécessaires à l’octroi de deux chevaux. Il y eut un incident à la fin de l’entrevue et j’étais énervé par tant de tracasseries. BAUMANN me demanda : « Qui vous a délivré la première attestation ?»
Je lui répondis : « Un type semblable à vous ! »
Puis, je le bousculai en l’envoyant choir au fond de la pièce.
Rassemblant mes papiers, je quittai le bureau, dévalai les escaliers d’un côté de la bâtisse, alors que la garde, appelée à la rescousse, montait de l’autre côté. Dans le hall, m’attendait Charles ; nous nous sommes précipités à l’extérieur, avons enfourché nos vélos et fuit à travers les sentiers entre les jardins (que je connaissais bien, suite à mon temps d’active passé à SARREBOURG). Ainsi, nous avons pu semer nos poursuivants.
Après, nous nous sommes rendus à HEMING dans un centre de parcage de chevaux où nous avons dû attraper deux bêtes dans un parc.
Dans HEMING, nous avons pu acheter un pain de trois livres et quémander du sel. A la sortie du village, dans un potager, nous avons volé des oignons, puis, nous avons fait une halte pour savourer ce repas. Ensuite, nous nous sommes dirigés vers RECHICOURT.
Arrivés dans ce village, nous nous sommes désaltérés dans un petit bistrot où nous avons rencontré le premier évacué revenu de l’exode et originaire de BINING, nommé GROSS, qui nous a suppliés de nous débarrasser de nos bérets, car l’interdiction du port du béret venait d’être proclamée. Il nous fournit immédiatement deux casquettes.
Peu après, nous sommes allés à l’extérieur du village pour récupérer les chariots laissés là par nos familles au moment de l’exode, lorsqu’elles sont montées dans le train.
Rejoins par Charles BIRKENSTOCK, nous avons d’abord assemblé pièce par pièce, deux harnais, ensuite attelé deux chariots et démonté un troisième que nous avons réparti sur les deux premiers.
Sur le chemin du retour, quelques kilomètres après RECHICOURT, à la tombée de la nuit, nous avons fait halte dans un champ où étaient entreposées, en petites meules, des gerbes d’avoine. Elles servirent de nourriture pour les chevaux et d’abris pour nous, pour passer la nuit.
Le retour fut laborieux car les chevaux n’étaient pas de premier choix et dès qu’il fallait tirer les chariots dans les montées des côtes, ils refusaient d’avancer, reculaient même. Près de FENETRANGE, nous avons même dû détacher les chevaux et pousser les chariots en haut d’une côte.
En route, un prêtre demanda à pouvoir profiter du voyage, mais je le mis en garde disant qu’il devra peut-être aider à pousser les chariots dans les côtes. Il n’eut heureusement pas à intervenir puisqu’il nous quitta à NIEDERSTINZEL.
Près de SARRE-UNION, les chevaux refusèrent à nouveau d’avancer, essentiellement celui qui était attelé à gauche et qui se mit à reculer. Excédé, j’ai taillé un bâton sur le bord de la route et l’ai correctement rossé. Il n’a plus jamais refait pareil cinéma.
Par la suite, seul, j’ai commencé à faire du foin en prévision d’une éventuelle attribution de vaches.
Frieda MULLER, de RATZWILLER et sa voisine Bertha LEDIG sont venues me donner un coup de main et m’ont même confectionné une tarte aux quetsches, dans le vieux fourneau que j’avais récupéré, mais dont j’avais oublié d’enlever une réglette, ce qui les a obligées de doubler pratiquement le temps de cuisson.
Elles sont revenues faire le ménage, lorsque les premières rumeurs sur le retour des réfugiés ont commencé à circuler. Entre temps, en compagnie de Frieda et d’une autre voisine, Lydia JUNG, j’ai fait une sortie à vélo à l’étang de HANAU.
En septembre 1940, me parvint la nouvelle que les évacués étaient de retour de Charente et qu’ils attendaient à VECKERSVILLER. Ma famille se trouvait parmi eux. J’ai donc attelé les chevaux, puis, me suis rendu là-bas récupérer les miens : mon père, ma mère, mes trois sœurs, Mathilde, Hilda et Madeleine. Il est à signaler que durant toute la période d’évacuation, j’ai correspondu par courrier avec ma famille.
Les voici revenus de Charente, ramenant quelques ustensiles et des provisions. La reprise de la vie normale est lente, il faut se débrouiller, nous irons dans des villages non évacués pour chercher un peu de ravitaillement.
L’administration allemande se met en place, l’Alsace et la Moselle sont annexées et nous voici citoyens allemands. Mon père a lentement repris la maçonnerie et moi, la culture.
Au début de novembre 1940, je me suis rendu à PONT-A-MOUSSON chez mon frère Nicolas ; cela relevait de l’exploit, car il fallait passer la ligne de démarcation. J’avais contacté un transporteur de DOMFESSEL qui, avec un camion, livrait des meubles en zone libre. Je m’étais caché dans une armoire pour l’aller et le retour.
Arrivé chez mon frère, j’ai pu acheter une vache dans les environs, mais il restait à résoudre le problème du rapatriement de la bête.
A la mi-novembre, avec ma sœur Hilda et empruntant le même moyen de transport, je suis retourné à PONT-A-MOUSSON pour chercher la bête.
Il n’était pas question de la ramener avec le camion.
Un lundi matin à 11 heures, nous avons entamé le voyage de retour à pied, tenant la vache à la laisse. Elle n’était pas ferrée, d’ailleurs je n’avais pas trouvé de forgeron pour le faire, et au bout d’une trentaine de kilomètres, elle avait déjà du mal à marcher.
Dans un petit village, un vieux forgeron, pris de pitié, martela des fers et les posa. Quelques kilomètres plus loin, nous avons cherché à faire halte pour fourrager la bête. Nous avons alors rencontré trois femmes en train de faire le battage de céréales, mais elles avaient des ennuis : la courroie de la batteuse sautait toujours et d’autres petites réparations étaient à faire. Je leur remis la batteuse en état, en contrepartie de foin et de casse-croûtes.
Arrivés près de la ligne de démarcation, à proximité de DIEUZE, nous avons lâché la vache afin qu’elle s’intègre dans un troupeau paissant dans un grand parc qui allait de part et d’autre de la frontière. Ma sœur et moi, nous avons franchi la frontière à quelques distances du troupeau, en passant à travers les barbelés et récupéré la vache une fois qu’elle était passée dans la zone allemande.
Les soirs, nous avons cherché un abri dans une grange ou une étable et nous nous nourrissions chez l’habitant. Le mercredi soir, nous étions à KAPPELKINGER. Hilda est restée sur place et moi, j’ai emprunté un vélo et suis revenu à domicile prendre quelques affaires.
Le lendemain, je suis retourné à KAPPELKINGER et nous avons entrepris la dernière étape qui nous a menés à ACHEN en cette fin d’après-midi de jeudi. Notre expédition aura duré quatre jours mais cela en valait la chandelle, car à partir de maintenant, nous avons à nouveau du lait. Au retour, j’ai aussi dû annoncer à mon autre sœur Mathilde, que Nicolas la sollicitait pour être la marraine du cinquième enfant à naître dans leur foyer. Michel naîtra 10 jours plus tard (02.12.1940).
L’administration allemande a désigné des responsables locaux pour gérer le village.
François KREBS, "de Làcher Fròns" a été nommé ORTSGRUPPENLEITER (maire). Les villageois devaient se méfier de lui, c’était un pro-nazi pur et dur, ancien sous-officier allemand pendant la guerre 1914/1918.
Paul ILLIG, pro-français, accepte le poste de ORTSBAUERNFÜHRER (responsable des agriculteurs), uniquement pour qu’on lui fiche la paix. Il sera
tué par les premiers obus américains qui s’abattront sur ACHEN.
Comme secrétaire de mairie sera installé un certain Valentin HOFFMANN de RAHLING, connu pour être de connivence avec les Allemands. Les gens le haïssaient à cause de cela. Il avait les surnoms de: "Valencier, Hupsmännel et Schublàddehupser".
Le "Làcher Fròns" me dit un jour : « Les jeunes sont très turbulents, ils devraient faire un séjour au front russe.»
Je lui rétorque : « Nos jeunes n’ont rien à y faire et moi, de toute façon, je n’irai jamais là-bas ».
Après avoir obtenu les autorisations auprès de l’administration allemande, avec mon attelage, je suis allé récupérer, à plusieurs reprises, du foin et de la paille à SCHWEYEN où toutes les maisons étaient inhabitées car leurs occupants avaient été expulsés lorsque cette zone a été réquisitionnée en vue d’y établir un grand terrain de manœuvres. : le "NIEMANDSLAND".
J’ai donc récupéré du fourrage pour mes bêtes, mais également pour les gens dépourvus d’attelage. Il m’est arrivé de faire jusqu’à deux voyages par jour.
J’ai failli perdre un cheval à SCHWEYEN : en passant dans une cour pleine de gravats et où tout était gelé, la bête s’enfonça dans la fosse à purin dont l’épaisse couche de glace venait de céder.
La bête paniqua et j’eus tout le mal du monde à l’en ressortir. J’ai décroché une porte d’étable, puis la porte d’un enclos de jardin et les ai glissées sous la bête. Enfin, je lui ai mis une corde à la patte pour l’aider à remonter sur la terre ferme. Après l’avoir sortie de sa mauvaise posture, malgré le froid, je l’ai lavée à la fontaine et fortement essuyée puis mise à l’étable, à l’abri des courants d’air, en attendant le lendemain matin pour repartir.
Un jour, au retour de SCHWEYEN, nous avons fait halte au Café BECK, près de la gare de ROHRBACH. Cinq à six attelages étaient garés là. Vint un gendarme allemand, qui avait horreur que l’on mette des œillères aux chevaux !
Ce jour-là, comme par hasard, je ne leur avais mis que les brides des œillères. Il rentre dans le bistrot et demande à qui est cet attelage de chevaux sans œillères. J’ai pensé un moment qu’il allait sûrement trouver un défaut et me coller un PV. Bien au contraire, il me félicita et me cita en exemple devant les autres. Ce fut bien la seule fois qu’un Allemand a pu me féliciter, car je ne pouvais vraiment pas les blairer.
J’ai aussi pu obtenir de la KOMMANDANTUR un bon pour aller récupérer une batteuse à HOTTVILLER. Je l’ai installée sur notre fenil et à partir de là,
nous avons eu une certaine indépendance concernant le battage.
Accompagné de ma voisine Marie BACH (Fèlde), je me suis rendu avec mon attelage à VOLSBERG, acheter des pommes de terre et quelques légumes. La charrette était bien chargée, puisque j’y avais entassé 25 sacs de 50 kg de tubercules. A la nuit tombante, sur le retour, nous avons fait halte à RAHLING et avons passé la nuit chez la famille Eugène SCHMITT (Wàldbocks).
Le lendemain matin, Joseph SCHMITT (Wàldbocks -Ùnggel), frère d’Eugène, a attelé deux chevaux supplémentaires pour monter la côte vers SCHMITTVILLER.
Dans la descente de KALHAUSEN, Marie BACH ayant fait une fausse manœuvre (elle a desserré le frein au lieu de le serrer), nous avons perdu la maîtrise de la charrette et avons terminé la course dans un talus. Le timon était cassé et il a fallu que j’aille à ACHEN chercher une autre charrette.
En automne 1940, j’ai encore fait tardivement les labours et semé du blé.
Durant l’hiver 1940/1941, je me suis rendu à vélo avec Charles OBRINGER (de Kàrl), à NANCY. Passant à DELME, nous nous sommes arrêtés chez une des sœurs de Charles, Catherine. Elle exerçait comme femme de ménage, c’est d’ailleurs son patron qui nous a conseillé de passer la frontière à midi, profitant de la relève de la garde. Il a plu toute la journée et nous étions trempés en arrivant à NANCY. Nous avons trouvé refuge dans un institut de jeunes filles sourdes-muettes dans lequel travaillait Marie, une autre sœur de Charles. Nous sommes restés deux jours sur place et avons fait des
achats : du tabac, un manteau, un costume et…un lapin.
Au matin du 1er janvier 1941, nous avons entamé le retour. Au bout de cinq kilomètres, nous étions déjà contrôlés par la police secrète allemande (la Gestapo), mais nous avons pu repartir après de longues explications. Près de DELME, bien que la pluie ait cessé, le ruisseau, sur lequel était établie la ligne de démarcation, était en crue et nous ne pouvions plus emprunter le petit pont, sur lequel nous étions passés à l’aller. Nous avons tenté notre chance au poste-frontière officiel où nous avons essayé de baratiner le chef de poste.
Il a rédigé un compte-rendu de trois pages de notre conversation, qui ne contenait pas un mot de vrai, puisque tout ce que nous lui avions raconté, n’était que mensonges. Il ne céda pas : il faut d’abord restituer les affaires achetées, puis nous pourrons passer. Nous non plus nous n’avons pas cédé, nous avons préféré rebrousser chemin jusqu’au premier village où nous avons réparé une crevaison à l’un des vélos, et attendu au Café, pour tenter un passage, à la faveur de la nuit. Nous avons donc repris l’ancien chemin et traversé sur le petit pont malgré la crue. Nous étions dans l’eau jusqu’à la poitrine et sur le pont, il fallait encore démêler les barbelés pour passer au travers.
Lors de la traversée d’une forêt, j’ai même pendant un moment perdu une chaussure qui était restée engluée dans la gadoue. Au bout de quatre heures, nous avions à peine parcouru quatre kilomètres.
Arrivés dans un village, le patron du café nous indiqua des évacués de NOUSSEVILLER-LES-BITCHE qui nous ont réservé un bon accueil.
Ils nous ont fourni de vieux habits militaires, puisque nous étions trempés et transis. Ils nous ont offert à souper et nous avons dormi dans la grange. Après le petit-déjeuner, nous avons repris la route, mais nous sommes tombés quelques centaines de mètres plus loin sur un nouveau contrôle de police allemande.
Après un interrogatoire relativement serré, ils nous ont laissé repartir pour DIEUZE, d’où nous avons pris le train jusqu’à SARRALBE. Il était 15 heures lorsque nous sommes descendus en gare de SARRALBE, tout était enneigé. Puis nous avons regagné ACHEN à vélo, et à notre arrivée, nos familles furent soulagées, car elles vivaient dans l’inquiétude d’une éventuelle arrestation.
J’ai aussi fait du transport de matériaux pour la reconstruction ainsi que du déblayage de gravats que j’ai emmenés dans les carrières autour du village. Nous étions payés à la journée et j’avais arrangé le chariot de telle façon que la charge ne dépassait pas 1m3. Ainsi je pouvais tricher un peu et faire durer le transport.
A cette époque, les hivers étaient relativement rigoureux, avec beaucoup de neige. Les Allemands, dans un souci d’employer les gens, nous payaient à évacuer la neige et à déblayer les rues. Avec mon attelage spécialement ferré, j’ai participé à cette opération neige. Nous avons chargé la neige sur les chariots et l’avons ensuite déversée dans le ruisseau. Je gagnais 6 Mark de l’heure (attelage + conducteur), autant qu’un ouvrier pendant toute une journée.

Prêt à évacuer la neige avec mon attelage
A plusieurs reprises, durant cet hiver, alors que les voies de communication étaient coupées en raison de la neige, j’ai dû, avec un traîneau tiré par un cheval, me rendre à GROS-REDERCHING en passant par SINGLING, pour ravitailler tout ACHEN en pain.
Au printemps 1941, j’ai reçu des Allemands deux vaches. L’une crèvera rapidement, car certaines avaient séjourné trop longtemps dans les wagons durant le transport et n’ont pas survécu à cette trop longue privation de nourriture et d’eau. Cet épisode de la vache crevée va donner lieu à un incident.
J’ai envoyé ma sœur Madeleine, en mairie, faire la déclaration de la perte d’une vache. Le secrétaire de mairie, le fameux Valentin HOFFMANN de RAHLING, remballe ma sœur, lui signifiant que ce n’était pas son boulot. Puis, il lui demande de ressortir de la pièce et de revenir en faisant le salut hitlérien. En larmes, elle vient me trouver à la forge où j’étais en train de laisser ferrer un cheval. Je lui confie la bête pour la ramener à la maison et
me rends à la mairie.
D’un ton sec, j’interpelle le secrétaire de mairie et lui demande des explications. Mais sans attendre sa réponse, je rajoute :
« J’ai entendu qu’à RAHLING, on t’appelle "Schublàddehupser". Si moi je t’en flanque une, tu rentreras dans un de ces tiroirs et tu n’en ressortiras plus jamais ! ». Il se fait tout petit et prend note de ma doléance. Quelques temps après, la vache est remplacée.
Pendant toute la période d’occupation, j’ai continué à faire du transport de matériaux, à chercher du bois en forêt pour de nombreuses familles, mais aussi à faire ma culture et des travaux agricoles pour d’autres personnes.
A cette époque-là, le marché au noir était florissant et bravant l’ennemi, je me suis livré à toutes sortes de trafics clandestins.
Je me déplaçais souvent le soir ou même la nuit, à cheval, en calèche ou avec l’attelage complet et en hiver, avec un grand traîneau tiré par un cheval.
Lors de ces virées, j’étais toujours armé : j’avais d’un côté un couteau de boucher, de l’autre, un revolver chargé avec 6 balles, toujours prêt à défendre
ma vie, puisqu’une arrestation aurait signifié l’exécution.
Il m’est arrivé d’acheter au noir chez des particuliers, pour les tuer, des cochons qui officiellement étaient destinés à l’élevage.
A RATZWILLER, l’ORTSGRUPPENLEITER qui avait un penchant pour les nazis, m’a même vendu un porc au noir alors que pour les villageois, cela semblait inimaginable.
A WALDHAMBACH, j’ai acheté 4 cochons (2 mâles et 2 femelles) et profitant de l’absence de l’ORTSGRUPPENLEITER, son épouse a signé une autorisation de transport. J’ai ainsi pu les ramener en plein jour.
Une autre fois avec Charles JUNG, qui était très angoissé, je me suis rendu à RATZWILLER acheter deux cochons. Nous les avons placés dans un seul caisson. Ils ont hurlé durant toute la traversée du village et même encore jusqu’à BUTTEN, puis, se sont calmés.
Je me rappelle être passé une fois à RAHLING, au petit matin, avec 4 cochons et 6 porcelets sur la charrette.
Avec Albert DEHLINGER (de Kättler), je suis allé à DURSTEL pour chercher un cochon. Il nous a fallu toute la matinée pour en dénicher un. Nous avons contacté une femme qui nous a confié qu’elle nous vendrait bien un cochon, mais ses deux voisins étaient des pro-nazis. Je lui ai promis que le soir venu, je calfeutrerais l’étable et le tuerais sans bruit, exhibant mon revolver. Elle parut rassurée et nous avons conclu le marché.
A 18 heures, Albert téléphone à sa femme disant que nous ne rentrerions pas. Elle comprit le message et mit les marmites sur le feu pour chauffer l’eau. Le moment venu pour tuer le cochon, j’ai loupé mon coup, la bête se mit à hurler et j’ai dû tirer une deuxième fois pour l’achever. En sortant, j’étais peu fier, mais la dame estimait qu’elle n’avait pas entendu grand-chose. Rapidement, nous avons chargé la bête sur le traîneau. A minuit, nous étions à ACHEN et à deux heures, le cochon était fin prêt, ébouillanté, nettoyé, vidé et accroché à l’échelle.
Je me suis même rendu un jour avec mon attelage à BERTHELMING chez KAPFER, une connaissance de régiment, qui était boulanger, chercher une truie pleine.
J’ai aussi fricoté avec Joseph LUDMANN, véritable contrebandier, mais qui avait un penchant pour l’alcool. C’est pour lui que j’ai acheté une vache chez Anne RIMLINGER (Moser). J’ai ramené la bête dans la grange de Charles WOLF et attendu Antoine KIMMEL qui devait m’aider à la tuer. Or, il avait oublié notre rendez-vous. J’ai alors dû aller à cheval à ETTING, je l’ai fait monter avec moi sur le cheval et nous sommes revenus exécuter notre tâche.
Voulant assommer la vache, je lui ai donné un coup de masse sur la tête mais elle ne broncha pas. Antoine a dû s’y reprendre par deux fois, puis, lentement, elle s’est inclinée. A deux heures de la nuit, nous avions achevé notre besogne. J’ai ramené Antoine à son domicile, puis j’ai fourré dans des sacs en plastique la viande qu’on avait coupée en quartiers et les ai déposés derrière une haie à la sortie du village en direction de GROS-REDERCHING. Peu après, LUDMANN est venu avec une camionnette récupérer les ballots et les a vendus.
Le lendemain soir, il a fait la fête et a succombé aux charmes d’une jeune femme qui l’a entraîné dans son lit. Au réveil, il fut quelque peu surpris, car la jeune femme l’avait délesté de son argent et cédé sa place à une femme d’un certain âge déjà. Mais cela est un épisode parmi tant d’autres des avatars de LUDMANN.
J’ai exécuté plusieurs contrats pour LUDMANN concernant essentiellement des veaux que j’ai tués et dont il a récupéré la viande de la même façon. Je l’ai une fois rencontré à la gare de KALHAUSEN avec 3 jambons dans son sac. Il y a croisé les gendarmes allemands basés à KALHAUSEN, leur a souri malicieusement et lancé : « Quand j’ai des jambons dans mon sac, vous ne me contrôlez pas ! » Pensant à une vanne, les gendarmes sont passés sans le contrôler.
Une autre fois, je me suis rendu avec lui à NEUNKIRCH avec mon attelage. Le chariot était chargé de bois de chauffage et sous les bûches, nous avions caché un veau dépecé et une bonbonne de 13 litres de schnaps.
Or, dans NEUNKIRCH, les Allemands avaient établi un barrage. A la vue de ce dernier, nous avons bifurqué vers le bistrot qui était tout près et comme LUDMANN connaissait la serveuse (une rouquine), il y déposa le schnaps. Le reste se passa sans encombre. Cependant, quand LUDMANN revint pour récupérer le schnaps, la serveuse ne le lui a plus rendu et menaça de faire un scandale. Là aussi, il y a laissé des plumes, car l’argent du schnaps était perdu.
Un jour, allant vers la gare de KALHAUSEN avec mon attelage, j’ai pris en charge deux dames allemandes originaires de SARREBRUCK. Elles revenaient d’une tournée où elles avaient été mendier un peu de nourriture. Au cours du trajet, la discussion s’est engagée et au bout d’un moment, je me suis rendu compte à quel point l’une d’entre elles était une fanatique partisane du régime nazi. Elle me dit :
« Je suis mère de trois garçons, j’en ai déjà perdu deux durant ce conflit, mais je sacrifierai encore volontiers le troisième si cela s’avérait nécessaire afin que je puisse au moins une fois baiser la bague du FÜHRER ! ». Il y eut un long moment de silence.
En février 1943, ma sœur Mathilde est aussi rentrée au Couvent de SAINT-JEAN-DE-BASSEL, rejoignant mon autre sœur Thérèse qui y séjournait déjà depuis 1935. Théoriquement, le couvent ne pouvait pas recevoir de nouvelles postulantes, mais nous avons contourné la réglementation allemande, en déclarant qu’elle était infirmière, et ainsi elle put accéder à la vie religieuse.
Je me suis souvent rendu au Couvent pour visiter dans un premier temps Thérèse, puis après, mes deux sœurs. Je leur ai apporté des étoffes, mais aussi de l’argent. En contrepartie, elles me ravitaillaient en légumes et les vieilles sœurs étaient très généreuses.
Avec un genre de tombereau à deux roues attelé d’un cheval, il me fallait environ 5 heures pour couvrir le trajet. Arrivé à BERTHELMING, le cheval connaissait le reste du parcours par cœur et se dirigeait directement vers les écuries du couvent. J’y suis aussi allé à vélo ou en calèche.
Un jour, je me trouvais dans le petit atelier de Charles LANG au Haut-Ville, lorsque j’ai vu passer un chien, genre berger allemand, tenant fièrement dans sa gueule, une tête de cochon. Charles et moi, chaussés de sabots, et malgré le verglas qui recouvrait le sol, nous l’avons poursuivi jusqu’à la "Saalwies" où nous l’avons rattrapé.
Nous avons pu le défaire de sa proie, que nous avons rendue à son propriétaire, Paul SPAETH. Ce dernier n’a même pas daigné nous remercier. J’étais vexé, car nous avions eu beaucoup de peine à rattraper le chien, nous étions exténués et avions le pantalon et les pieds mouillés. Pour ce qui est du chien, comme il était errant, un groupe s’est constitué qui a réussi à le localiser et à l’abattre.
J’ai aussi eu un accident devant la maison de Charles LANG. Ayant voulu faire demi-tour avec la calèche, j’ai tiré un peu trop brusquement sur le guide, le cheval tourna trop court et la calèche se renversa. Moi, je me suis retrouvé coincé dessous, le moyeu de la roue entre les jambes.
Le cheval, effrayé, se mit à galoper. Etant encore agrippé au guide, j’ai tiré dessus et le ramenant de plus en plus, je suis arrivé à stopper rapidement le cheval. J’étais bien sonné, couvert d’égratignures et d’hématomes. Mon père aidé des voisins, m’a transporté à la maison. J’eus droit à la désinfection des blessures avec du schnaps, tout cela ne m’a pas empêché de retourner aux labours le lendemain matin, traînant un peu les jambes et par moment, grimaçant de douleur.
En juillet 1942, Charles BIRCKENSTOCK et Nicolas MULLER se sont rendus au "Jokobsféscht" à RAHLING. Ils étaient en tant que soldats, cantonnés là-bas en 1938-1939 et avaient tissé des liens avec quelques habitants. Dans l’après-midi de ce jour de fête, je les ai rejoints au bistrot et c’est là que j’ai rencontré Ida LANG, ma future épouse.
Elle ne m’était pas étrangère puisque je l’avais connue toute jeune. Mais ce jour-là, des liens étroits se sont établis et ce fut le début de notre idylle. Depuis la mort de ses parents, Ida vivait au sein de la famille LEMMER, chez son oncle Philippe et sa tante Barbe HIEGEL. Ils avaient une fille, Louise,
de 6 ans plus jeune que Ida.
J’ai été rapidement intégré dans la famille et je me rendais régulièrement à RAHLING, faisant le trajet à vélo, mais aussi fréquemment à cheval. Au galop, il me fallait 14 minutes pour couvrir la distance ACHEN - RAHLING, via le MOHRENHOFF. J’y allais aussi pour aider aux travaux agricoles car l’oncle Philippe, un peu voûté, éprouvait des difficultés, souffrant d’une grosse hernie inguinale dont il refusait de se faire opérer.
Le 22 septembre 1942, nous étions en train de remuer le "Schläggel" chez Paul GUNTHER (Ònthons) lorsqu’un avion en détresse a largué des bombes incendiaires dont une est tombée sur la maison JUVING à KALHAUSEN. Nous avons tout laissé et pris nos vélos, en cette belle nuit de pleine lune, pour nous rendre sur les lieux de l’incendie.
Pour le lundi gras 1943, Nicolas MULLER insista pour que je l’emmène à RAHLING. Il y avait de la neige et je n’étais guère enthousiaste pour le déplacement, mais il insista. J’ai fini par atteler le traîneau et nous nous y sommes rendus. Ce n’est que là que j’ai compris le pourquoi de sa demande :
il avait le béguin pour Maria LEDIG, qu’il finira par fréquenter.
Les gendarmes allemands faisaient de fréquents contrôles, s’occupant de futilités : ils contrôlaient les chariots et s’assuraient que les harnais ou brides des chevaux n’étaient pas trop serrés, tout cela pour embêter les petites gens et imposer une certaine rigueur et aussi la terreur. Personnellement, je m’en fichais royalement.
Un jour, sur le pont de WITTRING, le chariot chargé de traverses de chemin de fer, un gendarme m’a sommé de m’arrêter. J’ai continué mon chemin jusqu’après le pont et me suis rangé sur le côté. De suite, il se mit à élever un peu la voix et me signifia que pour n’avoir pas tenu les chevaux avec la lanière, il allait me dresser un PV d’un mark. Je l’ai pris à la rigolade et lui ai répondu :
« Un PV de plus ou de moins, je m’en fous, mais pour le mark, je préférerais le jeter dans la Sarre plutôt que de vous le remettre ! ».
Il entra dans une rage folle, à en avoir l’écume à la bouche, mais n’osa pas aller plus loin dans ses propos car j’étais accompagné de deux autres gars d’ACHEN. De toute façon, s’il avait insisté, je l’aurais balancé dans la Sarre.
Durant les hivers 1941/42 et 42/43, je m’étais arrangé avec ZIEGLER, éleveur de moutons de NEUNKIRCH, pour qu’une partie de son troupeau (150 à 200 bêtes) vienne en pâture à ACHEN et soit parquée sur mes terres afin de pouvoir profiter des crottes de ces bêtes qui étaient un excellent engrais.
Donc, avec un chariot muni d’un grand plateau conçu pour le transport des moutons, je les ai convoyées de SARREGUEMINES à ACHEN, tractant aussi la roulotte du berger.
Arrivés sur place, nous avons dressé une clôture en lattes où les bêtes passeront la nuit. Durant la journée, le berger les gardera en pâturage. Après quelques jours, le parc sera déplacé afin que la fumure soit répartie sur toute la parcelle.
Un des terrains ainsi fumé, je l’ai ensemencé de colza. Ayant entre-temps été enrôlé dans l’armée allemande, je n’ai même pas pu effectuer la récolte,
et c’est mon père qui s’en chargera. Dans un des courriers qu’il m’adressa, il m’informa que la récolte avait été exceptionnelle.
Voici encore deux anecdotes concernant le "Làcher-Fròns", notre ORTSGRUPPENLEITER :
De la KREISBAUERNSCHAFT (groupement des agriculteurs) de SARREBRUCK a émané un ordre de marquage des arbres fruitiers afin d’assainir les vergers. Il fallait, avec de la peinture, marquer d’un trait les arbres qui devaient être élagués, d’une croix, ceux devant être abattus.
Faisant partie des arboriculteurs, je m’étais proposé pour cette opération, mais j’ai laissé traîner la chose. Sur l’insistance de Paul ILLIG, notre ORTSBAUERNFÜHRER qui avait été nommé par le "Làcher-Fròns" et afin de lui éviter des ennuis, j’ai fini par demander à l’ouvrier communal (Karl GROSS) de commander de la peinture.
Quelques jours après, de bon matin, avec l’ouvrier communal, je me suis rendu à la "LACH", près du domicile du "Làcher-Fròns" et où il avait plusieurs vergers non entretenus. Nous avons commencé notre besogne, la grande majorité des arbres a eu droit à un coup de peinture, trait ou croix.
A son réveil, "Fròns", ayant entendu du bruit, avant même d’avoir enfilé correctement son pantalon ouvre promptement les volets de sa chambre. Nous apercevant, il nous demande la raison de notre présence en ces lieux. Le sourire aux lèvres, je le lui explique. Constatant l’ampleur du marquage, il ne
me demandera plus jamais de continuer le travail.
Une autre fois, à la tombée de la nuit, je croise le "Fròns" prenant appui sur la barre de bois crantée servant à accrocher à l’échelle les cochons une fois tués. Ayant eu vent qu’il allait tuer un cochon au noir, je lui dis : « François, tu vas tuer un cochon ? ».
Gêné, il me répond : « Il faut aussi que ça se fasse ! ».
En début 1943, j’avais adhéré au mouvement de Résistance "Ceux de la Libération-Vengeance", mais ce mouvement n’était pas assez structuré sur le secteur et suite à ma période de "Malgré-nous et Réfractaire", je n’ai pu participer à aucune action et seule restait ma détermination "anti-boche".
LA PERIODE DE "MALGRE-NOUS"
INCORPORATION DANS L’ARMEE ALLEMANDE
Au fil du temps, différentes classes d’âge avaient déjà été enrôlées dans la "WEHRMACHT", et mon tour vint inexorablement.
Le 8 juillet 1943, le facteur m’apporta le fameux "STELLUNGSBEFEHL" (ordre d’incorporation).
Le 11 juillet 1943, je devais me présenter au bureau de recrutement installé au Lycée de SARREGUEMINES. J’ai fait mes adieux à ma famille et à ma fiancée Ida. Je n’étais pas le seul du coin à prendre le train à la gare de KALHAUSEN en ce matin du 11 juillet.
Avec 4 autres incorporés, 2 de ACHEN : Aloyse JACOBI et Joseph ROHR et 2 de SCHMITTVILLER : René LEHMANN (Dickos) et Léon DEHLINGER (Héfterpàts), nous avons décidé de descendre avant le terminus. A REMELFING, nous avons quitté le train et sommes allés au bistrot où nous avons fait une dernière fois la fête. Nous avons bu, chanté, et même décroché le portrait de HITLER que nous avons démoli, enfin nous avons entonné la Marseillaise.
Nous avons fait un tel vacarme que les gens s’étaient attroupés devant le bistrot. Nous sommes repartis à pied vers SARREGUEMINES. Arrivés au Lycée,
il fallait se mettre en rangs, deux par deux, pour se présenter devant les recruteurs.
René LEHMANN, encore sous l’emprise de l’alcool, les envoya sur les roses. Il a tout de suite été arrêté et emmené dans la cave où il a menacé de se suicider. Toutes ses affaires lui ont été retirées.
Tous, nous avons subi un interrogatoire, puis reçu des rations pour trois jours, et ensuite, on nous a emmenés à la gare de SARREGUEMINES. Sur le trajet vers la gare, j’ai encore acheté du pain blanc.
Durant le transport par chemin de fer, lorsque des Allemands travaillaient sur les voies, nous leur lancions des boules de pain noir (Bumbernickel), contenant un caillou et lorsque c’était des prisonniers français, nous leur lancions des morceaux de pain blanc.
Pendant ce même trajet, à trois reprises, je suis sorti du wagon et j’ai longé deux à trois wagons pour ouvrir les vannes des conduites à vapeur du système de freinage. J’ai ainsi provoqué trois arrêts du train. A chaque fois j’ai rapidement regagné ma place dans le compartiment et les responsables du convoi n’ont jamais pu trouver le coupable puisque nous étions tous solidaires. Même les Allemands présents dans mon compartiment n’ont osé se manifester.
Nous sommes restés trois jours à BONN, pour ravitaillement, puis direction SPERRENBERG à trente kilomètres de BERLIN. Depuis la gare, il restait 10 km environ à marcher pour rejoindre la caserne. L’encadrement allemand devint de plus en plus sévère. A l’approche de la caserne, j’ai fait une halte et me suis assis sur mon coffre en bois. Un officier m’a demandé de me remettre en route. Je lui ai répondu : « Ici, nous sommes encore à l’extérieur, une fois dans la caserne, ce sera différent. » J’ai continué à me reposer et suis entré le dernier à la caserne.
La caserne abritait le " 4° Bataillon d’un régiment de génie militaire EISENBAHN-PIONNIER" (sapeur des chemins de fer) et je venais d’être affecté
à la 3° compagnie. Ce n’était que des baraquements en bois à un étage.
Après qu’on nous eut remis des effets militaires et indiqué les chambres, nous avons dû les rejoindre avec ordre de nous changer. J’ai réussi à persuader toute la chambrée de redescendre en civil. A notre vue, les Allemands se sont mis à vociférer. Nous nous sommes empressés d’enfiler les habits militaires avant de réapparaître. Les effets militaires étaient un ramassis de toutes sortes de tenues. Pour ma part, j’avais touché une tenue tchèque, dont le pantalon avait une tache et j’ai toujours refusé de le laver.
Dès le premier jour, un FELDWEBEL (adjudant) m’a demandé d’apposer sur l’uniforme l’insigne d’OBERGEFREITER (brigadier-chef), étant donné mon grade dans l’armée française, mais je lui ai répondu : « Je n’ai encore rien appris chez vous, donc je ne vois pas l’intérêt de déjà mettre cet insigne.»
Dans notre unité, il y avait des Alsaciens et des Mosellans, mais essentiellement des sursitaires allemands, qui pour des raisons diverses, avaient pu éviter l’enrôlement jusqu’à présent.
Nous étions des chambrées de 24, et dans ma chambre se trouvait Louis MEYER de BINING. A nous deux, nous étions les rois des magouilles, des exemptions.
Nous avons été soumis à l’entraînement allemand. Le soir, nous étions parfois lessivés. Souvent le sable fin s’infiltrait dans nos bottes et nous avancions péniblement. La nuit, nous étions souvent réveillés et les gradés nous faisaient tourner autour des baraques.
Durant les six premières semaines, la hiérarchie allemande a tenté une intoxication psychologique en vue de nous préparer pour ce qu’ils appelaient
"la plus belle journée de votre vie" : prêter serment au Fuhrer (VEREIDIGUNG).
A la date fixée, j’ai réussi à persuader la vingtaine de compatriotes incorporés de force, alsaciens-mosellans, de refuser de se soumettre et ensemble, nous avons dit avoir prêté serment à la France.
Suite à ce refus, nous avons eu droit pendant 15 jours, à des cours du soir. Puis, le HAUPTMANN (capitaine) vint nous voir en disant : « Ces quelques hommes n’arrêteront pas la guerre, et encourir des sanctions, serait trop bête ! »
Puis la cérémonie a été programmée et s’est déroulée sans incident majeur. Revenu dans ma chambre, un allemand du nom de DRICHEL m’a demandé :
« Qu’as-tu vraiment dit au moment de prêter serment ? » Je lui ai répondu : « Tu le sais aussi bien que moi, puisque tu m’as bien observé, scrutant les mouvements de mes lèvres, et bien, je te le redis : Hitler, je l’emmer.... »
Lors d’un entraînement, Louis MEYER, de BINING, refuse de sauter d’un mur de 4 mètres. Le FELDWEBEL lui donne l’ordre d’exécution et Louis lui
répond : « Sous votre responsabilité ! »
Il saute et volontairement enfonce un peu le pied dans le sol. Résultat : une entorse du gros orteil et exemption de service pour quelque temps.
Fatigués après un retour d’entraînement, nous nous sommes laissés choir sur les lits. Rentre un officier dans notre chambre et pour nous embêter, il nous fait encore faire des exercices physiques : grimper sur l’armoire, puis se coucher sous le lit. J’ai fait semblant de participer. Louis m’a fait un signe qui voulait dire : renversons les armoires. Je n’ai pu répondre à sa demande puisque j’avais rangé dans la mienne plein de provisions et surtout quelques bocaux en verre.
Lui, n’a pas hésité. Il a renversé son armoire et par un prompt réflexe, a pris sa montre et l’a tapée contre le mur pour en briser le verre. Le sous-officier arrêta la séance et vint s’informer de l’incident. Louis exhibe sa montre cassée, puis il va se plaindre auprès du HAUPTMANN. Il lui explique que le port d’une montre-bracelet étant interdit par le règlement, il l’avait rangée dans l’armoire qui s’est renversée suite aux exercices imposés par le gradé. Le HAUPTMANN lui indiqua alors que les frais seront pris en charge par l’armée et l’adressa à un bijoutier. Le FELDWEBEL a été sermonné et il ne se permit plus jamais de telles exactions.
Après quelque temps, Louis MEYER et moi, nous avons été affectés à l’entretien de la salle de sport ; cela nous a permis d’échapper à bien des séances d’entraînement.

Un groupe de notre unité de
la WEHRMACHT
je suis au milieu du premier rang.
je suis au milieu du premier rang.
Les samedis, nous avions souvent des séances de tirs. Lors d’une de ces séances, j’ai été classé second, un Autrichien a décroché la première place. Les deux premiers ont eu un ticket pour le STADTTHEATER de BERLIN.
Nous avons dû partir pour BERLIN, le dimanche avant midi, pour économiser deux repas. En ville, je suis allé dans une pâtisserie. Les femmes faisaient la queue pour acheter quelques maigres provisions, mais les militaires étaient prioritaires. J’ai demandé 1 kg de gâteau (tartes et autres gâteaux fourrés). Le pâtissier m’a demandé si j’avais des marks.
Je lui ai répondu : « Bien sûr et des cartes alimentaires.»
Les femmes présentes m’enviaient au point d’en avoir l’eau à la bouche, car tout en possédant des marks, mais n’ayant pas de cartes alimentaires, il ne pouvait leur être octroyé qu’un petit bout. Nous avons mangé le gâteau, puis nous sommes allés au théâtre où nous avons eu droit à une réception grandiose. L’on aurait cru un instant se trouver sur une autre planète, d’où la guerre serait complètement absente.
Le samedi suivant, nouvelle séance de tir. Au départ de la caserne, le lieutenant nous ordonna de chanter, mais nous n’avons pas obtempéré. Il nous le fit durement ressentir : nous avons dû faire des exercices physiques jusqu’au pas de tir. Durant la séance de tirs, sur les 5 coups que j’ai tirés, je n’en ai mis aucun dans la cible. Le lieutenant m’a réprimandé, mais je lui ai rétorqué : « Après tous ces exercices physiques, je suis trop nerveux pour tirer convenablement ! »
A la fin de la séance, le HAUPTMANN est venu me trouver et m’a demandé des explications pour ces ratés.
Je lui ai fait part de notre mésaventure avec le lieutenant. Il n’y eut plus jamais de tels exercices physiques avant les séances de tirs, d’ailleurs je n’y ai plus participé que trois ou quatre fois.
Aussi longtemps que je participais aux tirs, j’étais volontaire, avec Louis MEYER, pour ramasser les douilles ou les balles à blanc non tirées. Au lieu de les rendre, nous les avons jetées dans les WC...
Nous avons tout fait pour embêter les Allemands, nous savions bien que cela n’arrêterait pas la guerre, mais nous risquions gros car pour de tels actes, l’on pouvait être passé par les armes.
L’argent avait peu de valeur, d’ailleurs je touchais un mark de solde par jour, ce qui était largement suffisant. Ce qui importait, c’était d’avoir des cartes alimentaires et là, je n’étais pas en manque.
Pas mal de personnes m’en faisaient parvenir, entre autres mes parents, ma fiancée IDA, Charles WOLF et Marguerite LANG d’ACHEN, Emile MULLER et sa voisine Bertha LEDIG de RATZWILLER. Tous avaient un petit train de culture, tuaient de temps à autre un cochon au noir et faisaient un peu de troc, alors ils n’avaient pas besoin de toutes leurs cartes d’alimentation. Ils m’ont aussi adressé des colis avec des denrées alimentaires (confiture, lard...). Tout ceci me permit de pallier amplement les maigres et peu savoureux repas servis à la caserne. S’il y avait de la soupe de pain au menu, je ne me suis même pas rendu au réfectoire, j’ai puisé dans mes réserves.
Un lundi, je suis resté dans la chambre et un FELDWEBEL vint fouiner par là. Voyant ce que j’étais en train de savourer, il me dit : « Mais vous vivez mieux que notre HAUPTMANN ! »
Je lui ai répondu : « En aucun cas, je ne voudrais échanger avec le HAUPTMANN ! »
Nous avions aussi droit à des leçons de natation une fois par semaine. Comme je ne savais pas nager, j’aurais bien aimé profiter de ces séances pour apprendre, mais j’ai rapidement changé d’avis. Ces séances se déroulaient à un lac et les candidats étaient rassemblés sur le ponton, une corde nouée autour du buste. Les moniteurs les jetaient à l’eau et souvent ne les retiraient que lorsqu’ils étaient déjà cyanosés.
Pour me soustraire à cette pratique, à chaque séance, après avoir enfilé le maillot de bain, je suis rentré dans l’eau et sans me faire remarquer, je me suis réfugié sous le ponton où il y avait juste assez de place, entre l’eau et les planches pour pouvoir maintenir la tête hors de l’eau. Au coup de sifflet annonçant la fin de l’exercice, je suis remonté sur la rive. Cela a duré quatre mois et demi, je n’ai jamais été découvert, dans ma cachette. Malheureusement, je n’ai pas appris à nager alors qu’avec un brin d’humanisme de la part de l'encadrement, cela aurait été possible.
Je n’ai jamais lavé mes habits militaires. A plusieurs reprises, des supérieurs m’ont demandé de laver mon pantalon de treillis (taché au moment de l’attribution). Plus tard, lors d’un entraînement, alors qu’il fallait grimper aux arbres, j’ai fait exprès d’accrocher le pantalon à un bout de branche et je me suis laissé glisser le long du tronc, pour que le pantalon se déchire. Au rassemblement, je me suis mis au premier rang, avec le pantalon abimé, La réaction fut rapide, le lieutenant me demanda des explications que je lui fournis allègrement. Il m’a envoyé au service d’habillement où je devais me présenter de sa part, pour échanger le treillis.
Pendant des manœuvres, nous avions été divisés en deux groupes. J’avais été chargé de surveiller le téléphone pour l’une des équipes ; je n’y ai même pas prêté attention. Au bout d’un moment, j’ai été surpris et neutralisé par le groupe adverse. Ils m’ont questionné sur l’emplacement de mon équipe, mais je n’ai pas soufflé un mot. Vers le soir, l’officier dit : « Puisqu’il reste muet, je pense qu’il va falloir le persuader par un coup de crosse
de fusil ! »
Je lui demande alors s’il a l’habitude d’employer de telles méthodes ; mais si c’est sa première expérience de ce genre, qu’il essaie et il verra déjà. Ayant rapidement analysé la situation, il ne m’a plus jamais embêté.
Etant souvent exempt de service, j’avais largement le temps pour faire mon courrier. Tous les jours, j’écrivais à ma fiancée. A plusieurs reprises, je lui ai fait savoir que si elle n’avait plus de nouvelles, c’est que j’aurai été passé par les armes, suite à mes nombreuses actions anti-allemandes.
Un jour, un sous-officier voulait me faire faire des corvées, je lui ai rétorqué en disant : « Ça fait trois mois que je suis ici et l’on n’a même pas le temps d’écrire une lettre ! ».
Il m’a répondu en ces termes : « Je suis là depuis bien plus longtemps et n’ai pas le temps d’écrire ! »
J’ai surenchéri : « Ce que vous faites ne me regarde pas ! »
Pour l’avoir offensé, puisque cet incident a eu lieu devant toute la chambrée, il m’a convoqué dans son baraquement. L’ayant rejoint et en présence d’autres sous-officiers, il m’a dit : « Changez d’attitude, car comme cela, vous n’irez pas loin. Il faut savoir dire oui, même si vous pensez le contraire. »
Tous les Allemands n’étaient pas des hitlériens. Dans notre unité, j’étais en contact avec les pro et les anti-Hitler. J’ai même sympathisé avec quelques-uns.
Un OBERLEUTNANT (lieutenant) m’a demandé un jour : « Est-ce que vous vous plaisez dans l’armée allemande ? »
Ma réponse fut : « Je suis là contre mon gré et je fais ce que l’on m'ordonne. »
Il rétorqua : « Je suis aussi de votre avis et je pense la même chose que vous ».
Un jour, un collègue allemand, DRICHEL, (Reisenbahn-Inspektor), habitant BERLIN, m’a invité ainsi qu’un Autrichien à venir un dimanche prendre le goûter à 16 heures. En arrivant sur place, j’ai dû constater qu’il habitait avec sa famille un très bel appartement, qu’il disposait d’une vaisselle rutilante, qu’il avait soigné la présentation mais qu’il y avait peu à se mettre sous la dent. L’ensemble ne représentait même pas une portion pour une personne. L’argent ne lui manquait pas, mais toujours le problème de ces fameuses cartes d’alimentation. J’ai donc envoyé son fils de 10 ans avec mes cartes alimentaires faire des achats. Il ramena du pain et deux ou trois variétés de saucisses et ce jour-là, tout le monde a pu manger à sa faim.
Dans notre groupe, il y avait un petit bonhomme pro-nazi, fier d’être incorporé. Au bout de quelques semaines, il avait été démobilisé comme soutien de famille, parce qu’il avait 9 enfants à charge et il n’arrivait pas à assurer leur subsistance. Il n’a même pas voulu quitter la caserne et a dû être renvoyé de force. C’est là que je compris la raison de son comportement
Les dimanches, bravant l’interdiction des visites, les Allemands enrôlés dans notre régiment, étant pour la majorité originaires de BERLIN ou des environs, recevaient la visite de leurs épouses ou fiancées.
Lorsque la chambre était pleine de visiteurs, je me levais doucement de mon lit et d’une façon provoquante j’ouvrais mon armoire pour en sortir toutes sortes de victuailles (lard, pain blanc, confiture...). Comme la population était affamée, ces gens ne supportaient pas de voir tant de denrées. En quelques instants, la baraque se vidait de ses occupants.
Un Allemand, me voyant manger du lard, m’a demandé un jour s’il ne pouvait pas avoir la couenne. Par curiosité, je lui ai demandé pourquoi. Il m’a répondu: « J’en prendrai un petit morceau que je mâcherai, cela coupera ma faim et le restant, je le remettrai à ma femme pour qu’elle puisse encore une fois faire une bonne soupe. »
Des cigarettes nous étaient aussi attribuées. Comme je ne fumais pas, je les remettais à un Tchécoslovaque du nom de POPOLSCHEID, boucher dans le civil et qui en contrepartie me faisait toutes les courses, parfois au risque de sa vie.
Dans une des baraques de la caserne, deux chambres étaient réservées à des prisonniers russes. Le dimanche, ces prisonniers devaient faire du bois pour des poêles installés dans nos chambres et nous devions les surveiller, avec interdiction de leur adresser la parole. A un moment, j’ai entamé la conversation avec l’un d’eux qui était un officier supérieur, il parlait un bon français.
Nous avons pu échanger quelque peu, c’était un homme instruit, clairvoyant, critiquant les nazis en disant : « Les parades que les Allemands organisent continuellement ne servent à rien, on parade après la guerre, mais encore faudra-t-il qu’ils en aient les moyens ! »
Je devais me tenir sur mes gardes car je risquais d’être fusillé pour avoir dialogué avec un Russe.
Je n’ai jamais été engagé dans un combat et sur les quatre mois et demi que j’ai passés au sein de l’armée allemande, j’ai réussi au total à me faire porter malade 7 semaines et demie, sans compter les exemptions. Je me suis souvent fait inscrire sur la liste des consultants de l’infirmerie pour des futilités comme un petit abcès à la main que j’ai frotté sans arrêt pour l’irriter et le faire enfler.
J’ai aussi simulé des problèmes cardiaques. Dans le doute, le médecin du régiment m’a envoyé chez un cardiologue à LUNDERBOCK. Au retour, le lendemain matin, je suis retourné voir notre médecin pour la reprise du service. J’appréhendais ce moment car le cardiologue, dans son compte-rendu, mentionnait n’avoir diagnostiqué aucun trouble et je me suis fait traiter de tous les noms par le médecin de notre unité.
Ce fut mon jour de chance, ma compagnie devait aller en intervention à BERLIN et je me suis porté volontaire. Notre régiment était destiné à intervenir en cas de gros dégâts sur des voies de chemin de fer. Nous sommes restés 10 jours à BERLIN. J’y ai vécu le premier grand bombardement de la ville. Nous avons trouvé refuge dans des abris souterrains. Tout tremblait, c’était comme un sentiment de fin du monde. Il y eut de nombreuses victimes civiles. Le lendemain matin au réveil, nos supérieurs nous ont ordonné de chanter.
Lors d’une autre intervention à BERLIN, nous sommes arrivés en début de soirée et avons été hébergés dans une école. J’ai lancé mon paquetage au fond d’une salle de classe et avec un collègue, je suis allé visiter la ville. Au retour, vers 2 heures du matin, nous avons été accueillis par les vociférations d’un Feldwebel qui nous demanda si nous avions eu la permission de nous éloigner et où était notre paquetage.
Je lui répondis: « Là-haut, dans une des salles, et personne n’y a touché ! »
Il est vrai que je m’étais taillé une certaine image et tous avaient appris à me respecter. Le Feldwebel nous a donc accompagnés pour reprendre nos affaires et l’incident fut clos.
Nous avons aussi été en intervention à KASSEL, qui à l’époque était la plus grande gare de triage d’Allemagne. Il y régnait une vision apocalyptique de fin du monde. Toute la gare et les environs avaient été rasés par un bombardement et par endroits il y avait des trous béants de 100 à 150 mètres de profondeur. En effet, ces cratères avaient été creusés par l’explosion d’un certain nombre de ces fameuses fusées V1 qui, entreposées sur des wagons, avaient explosé au moment du bombardement.
Dans un autre coin, le souffle avait envoyé trois locomotives, les unes sur les autres et elles étaient restées figées, encastrées. Il a fallu les découper au chalumeau. J’avais demandé à un soudeur de me prêter son appareil pour faire un essai. Manque de pot, j’ai cramé le chalumeau. J’ai eu pas mal d’ennuis à ce sujet et j’ai été soumis à un interrogatoire car les Allemands pensaient que je l’avais saboté.
Des prisonniers russes ont été employés pour remblayer les trous, puis vint la remise en état des voies. Alors que j’étais chargé de contrôler le serrage des tire-fonds (vis de fixation des rails sur les traverses), j’aperçus un lieutenant qui était tombé dans une sorte de fosse septique. Je le signalai à mes collègues et, tête baissée, continuai mon travail.
Les deux collègues se redressèrent et regardèrent dans la direction que je leur avais indiquée. Le lieutenant les aperçut et les appela à son secours pour l’aider à sortir. Ils l’ont tiré de sa mauvaise posture, puis ils ont encore dû le nettoyer tandis que moi, je continuais mon contrôle, souriant en douce.
Fin novembre, dix jours de permission m’ont été accordés. L’un ou l’autre de mes collègues m’a dit à mon départ : « Je pense que nous ne te reverrons plus. »
La menace qu’au retour, notre unité soit envoyée au front était des plus probables, mais de toute façon, mon plan était pratiquement arrêté.
Louis MEYER est parti en perme en même temps que moi.
Après les joyeuses retrouvailles à ACHEN, j’ai participé aux activités familiales. Durant la perme, en revenant au village par le VAL d’ACHEN avec deux sacs de blé sur le traîneau, j’ai croisé, à l’entrée de la localité, le gendarme FATLER de KALHAUSEN qui venait d'appréhender Arthur KIMMEL pour braconnage.
Le gendarme tenait dans une main le fusil brisé en deux du braconnier et de l’autre, poussait son vélo, tandis que le prisonnier le précédait de quelques pas.
Quelques mètres plus loin, je croise aussi Albert DEHLINGER (de Kättler), je lui suggère de se rapprocher du gendarme et d’engager le dialogue, Arthur comprendra la manœuvre. L’astuce a bien marché, puisque le gendarme en conversation avec Albert, relâcha un peu son attention. Arthur prit quelques mètres d’avance et après les casernes, il dévala le talus et se mit à courir en direction de la forêt de WEISDESHEIM. Le gendarme surpris, ne réussit pas à le rattraper. Une grande battue fut alors organisée par les Allemands, le bois passé au peigne fin, mais le fuyard n’a pas été retrouvé. Par la suite, il réussit à se rendre en zone libre.
PERIODE DE REFRACTAIRE
Vie en clandestinité
Le 5 décembre 1943, la permission est arrivée à terme. Le matin, je
suis encore allé voir Louis MEYER, lui confirmant mon intention de
déserter. Louis, ayant déjà perdu un frère sur le front russe,
était encore quelque peu indécis. Devant ma détermination, il
adopta la même résolution que moi : nous ne repartirons plus. Le soir,
j’ai fait mes adieux à ma famille. Ce même 5 décembre, mon frère Paul
m’a ramené en calèche à la gare de KALHAUSEN où j’étais sensé prendre
le dernier train de la journée, en partance pour SARREBRUCK.Je suis bien monté dans le train sous les yeux de mon frère, mais ressorti de l’autre côté, j’ai dévalé le talus et rejoint Albert DEHLINGER qui m’attendait avec un vélo pour transporter ma valise. Puis, à pied, nous nous sommes rendus à RAHLING chez la famille Philippe LEMMER où habitait ma fiancée. J’avais eu leur assentiment et ainsi pu préparer mon stratagème, laissant ma famille ignorer ma désertion.
Pourtant, quelques jours après, mon père a eu un courrier de la responsable du noviciat du couvent de SAINT-JEAN-DE-BASEL qui avait surpris des bribes de conversation lors de ma visite à mes sœurs et ces dernières, interrogées, avaient divulgué mon projet.
Dans cette lettre, elle demandait seulement à mon père de nettoyer la maison : ce dernier comprit le message évoquant la menace d’une éventuelle perquisition, mais il ne comprenait pas trop bien à quel sujet. Pour la sécurité de la famille, il a fait disparaître de la maison tout ce qui était proscrit.
Les Allemands viendront deux à trois fois aux renseignements auprès de mes parents sans trop les inquiéter et interrogèrent mon frère qui m’avait vu monter dans le train.
Pendant ce temps, à RAHLING, j’essayais d’organiser ma nouvelle forme de vie : la clandestinité. Pendant toute ma période réfractaire, j’ai continué à être armé, portant un revolver chargé et mon couteau de boucher. Ma devise était toujours : « Jamais, ils ne me prendront vivant ! »
J’ai préparé différents repaires, aménagé une première cache dans la porcherie où j’ai creusé un trou, l’oncle Philippe se chargeant de disperser la terre derrière la maison et dans le jardin afin de ne pas éveiller de soupçons. J’ai recouvert ce trou avec une large planche sur laquelle j’avais fixé de la paille.
J’ai fait une deuxième cache dans le fenil, sous le foin. Pour accéder au fenil, j’ai dégagé quelques planches du plafond de l’écurie et arraché du foin jusqu’à y avoir suffisamment de place pour pouvoir m’y réfugier. J’ai consolidé ma cachette avec des rondins de bois. Pour y accéder, je devais grimper sur la séparation installée entre les deux chevaux.
J’ai prévu un troisième endroit de repli, dans la cave à betteraves, élevant un mur de betteraves de part et d’autre. L’accès se faisait à partir d’une trappe dans le plancher de la "Kòmmer" (petite chambre).
Lorsque je suis entré en clandestinité, l’on espérait déjà un débarquement allié et une rapide libération selon les informations recueillies sur les tracts lancés par la RAF "Royal Air Force" ou diffusées par le "SCHWARTZ-SENDER". S’ils avaient su par avance que la libération était encore si lointaine, peu de jeunes auraient endossé le statut de réfractaires, mettant en péril non seulement leur vie mais également celle de leur famille.
Un an de vie recluse, c’est long. Il a fallu s’organiser !
Toutes les nuits, je dormais dans le lit, dans une des chambres du premier étage.
J’ai aussi vadrouillé un peu ; je me souviens m’être rendu une fois de nuit à ACHEN, chez mon parrain Charles WOLF. J’y suis resté deux jours puis je suis revenu à RAHLING, toujours de nuit.
A la faveur de la nuit, Ida et moi, nous sommes aussi allés à pied à BINING chez Marie FERS. J’y ai séjourné un jour, mais je ne me sentais pas en sécurité et la nuit suivante, je me suis rendu au VAL d’ACHEN chez Emile LETZELTER. A mon arrivée, son chien a aboyé comme un fou. Au bout d’un moment, Emile, tout angoissé, sortit pour calmer la bête. M’ayant aperçu, il fut tout surpris de ma présence et en même temps soulagé car il me dit :
« Ton frère Paul est justement là en train de découper le cochon qu’on avait tué au noir. »
Il m’a fait entrer en douce, puis je me suis assis sur l’escalier du grenier écoutant leur conversation dont le thème principal était ma disparition.
Emile n’a pas soufflé mot à mon frère sur ma présence et lorsque ce dernier fut parti, il m’a offert l’hospitalité.
Le lendemain, depuis la fenêtre, j’ai pu apercevoir mon père qui était en train de labourer le jardin que nous avions près des casernes.
Je suis resté 5 à 6 jours chez la famille LETZELTER, aidant à faire de la saucisse et du fromage de tête, puis ayant été informé qu’une éventuelle perquisition devait être effectuée dans les casernes, je suis retourné à RAHLING.
Durant toute la période "réfractaire", j’étais actif, je me rendais utile par mille menus travaux domestiques : j’ai entretenu le feu, j’ai cuisiné, parfois des repas entiers, j’ai confectionné des brosses, des étriers, fabriqué des cordes, j’ai réparé des chaussures, j’ai même fait des sandales avec le cuir de deux bottes de Hussard de 14/18 qui avaient appartenu à "l’oncle Martin de GROSBLIEDERSTROFF", comme disait la Louise, cousine de ma fiancée.
J’ai tressé des paniers en osier, confectionné des balais avec des branches de bouleaux, j’ai tanné la peau d’un veau, j’ai descendu du fenil les rations quotidiennes de foin, j’ai fourragé les bêtes, j’ai trait les vaches, j’ai remis en état la batteuse installée sur le fenil, en la démontant complètement, puis la remontant. J’ai aidé à décharger le foin, à battre le blé. J’ai tué deux cochons et un veau. Souvent, j’étais déguisé en femme, pour éviter d’être reconnu.
J’ai tissé des liens étroits avec les voisins de derrière, Victor FABER (Mìllerschnickolas Vìckdor) et son épouse Marie, née ECKERT, dont les jardins étaient contigus (plus tard, maison « JOB », rue du moulin).
Pour faciliter un passage discret entre les deux maisons, nous avions souvent étendu deux à trois draps par-dessus les fils à linge. J’ai rendu de multiples services à Victor, je lui ai même pavé l’étable, mais un jour, alors que j’étais affairé à aménager une cache pour la viande dans le fond de la grange, voilà que le fameux "Valencier", le "Schublàddehupser" entre dans la grange. Comme il portait des lunettes à gros verres et qu’elles se sont couvertes de buée, il n’a pas pu m’apercevoir dans la pénombre. Dans le cas contraire, il ne me restait plus qu’à envisager son élimination.
Un matin, me trouvant à nouveau chez Victor FABER, en train de bricoler dans la "Schdùbb", ce dernier vient me voir en disant :
« Aujourd’hui, vous n’aurez rien à manger, mon beau-père, Bernd ECKERT, est dans la cuisine et en principe, il en a pour un moment, mais je vais essayer de trouver un stratagème, puisqu’il ne te connaît pas ».
Peu après, Victor revient, me fait sortir de la pièce et me présente comme un réfugié français qui confectionnait des balais. Un moment, le Bernd me pose une question et je lui réponds dans un mélange de français et d’allemand. Ebahi, le vieux monsieur s’exclame dans son parler d’Alsace Bossue d’où il est originaire : « Lòu, dèr kònn schùnn gùtt dèitsch ! » (Regarde, il sait déjà bien l’allemand !).
Victor et Marie avaient une petite fille prénommée Bernadette, née le 04 février 1943. Dès qu’elle sut balbutier ses premiers mots, ils la conditionnèrent pour qu’elle m’appelle « Pàtt » (parrain) afin qu’elle ne puisse, à mon égard, éveiller l’attention de quelqu’un de mal intentionné.
J’ai aussi noué des liens avec les voisins d’en face, la famille Pierre WEISS (Hùpperts Pétter), qui a aussi hébergé des réfractaires, à commencer par leur propre fils, Marcel, à peine 18 ans et qui était très instable, puis Emile GRABHER, originaire du NEUBAU et fiancé à l’une de leurs filles : la Hilda. Leur neveu Jean-Nicolas WEISS a aussi trouvé refuge chez eux, de même que par intermittence les frères Alphonse et Alfred SCHELL.
Il ne fallait pas trop étendre le cercle des contacts afin d’empêcher une quelconque indiscrétion des adultes mais aussi celle, innocente, des enfants, mais il fallait aussi se méfier de certaines personnes qui avaient sympathisé avec l’ennemi, tel le vieux cordonnier EDERLE (de Schùmmàcher Schwob) et son épouse. Ils habitaient le voisinage (trois maisons plus haut) et par deux reprises, j’ai pu vérifier leur conviction boche. Le cordonnier, un jour, s’est empressé de contrôler le contenu d’un sac de grains que le voisin Joseph EICH venait de déposer sur le plateau d’une camionnette d’une de ses connaissances. Puis, une autre fois, lorsqu’un Feldwebel était en train de recenser d’éventuelles chambres disponibles pour loger des troupes, la femme du cordonnier s’adressa à lui en disant : « Vous pourriez encore réquisitionner pas mal de chambres à travers le village pour le cantonnement des troupes, mais beaucoup de familles ont un fils réfractaire et de ce fait, ne peuvent loger des militaires. »
J’ai évité les contacts avec les voisins directs, la famille Joseph EICH dont le fils Joseph (même prénom que le père) s’était aussi caché pendant un court moment, mais la mère a tellement insisté qu’il a fini par rejoindre son régiment. Il a pleuré à chaudes larmes lorsqu’il a fait ses adieux. Affecté au front russe, il n’en revint plus.

Petite charrette (e Wäänel)
J’étais une fois occupé à préparer le repas, remuant les choux dans la marmite, alors que l’oncle Philippe était assis sur le banc de la cuisine. Voilà que le jeune voisin Ernest EICH, 10 ans, vient demander l’autorisation d’emprunter la carriole. Sans attirer l’attention, j’ai dit à l’oncle Philippe : « Où est la charrette ? » Et il a répondu : « Vraisemblablement dans la grange ». Il a alors quitté le banc pour accompagner le petit Ernest, qui n’avait rien remarqué d’anormal quant à ma présence en ces lieux, puisque nous avions su garder notre naturel.
Bernard FERS de BINING, réfractaire et ami de la famille, est venu à deux ou trois reprises se réfugier chez nous, mais à chaque fois, il n’est resté que quelques jours, le temps que la situation décante à BINING où momentanément régnait une certaine insécurité. D’ailleurs, les réfractaires de BINING,
mal organisés, vivaient pour la plupart dans des abris en forêt.
Marguerite LANG, originaire d’ACHEN, était venue une fois à RAHLING, pour me mettre en garde, car j’étais recherché dans mon village natal. Cette dame m’avait ramené un gros morceau de lard.
Le 16 mars au soir, la rumeur d’une rafle pour le lendemain, sur le secteur, courait à BINING et à RAHLING. Bernard FERS est venu trouver asile chez nous, tandis que deux autres réfractaires de BINING devaient aussi nous rejoindre le lendemain. Or le lendemain matin, peu après 4 heures, alors que j’avais débuté la traite, Victor FABER est venu me trouver en disant : « Le village est encerclé par un bataillon de Mongols ! »
Avec Bernard, je me suis réfugié au fenil, un sentiment de crainte et d’angoisse s’était emparé de notre maisonnée. En début de matinée, l’oncle Philippe, très nerveux, après avoir ouvert la porte de la grange, a commencé à hacher du foin avec un hache-foin relié à un moteur électrique par une courroie. Cette courroie a sauté à plusieurs reprises. Observant la scène, je lui ai fait signe d’arrêter, mais lui, m’a demandé de rester caché car les Allemands patrouillaient dans la rue. Au bout d’un moment, n’en pouvant plus de voir ce manège, je suis descendu par l’échelle, ai fermé la porte et monté correctement la courroie. La réparation terminée, j’ai rouvert la porte au moment où quatre Allemands, baïonnette au fusil, effectuaient leur patrouille dans la rue. Je suis remonté au fenil, tandis que l’oncle Philippe reprenait son hachage de foin.
Vers 10H30, j’ai essayé de dégager sous le toit quelques briques du mur afin d’avoir une vue sur le carrefour et la route principale. Une brique étant fendue en deux, la moitié m’a échappé et est tombée au sol, à l’extérieur, juste à côté de Pierre ROHR, un voisin (Purte Pétter), qui était venu observer l’arrestation de la famille ACKERMANN. Ayant frôlé la mort, il a quitté les lieux sans demander son compte. L’incident de cette malencontreuse chute de la demi-brique aurait pu être fatal pour toute la famille. Si Pierre ROHR avait été blessé ou si une patrouille était passée au moment où la brique est tombée, la maison aurait sûrement été fouillée.
Ce jour, j’ai pu apercevoir pour la dernière fois trois réfractaires qui avaient été arrêtés : Joseph ACKERMANN et les deux frères Eugène et Toussaint RIMLINGER. Joseph et Eugène ont été arrêtés en forêt, tandis que Toussaint a été découvert à son domicile, à la SAUMUHL, alors qu’il était malade.
Ils seront tous les trois déportés en camp et n’en reviendront plus. Les deux familles respectives ont aussi été déportées. Ce 17 mars 1944 restera à jamais gravé dans les annales du village.
Les deux réfractaires de BINING, Joseph MEYER et Louis GEYER, s’étaient réveillés trop tard, en ce 17 mars et ils n’ont pu nous rejoindre, puisque BINING avait aussi été encerclé et fouillé. Joseph a encore tenté de sortir du village, mais il sera malheureusement abattu par les Allemands sur la route de SINGLING, à une centaine de mètres des dernières maisons.
Quant à Louis, il a été arrêté à son domicile. Pour le ramener à la mairie, deux Allemands lui avaient jeté une couverture par-dessus les épaules et le tenant en joue avec leurs fusils, le faisaient marcher devant eux. Arrivé près d’une ruelle, Louis a lancé la couverture sur les fusils de ses accompagnateurs. Ces derniers, surpris, ont mis quelques instants à réagir, ce qui lui a permis de s’enfuir, de se réfugier dans le clocher et de se cacher sur des poutres, au-dessus des cloches. Malgré toutes les recherches, il n’a pas été repéré. Il mourra dans les années 1950 dans un accident de train.
Après tous ces émois, la vie reprit son cours. Quelques jours plus tard, Bernard FERS est reparti à BINING et j’ai à nouveau vaqué à mes occupations.
Dans la nuit du 1er au 2 mai, il y eut une alerte aérienne. Une bombe ayant manqué sa cible, tomba au lieu-dit "ROHRECH".
Durant la fenaison, Martin LEMMER et sa femme Lisa de GROSBLIEDERSTROFF, relativement âgés (oncle et tante de Louise) sont venus prêter main forte pour rentrer le foin. Ils resteront 10 jours et ne remarqueront pas ma présence, bien que je leur préparais le café pendant qu’ils faisaient leur toilette et que je cuisinais les repas quand ils étaient aux champs. Quand ils montaient à l’étage le soir, je montais en même temps au grenier, en faisant coïncider les bruits des pas et, le matin, même scénario dans le sens inverse. Il fallait se méfier de Lisa (d’origine allemande), car elle était jalouse. Elle disait :
« Mon fils est à la guerre, alors que d’autres les gardent à la maison. »
Un jour d’été, les sirènes se sont mises à hurler, annonçant une nouvelle alerte aérienne. Toute la famille se réfugia alors rapidement dans la cave et moi, je suis resté au premier étage, d’où j’ai pu assister au spectacle des avions qui larguaient les bombes. A chaque lâcher, j’ai prévenu les autres. La cible choisie était le dépôt de munitions, à la sortie de RAHLING, vers LORENTZEN. Dix à douze bombes ont été larguées, mais elles ratèrent leur but. Plusieurs explosèrent aux lieux-dits "Herlebérg et Altrof" et d’autres sur BUTTEN où il y eut deux victimes civiles. RAHLING fut relativement épargné, il y eut quelques impacts d’éclats, mais pas de destruction d’immeubles. Un petit éclat est entré dans notre cave, faisant éclater la tonne à choucroute. Tante Barbe était à côté et a subi une légère éraflure à la jambe.
Pour la fête du village " 'S JOKOBS FÉSCHT", fin juillet, mes deux sœurs, Hilda et Madeleine sont venues à RAHLING et c’est là, qu’elles m’ont retrouvé, après 8 mois de séparation. J’ai ainsi aussi appris que mon père avait dû faire abattre un de mes chevaux, le "Grisette". Il était tellement rebelle qu’il n’y avait pas eu d’autre solution, quant au deuxième, "Marquis", les Allemands, suite à une dénonciation, l’avaient confisqué bien qu’il fut caché derrière un tas de paille chez Charles WOLF. Mon père s’en servait de temps à autre pour des travaux agricoles, le voilà désormais complètement démuni.
A la fin de l’été 44, alors que les Américains progressaient, les Allemands réquisitionnaient sur le secteur, les gens valides pour creuser des tranchées antichars. Ils avaient confié la tâche à des membres locaux de la SA (Sturmabteilung) pour conduire ces opérations.
A RAHLING, ce furent les collabos, Jacques FERSTLER et Valentin HOFFMANN (Valencier) qui ont fait la tournée du village et réquisitionné les personnes.
En tenue de SA, ils se sont présentés devant notre maison. FERSTLER disait : « Ici, il y a également deux jeunes femmes qui pourront aider ! »
Observant la scène depuis la fenêtre du premier étage, caché à leur vue par un store intérieur, j’avais pointé le revolver sur FERSTLER, prêt à appuyer sur la détente. Au même moment, est arrivé Victor FABER qui m’a empêché de commettre l’irréparable. Les deux "SA-Männer" ont frappé à la porte de notre maison, mais n’obtenant pas de réponse, ils sont repartis.
Henri SPIELMANN (Hoschekops Haary) habitant aussi le voisinage, écoutait souvent la radio libre de LONDRES (Schwarzsender) et informait ses voisins des dernières nouvelles sur les alliés.
Mi-octobre, Joseph LEMMER (originaire de METZ et cousin de Louise) déserte à MAINZ en même temps qu’un gars de SOUCHT et un autre de METZ.
A pied, ils ont rejoint la région. Joseph est venu se réfugier chez nous, il restera jusqu’à la libération.
Une quinzaine de jours avant la libération, nous avions tué un cochon et le gendarme FATLER, qui était à la recherche de prisonniers italiens évadés du camp de WEIDESHEIM-WITTRING, "les BADOGLIOS", en aperçut un qui venait de sortir de notre maison avec de la nourriture que lui avait remise la tante Barbe. Il est venu aux renseignements vers la maison. Pensant qu’il allait pénétrer dans la maison, je me suis engouffré dans la cache de la porcherie pour n’en ressortir que lorsque la situation était apaisée. Les huit derniers jours, nous entendions les canons qui tonnaient et se rapprochaient de jour
en jour.
Quatre ou cinq jours avant leur retraite, les Allemands volèrent le restant de pain dans notre cave. En face, chez les WEISS, il y avait un four à pain. Je leur dis : « Si vous avez de la farine, je vous fais du pain ». Il en restait 65 livres dans une cache, j’ai cuit pas mal de miches de pain et je les ai ramenées dans notre cave.
Trois jours avant l’arrivée des Américains, le matin, j’ai observé deux soldats Allemands qui semblaient à la recherche d’un refuge. Ils ont lorgné sur la porte de la cave chez "Hupperts". J’ai tout de suite pensé qu’ils faisaient partie du groupe qui devait saboter le pont, car la rumeur courait que cela était prévu pour 14 heures. Dès qu’ils furent repartis, je suis allé barricader la porte. Par la suite, ils sont revenus et ont essayé, sans succès à s’abriter dans la cave.
Le pont a sauté à 15 heures alors que de temps à autre, un obus américain atteignait le village, occasionnant des dégâts et provoquant trois victimes. Le dernier jour, un canon mobile allemand s’est déplacé en plusieurs endroits du ban, tirant un ou deux coups à chaque halte, faisant croire à toute une armada.
Les gens se sont terrés dans les caves et les abris, et ce soir du 5 décembre, des éclaireurs américains ont fait une petite incursion dans le village. L’on se préparait pour un accueil triomphal. Déception ! Le lendemain matin, l’artillerie américaine a pilonné le village. Tante Barbe et Victor FABER se sont réfugiés dans la cache au-dessus des chevaux. Il y eut beaucoup de dégâts : des maisons détruites, d’autres incendiées et il y eut encore une victime civile. Je me suis réfugié dans la cave chez "Hupperts", avec Ida et Louise. Nous pensions nous trouver en sécurité lorsqu’un obus au phosphore mit le
feu à la maison.
Pendant un moment, nous avions cru que notre fin était proche. En cet instant tragique, nous avons fait la promesse qu’en cas de survie, nous effectuerons, à pied, un pèlerinage à MARIENTHAL. Nous avons réussi à nous sortir de cette situation désespérée et les hommes ont tenté d’éteindre l’incendie, mais en vain. Entre temps, le reste de la famille s’était réfugié dans la cave voûtée de Jacques et Jeanne ERHARD (Kruwlische Schààk).
Ce 6 décembre 1944, à 14 heures, par un temps maussade, les Américains entrèrent au village. J’étais tellement déçu par le pilonnage qu’ils venaient d’effectuer que je me suis empressé de briser le beau drapeau tricolore avec une croix lorraine prévu pour pavoiser et dont j’avais si bien pris soin pendant tous ces mois.
Les soldats américains sont descendus par la rue de SCHMITTVILLER, un char au milieu, une colonne de fantassins de part et d’autre. Lorsqu’ils sont arrivés près de notre maison, je suis sorti en pantoufles, puis, passant entre leurs rangs sans les regarder, je suis allé rejoindre les miens dans cette cave voûtée. Le village étant désormais libéré des Allemands et investi par les "HOKE". J’ai enfilé les sabots du "Kruwlische Schààk " (il avait une grande pointure, plus de 50) et avec Ida, tante Barbe, oncle Philippe et Louise, j’ai rejoint notre maison.
Après avoir pris un peu de nourriture, je me suis mis en devoir de réparer le toit où les dégâts étaient peu importants, mais l’habitation avait pas mal souffert : sept impacts d’obus ont été relevés, la façade était éventrée, les pièces du rez-de-chaussée dévastées. Les jours suivants, avec quelques volontaires, j’ai effectué des réparations sommaires, puis je suis allé donner un coup de main à d’autres sinistrés dont Marie ZINS (‘s Schrinner Marie).
Le mauvais temps persistait et pendant que nous réparions son toit, j’étais tellement trempé que j’ai dû me changer et enfiler une vieille chemise de dimanche de son mari Karl.
LA PERIODE DE PRISONNIER DE GUERRE
Cinq jours après la libération, le 11 décembre 1944, les Américains convoquèrent les réfractaires et les insoumis et leur firent savoir ceci :
« Vous n’avez pas de papiers d’identité en règle, nous allons vous emmener un peu en retrait du front pour régulariser la situation. »
Tels quels, avec nos vieux habits, ayant juste pris un nécessaire de toilette, nous avons été regroupés dans la maison HOFFMANN (Miikätts Huss) sur
la "Plättsschdèèn" située à l’angle de la rue de ROHRBACH et de MONTBRONN.
De là, nous avons été convoyés à LORENTZEN et parqués dans une grange. La situation s’était singulièrement aggravée.
Il a fallu rendre couteaux et armes et à partir de ce moment-là, nous avons été considérés comme des prisonniers. D’autres réfractaires des environs sont venus grossir les rangs. Des gardes armés jusqu’aux dents nous encadraient.
Après 48 heures, des rations pour trois jours nous ont été distribuées, puis, nous avons été amenés à la gare où l’on nous a fait monter dans des wagons à bestiaux : 60 prisonniers dans un wagon qui théoriquement ne pouvait en accueillir que 40. Il n’y avait pas assez de place pour se coucher et il fallait se relayer. Après deux jours de voyage, nous voici à EPINAL où nous avons rejoint un camp d’environ 10 000 hommes, dont la majorité était des Allemands.
Durant le transfert de la gare au camp, la population civile d’EPINAL nous lançait des cailloux pensant que nous étions des "Boches".
Stupeur à l’arrivée au camp : nous avons subi une fouille en règle, mais le pire c’était que les Allemands à qui les Américains avaient peint le signe PW (prisoner of war, c’est-à-dire prisonnier de guerre) sur le dos et dont certains étaient déjà là depuis des semaines, régissaient l’intérieur du camp. Nous, réfractaires, avions du mal à contenir notre haine face à cette situation pour le moins insolite : se plier aux ordres des vaincus.
J’étais furieux face à cet amalgame entre réfractaires et prisonniers allemands.
La distribution de la maigre nourriture était assurée par les PW allemands. Or, quand arriva mon tour, un Allemand me dit : « Weiter, weiter ! (avance !), sinon je te donne un coup de bottes dans les fesses ! » C’en était trop. J’ai lâché mon assiette métallique avec le peu de café et lui ai couru après, mais je n’ai pas réussi à le rattraper, heureusement pour lui.
Pour loger, on nous a attribué des bâtiments de caserne avec des fenêtres sans vitrage, n’oublions pas, nous étions à la mi-décembre. Les Allemands, sur place avant nous, disposaient de pièces où il y avait encore des vitres aux fenêtres.
A plusieurs, dont Aloyse KIENER de ROHRBACH, nous avons investi les lieux occupés par les Allemands et ceux qui se sont fait prier pour sortir, sont passés par les fenêtres que nous avions pris le soin d’ouvrir.
Nous sommes restés une dizaine de jours à EPINAL, puis, comme du bétail, nous avons à nouveau été chargés dans des wagons à bestiaux à destination de MARSEILLE.
Les conditions étaient identiques à l’aller : 60 personnes par wagon. Des caisses en bois contenant des boîtes métalliques ont été hissées dans les wagons, c’était nos rations pour trois jours. Je n’ai pratiquement rien mangé durant le trajet. Ceux qui ont tapé dans les boîtes de rations ont tous eu la diarrhée. Il n’y avait pas de toilette et lors des arrêts, les portes sont restées désespérément fermées. Les fameuses caisses en bois servirent de WC, mais lorsqu’elles furent pleines, on a tenté de les jeter à l’extérieur par les ouvertures existantes, qui se sont malheureusement révélées trop petites. Ce fut horrible. Ca dégoulinait de partout et il régnait une odeur nauséabonde dans le wagon. Ce sont des situations indescriptibles, mais il y a eu pire, car la soif vint encore nous tenailler. Nous ne disposions que de 20 litres d’eau pour 60 bonhommes et les trois jours de transfert.
Arrivés enfin à MARSEILLE, nous avons été emmenés dans un camp de baraques du nom de "SEPTEME". A l’entrée du site, il y avait un grand fût d’eau et nous pensions pouvoir nous désaltérer à volonté, mais chacun ne reçut qu’un quart.
Le camp était surveillé par des noirs américains, de véritables bandits, installés pour la plupart dans des miradors. C’était encore une fois, les Allemands avec leur PW sur le dos qui dictaient leur loi. Là aussi, nous étions encore considérés comme des Allemands.
Nos vêtements n’étaient plus que des haillons, tandis que les pièces où nous logions étaient infectées de puces et de punaises.
Huit à dix jours après, une sélection fut faite. Les Malgré-Nous et les réfractaires ont été sortis du camp et installés dans une ancienne caserne placée sous administration française : le camp "BLANCARDE". Les conditions de détention devinrent plus souples, mais la nourriture continuait à faire défaut. Dans la journée, malgré l’interdiction de sortie, nous sommes allés chercher du travail.
La première journée de travail fut au Port pour 3 F par jour. Puis, j’ai trouvé du boulot chez un tailleur de pierres de grès qui faisait des monuments pour cimetière. J’y ai été embauché en même temps que Nicolas MULLER (de Àchener Nìggel) à raison de 1 F par jour, plus la nourriture et les boissons (vin à volonté).
Ce tailleur de pierres de 64 ans était d’origine italienne. Il avait un fils de 22 ans et de sa seconde femme un bébé de 9 mois. Ils habitaient, en location, une grande maison juchée à flanc de colline et entourée d’arbres. Deux femmes âgées respectivement de 72 et 81 ans, logeaient aussi dans la bâtisse. L’atelier était situé non loin de là.
Pour assurer le transport des monuments, le patron louait deux chevaux et je me rappelle qu’un des chevaux avait une trachéotomie. Il faisait très froid et le mistral soufflait souvent. N’ayant plus rien à se chauffer, le propriétaire de la demeure a donné son accord pour abattre plusieurs arbres, en partageant moitié-moitié.
Les jours de repos et les week-ends, j’allais avec Emile GRABHERR effectuer quelques achats dans un magasin. Tandis que l’un achetait quelques carottes et quémandait un peu de sel, l’autre en profitait pour voler encore quelques carottes. Puis, de retour à la caserne, nous avons puisé de l’eau dans le réservoir des WC et fait cuire notre complément de repas sur un petit feu.
J’ai connu MARSEILLE dans ses moindres recoins. J’ai souvent mendié de la nourriture dans les magasins ou aux sorties de magasins. Comme il faisait exceptionnellement froid et que les gens étaient pauvres, j’ai pu observer que lorsqu’un train de charbon entrait en gare, les gens se jetaient dessus comme un essaim d’abeilles pour le dévaliser.
J’ai un jour aussi rencontré une vieille dame qui faisait la queue, attendant l’attribution d’un peu de bois. On lui alloua quelques morceaux qu’elle m’a demandé de lui ramener à son domicile, très proche. Elle m’a remis 25 F.
Nous allions parfois prendre connaissance de l’avancement du front qui était affiché sur une grande carte au centre de la ville. Un jour, j’ai entendu un vendeur de journaux crier : « La ville de RIMLING est tombée, la ville de RIMLING est tombée ! »
Tout ébahi, je n’ai pas compris où pouvait être située une ville de ce nom. Je me suis alors rendu à cette grande carte et j’ai vu qu’il s’agissait en fait du village de RIMLING.
J’ai aussi eu un petit accident. Comme les repas étaient peu fournis, il y eut, une fois, un rab de frites. Tout le monde est accouru et moi, j’ai glissé, tombant sur le rebord de l’escalier. J’ai dû aller voir un médecin car j’avais une douleur persistante sur le côté, mais il n’a rien diagnostiqué.
Durant cette période, j’ai aussi côtoyé Joseph ESCHENBRENNER (de Bìtscher) que j’avais connu aux travaux sur la ligne Maginot. C’était un sacré blagueur, il avait toujours le mot pour faire rire. Je lui ai souvent emprunté son grand manteau gris muni de poches intérieures et extérieures, ce qui était pratique pour faire les courses.
Après six semaines, j’ai réussi à obtenir un certificat d’hébergement pour Emile GRABHERR et moi-même, afin de pouvoir nous rendre en CHARENTE, là où mes parents avaient été réfugiés. Un retour en MOSELLE n’était pas encore possible à ce moment, le front étant encore trop proche.
Le 22 janvier 1945, un ordre de démobilisation en poche, Emile et moi, nous avons pris le train pour la Charente. Arrivés à BORDEAUX, nous avons transité pendant deux jours au foyer du prisonnier, où nous avons bien vécu. Puis, nous sommes arrivés chez la famille PAQUIN, domiciliée ferme LAVALETTE, annexe de BIOUSSAC, près de RUFFEC.
La famille PAQUIN était une famille recomposée. Monsieur PAQUIN, veuf avec un fils, Pierre et une fille, Jacqueline, s’était remarié avec "Madame", elle aussi, veuve avec un fils, Raoul et une fille, Jeanne. Les deux garçons, Raoul et Pierre, étaient encore enrôlés dans l’armée durant la période que nous passerons en Charente. Nous avons été très bien reçus et avons pu apprécier une très bonne table avec une nourriture à volonté, souvent du foie gras
et du bon vin fait maison.

Mr PAQUIN et sa belle-fille Jeanne
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)
(Cliquez sur l'image pour l'agrandir)
Emile et moi, nous ne nous sommes pas fait prier pour mettre la main à la pâte et avons participé aux travaux agricoles et domestiques qui ne manquaient pas dans cette ferme. Le cheptel était composé de 25 vaches et génisses, 50 moutons et 3 chevaux. J’ai aussi effectué le pavage de la porcherie, qui jusque-là, avait gardé un sol en terre battue et pour éviter que les porcs ne le défoncent de trop, les propriétaires avaient l’habitude de mettre un anneau ou un bout de ferraille dans le museau de la bête.

En Charente, avec Jeanne PAQUIN et Emile GRABHERR
Au début de mon séjour en Charente, une douleur thoracique persistait. J’ai été voir un spécialiste à RUFFEC qui a détecté trois côtes fracturées sans déplacement, occasionné lors de ma chute à MARSEILLE.
Au bout de six semaines, la Lorraine étant définitivement libérée, l’autorisation de retour en terre natale nous est parvenue.
Nous nous sommes donc mis en route et par camion et train avons gagné dans un premier temps PARIS. Nous avons fait une halte chez Delphine WEISS (originaire de RAHLING), qui avec son mari, exploitait une petite boulangerie. Son frère Jean-Nicolas était arrivé la veille.
Puis, Emile et moi, nous nous sommes rendus chez Andrée (originaire de DIEMERINGEN et fiancée à François LEDIG de RAHLING) qui travaillait à PARIS. Nous sommes restés deux jours chez Andrée. Elle nous a accompagnés durant ces deux jours à tourner dans la capitale à la recherche d’habits. Les rayons étaient désespérément vides. Juste avant de ressortir du grand magasin "la Samaritaine", j’ai dit à un vendeur :« Pourquoi ce mannequin est-il habillé d’une chemise, alors qu’il n’y a pas moyen de se procurer le moindre vêtement, malgré les bons d’habillement de prisonniers, remis à MARSEILLE?»
Cette dernière phrase a eu un effet inespéré. Elle a fait tilt auprès du vendeur. Après quelques explications, il nous fit asseoir et nous avons été servis comme des rois. En effet, les réserves regorgeaient d’habits, mais tous les magasins spéculaient, attendant des augmentations de prix avant de les mettre en vente. Or, avec nos bons d’habillement qu’ils factureront à l’Etat, ils seront assurés d’un bon bénéfice.
Nous avons eu des vêtements sur mesure, une première partie nous a été remise de suite, un complément nous a été livré le lendemain matin. Le restant nous a été expédié au domicile huit jours plus tard.
Après avoir quitté PARIS en train, nous avons fait une halte à NANCY pour aller à l’Hôpital Central, rendre visite à ma mère hospitalisée et traitée pour un cancer des ovaires. Le trajet de NANCY à SAINT-AVOLD, nous l’avons couvert en stop, pris en charge par des camionneurs dont le dernier, habitant SAINT- AVOLD, nous a hébergés dans sa famille. Le lendemain, 19 mars 1945, cet ancien militaire, qui allait effectuer une livraison dans le "Bìtscherlònd" avec son vieux camion de l’armée, nous a emmenés à ACHEN.
Une étape importante de notre vie venait d’être franchie : le conflit était derrière nous et l’avenir restait à construire. Après les joyeuses retrouvailles avec le reste de ma famille, avec ma fiancée et les siens, il s’agissait de s’atteler à la tâche.
L’APRES-CONFLIT
J’ai repris la culture, mais j’ai dû me débrouiller pour acquérir deux nouveaux chevaux. Il a donc fallu en trouver par débrouillardise. Avec Charles LUTTMANN (Karl Kìrsch), je suis allé à ZWEIBRÜCKEN où j’ai carrément détaché deux chevaux chez un agriculteur allemand et Karl a pu prendre un âne. Les chevaux n’étaient pas des bêtes de premier choix, l’un était déjà âgé, mais j’avais à nouveau un attelage. Petit à petit, la vie reprit et malgré les conseils de mes frères d’aller travailler dans une entreprise, l’attrait pour la terre et les bêtes fut plus fort.
Au bout de quelque temps, l’un des deux chevaux a crevé et j’ai revendu le second qui ne valait pas grand-chose. Je m’en suis procuré deux nouveaux près de CHATEAU-SALINS. A OBERGAILBACH, j’ai pu acheter une houe à cheval (e Hàcker) et un buttoir (e Hiffler).
A SARREGUEMINES, comme dans beaucoup d’endroits, il y avait un camp de prisonniers allemands. Les agriculteurs pouvaient en engager un pour les aider dans leurs tâches. Vers la mi-avril 1945, j’ai été à SARREGUEMINES pour récupérer un de ces prisonniers, lequel, le soir venu, devait intégrer la caserne d’ACHEN. Il ne savait rien faire, il s’était porté volontaire afin de pouvoir bénéficier de meilleurs repas que ceux servis au camp. Je l’ai rendu après huit ou dix jours. Le deuxième qui m’a été attribué s’appelait HERMANN. Il était très discret, relativement bon travailleur, mais au bout de quelques semaines, ayant appris la mort de sa femme et n’ayant plus d’entrain, il s’en est retourné au camp.

Moi et un autre prisonnier sur les chevaux,
HERMANN tenant les deux bêtes

A RAHLING:
HERMANN, Oncle Philippe, Tante Barbe, moi, Louise et ma fiancée Ida
HERMANN, Oncle Philippe, Tante Barbe, moi, Louise et ma fiancée Ida
Le troisième, du nom de Rudolph WESP, était un chic type. Originaire de l’Allemagne de l’Est, il avait travaillé dans l’imprimerie et il était très habile de ses mains. Marié, père d’un fils qu’il n’avait pas encore vu puisque né pendant la guerre, il restera chez nous jusqu’en 1948, où il fut autorisé à rejoindre sa petite famille à HILPOLTSTEIN près de NUREMBERG. Pendant son séjour chez nous, il était intégré à la famille, il touchait un pécule, mangeait et dormait à la maison. De temps à autre, il y avait un contrôle pour voir s’il était encore là et si je lui remettais bien son dû. Nous nous étions liés d’amitié et avons maintenu le contact après son départ.
En été 1945 a été organisée une grande fête de la Libération, avec un défilé. J’ai participé activement à son organisation : Albert DEHLINGER (de Kättler) et moi, nous avons décoré un chariot auquel nous avons attelé six chevaux pour défiler. Tout le village s’est retrouvé au "Kìrchegäärdel" pour la circonstance. Quand quelques jours après, j’ai appris qu’aucun bénéfice n’avait été réalisé, j’étais en colère car j’ai compris qu’il y avait eu détournement de fonds et cela m’a échaudé au point de ne plus vouloir me lier à des associations à l’avenir.
 |
 |
A ACHEN devant la maison de mes parents
Le temps fixé pour les noces approchait. J’ai trouvé un nid pour notre futur couple, un petit logement deux pièces (une petite cuisine et une grande chambre) chez Jacques WOLF (Wolfe Jààkob) au 9, rue de GROS-REDERCHING à ACHEN.
Le vendredi 30 novembre 1945, au soir, nous sommes passés devant le maire de RAHLING, Jean-Félix BACH, pour l’union civile. Le lendemain matin, samedi 1er décembre, le mariage religieux a été célébré en l’église de RAHLING, par l’abbé DAY.

Au début du mois de mai 1946, avec mon épouse, ma sœur Hilda et son fiancé Jean-Nicolas ainsi que Marie EICH (une voisine de RAHLING), j’ai effectué le pèlerinage à MARIENTHAL. La promesse de ce pèlerinage avait été faite par mon épouse si nous sortions sains et saufs de la guerre. De bon matin, nous nous sommes donc mis en route à pied pour rallier la cité mariale. Jean-Nicolas et moi, nous avons emporté nourriture et boisson dans des sacs à dos. Le beau temps était de la partie et la première journée, nous avons pu couvrir la distance jusqu’à REICHSHOFFEN. Là, nous avons dormi dans une grange et le lendemain matin, Marie, a eu du mal à reprendre la route car elle avait des ampoules aux pieds et avançait comme si elle marchait sur des œufs.
Vers le soir du deuxième jour, nous avons atteint notre but et trouvé l’hospitalité chez un certain Léon, ancien contremaître de la ligne Maginot, ayant habité à ACHEN. Il avait été informé de notre arrivée et nous avons donc pu loger chez lui durant les deux jours que nous sommes restés à MARIENTHAL. Ida n’a pas souffert durant le déplacement, mais ma sœur Hilda avait les pieds en compote et son fiancé avait dû lui acheter une paire de pantoufles qu’elle avait gardée aux pieds durant notre séjour sur place. Après avoir prié et honoré la Sainte Vierge durant deux jours, nous avons entamé notre voyage de retour par chemin de fer et au soir du cinquième jour, nous étions revenus au domicile.
La cousine Louise, quelques semaines après, ira faire le même pèlerinage avec un autre groupe pour honorer sa promesse faite au même moment que celle de mon épouse.
Le 30 septembre 1947 a lieu la naissance de notre premier enfant, un garçon que nous prénommerons CLAUDE.
Suite au décès de l’oncle Philippe LEMMER, le 12 mai 1948, tante Barbe et Louise se sont retrouvées seules. J’avais une dette morale envers elles. Après tous les risques qu’elles ont encourus durant ma période de réfractaire, je m’étais promis de ne jamais les abandonner. Ida et moi, avons donc pris la décision d’aller habiter à RAHLING et quelque temps après, vers la mi-juin, nous nous sommes installés dans leur maison, cohabitant dans la bonne entente avec elles.
La "Bäwwe TÒÒnde", du point de vue cheptel, avait trois vaches et un cheval. Ce dernier, je lui ai suggéré de le vendre, puis j’ai ramené deux chevaux et deux vaches. Le matériel agricole était dans un piteux état et il a fallu que je le remplace dans sa globalité.
Me voici désormais établi à RAHLING, exerçant mes divers talents, travaillant durement, mais respectant les autres et honorant le caractère sacré des dimanches et jours fériés.
A compter de ce moment, j’eus droit à un changement de mon appellation: je n’étais désormais plus le "Bräägels Joseph", comme les habitants d’ACHEN me dénommaient, mais j’étais devenu le " Àchener Sépp" pour les habitants de RAHLING. Les surnoms étaient d’usage à l’époque et pour moi, les Rahlingeois avaient choisi la solution de facilité, m’attribuant le nom de mon village d’origine. Ainsi, à partir de 1948, je suis resté le "Àchener", beaucoup de villageois ne connaissant même pas mon véritable nom.
Deux autres enfants vinrent encore égayer notre foyer : SOLANGE, le 14 octobre 1949 et BENOIT, le 12 mars 1959. »

Ma petite famille (photo de 1964)
.
D’autres détails de la vie de Joseph, retracés par son fils Claude.
Le 1er novembre 1963, en plus de son train de culture, mon père accepte le poste de magasinier de la Coopérative Agricole Locale.
Durant 18 ans, de 1965 à 1983, il aura été Conseiller Municipal de RAHLING, comme colistier du maire Louis BORNER.
A compter du 1er juillet 1968, il assurera la gérance de la Coopérative Agricole.
Le 26 mai 1969, il sera employé par la Commune, en tant qu’ouvrier communal. Malheureusement, 15 jours après, il sera victime d’un grave accident de la circulation, en même temps accident du travail, dont il gardera de graves séquelles, le rendant invalide. De plus, cela mit un terme à ce qui lui tenait très à cœur : l’agriculture et son beau cheptel dont il était fier.
Il était également membre de la section locale des Anciens Combattants et participait à toutes les fêtes patriotiques.

En mars 1989, à l'étang de " l’Altkirch ",
rassemblement annuel de la section locale
des Anciens Combattants de RAHLING.
Mon père est le 1er à gauche au 1er rang.
rassemblement annuel de la section locale
des Anciens Combattants de RAHLING.
Mon père est le 1er à gauche au 1er rang.
En 1981, mon père acquiert une voiturette sans permis, ce qui lui permit une certaine autonomie.
Le 1er décembre 1987, ma mère décède brutalement, désormais la vie de mon père va basculer et il sera quelque peu dépendant de ses enfants pour les repas et le ménage.
Il aura la joie de pouvoir choyer 6 petits-enfants et 2 arrière-petites-filles.

Rahling. En 1994, le domicile familial pavoisé à l’occasion de
la fête du 50ème anniversaire de la Libération.
la fête du 50ème anniversaire de la Libération.

Achen. Maison parentale de Joseph, de nos jours,
la structure extérieure n'a guère changé depuis 1934.
Au fil des années, après plusieurs ennuis de santé, il sera pris en charge alternativement par ses trois enfants, à compter de 1996.
Le 09 mai 1998, mon père eut 80 ans.

Le 24 mai 1998, mon père a eu la grande joie de pouvoir
rassembler autour de lui toute sa famille, sa parenté et ses amis
à l’occasion d’un repas en l’honneur de son 80 ième anniversaire.
rassembler autour de lui toute sa famille, sa parenté et ses amis
à l’occasion d’un repas en l’honneur de son 80 ième anniversaire.
En juillet 1999, après la dégradation de son état de santé, moi, Claude et mon épouse, nous le prendrons entièrement à charge et ainsi il demeurera à KALHAUSEN jusqu’à son décès, le 05 mai 2001, âgé de 83 ans.


Claude Freyermuth - novembre 2018